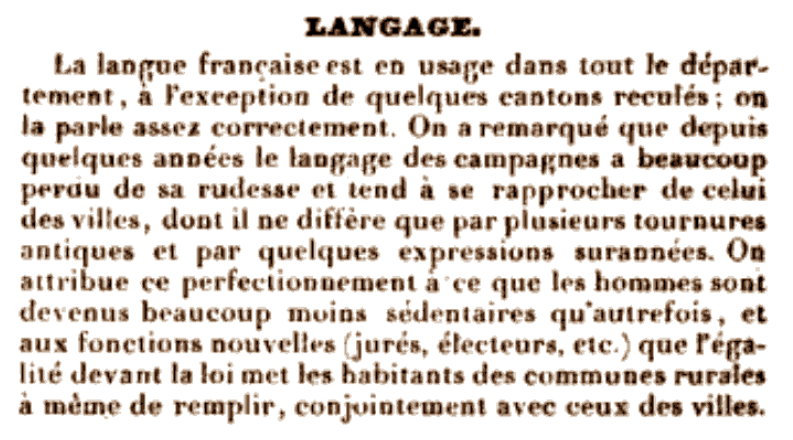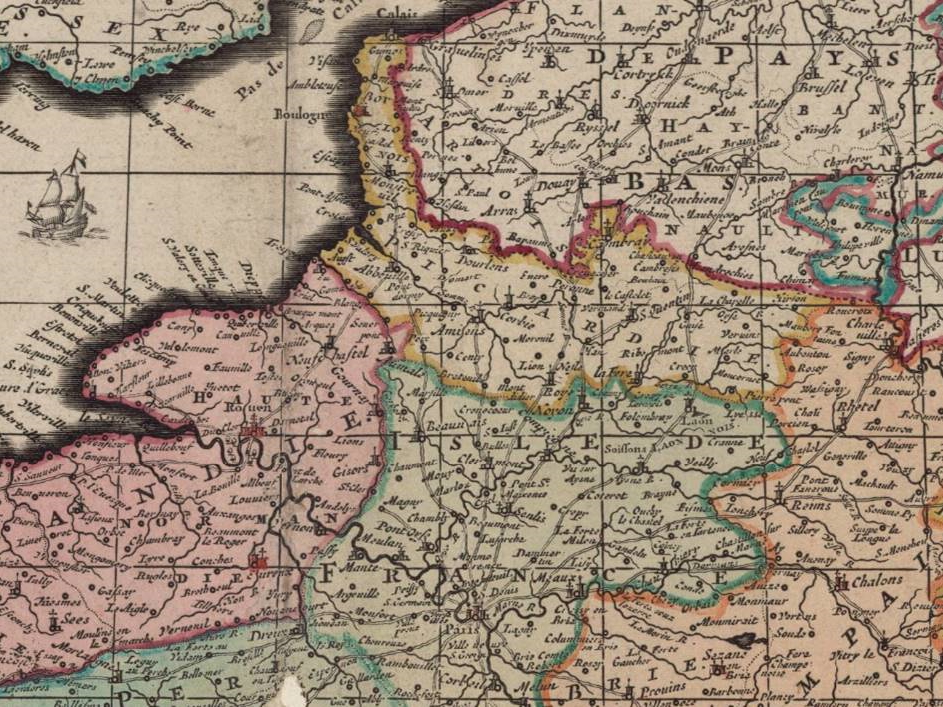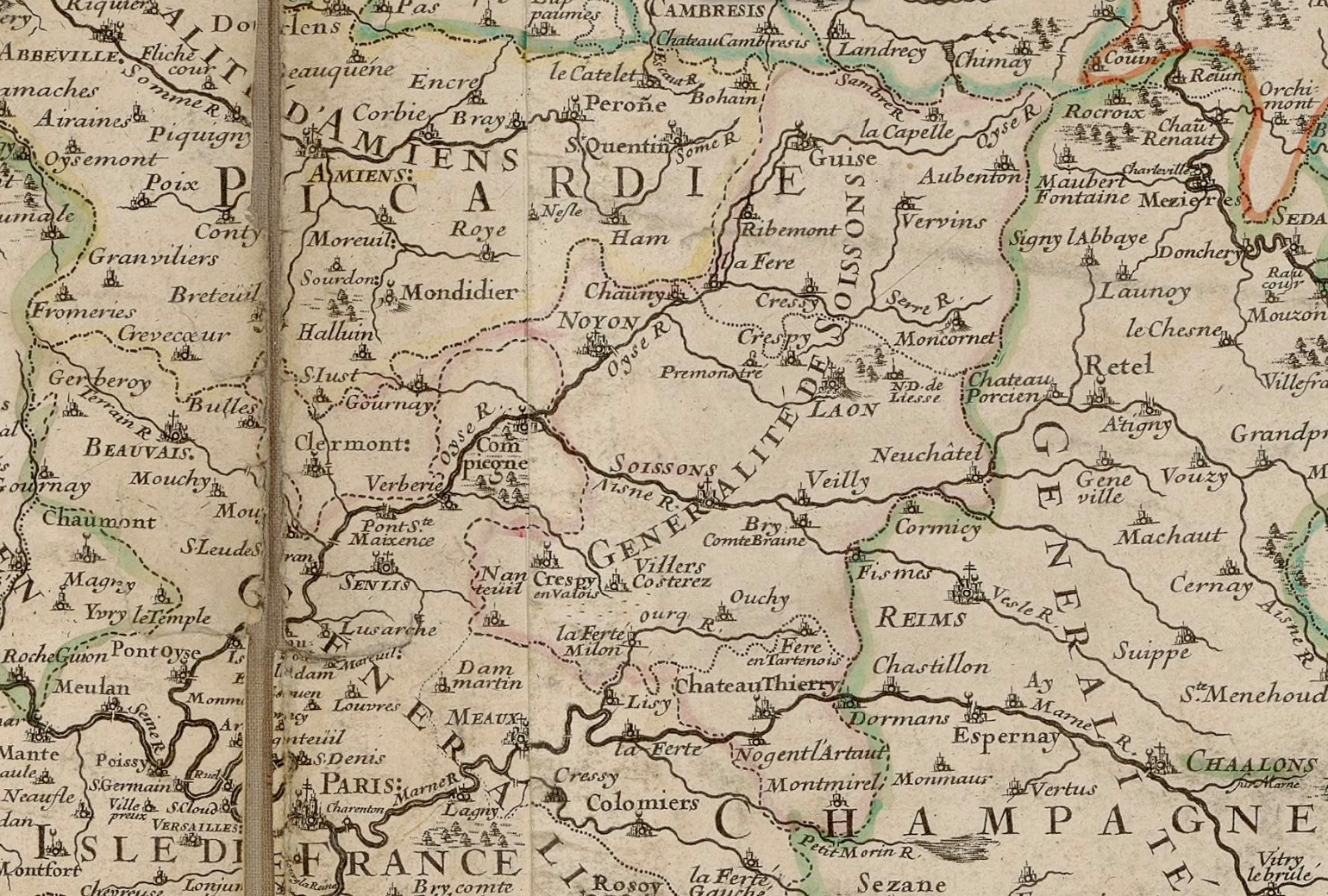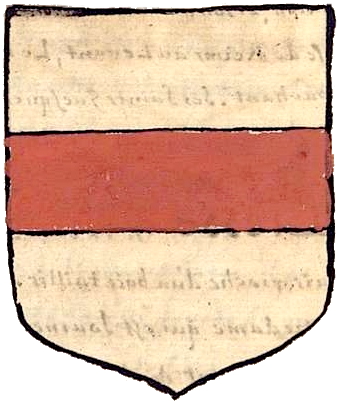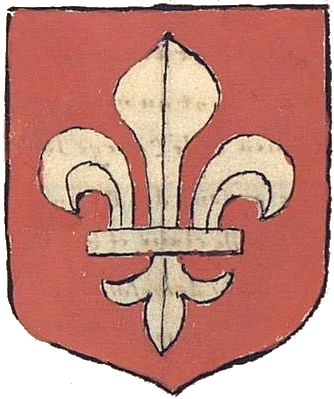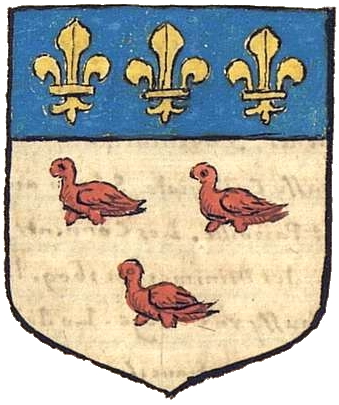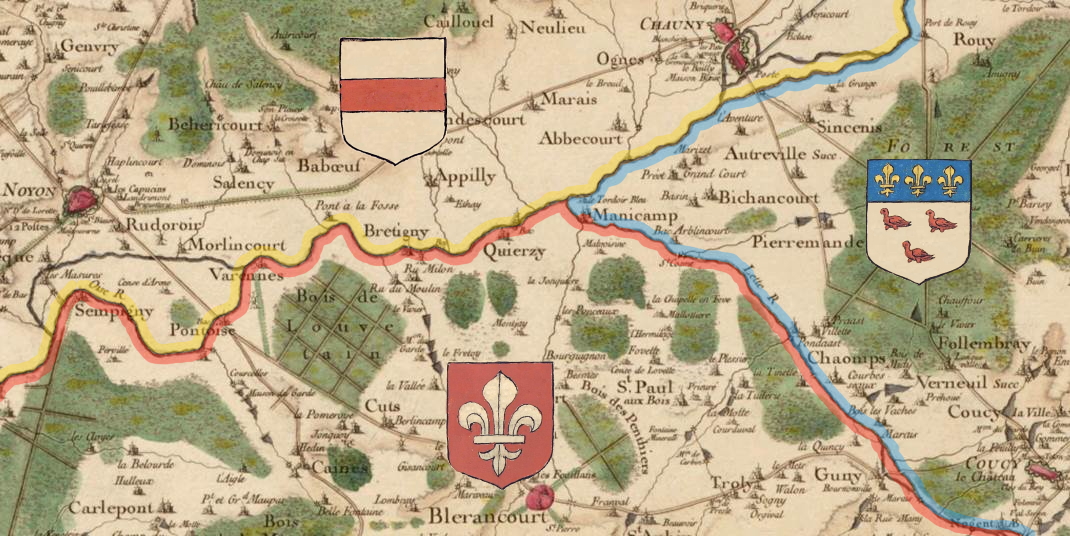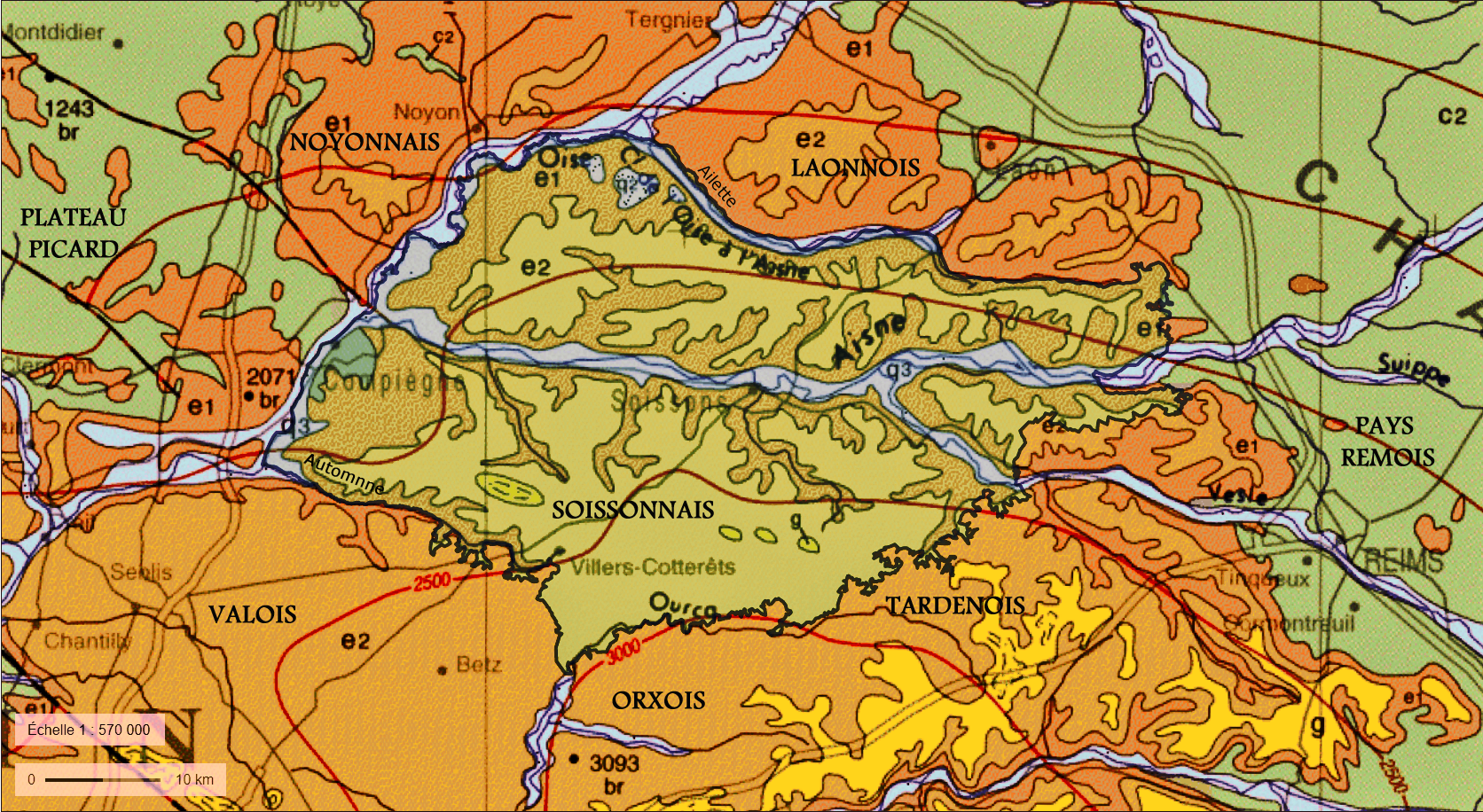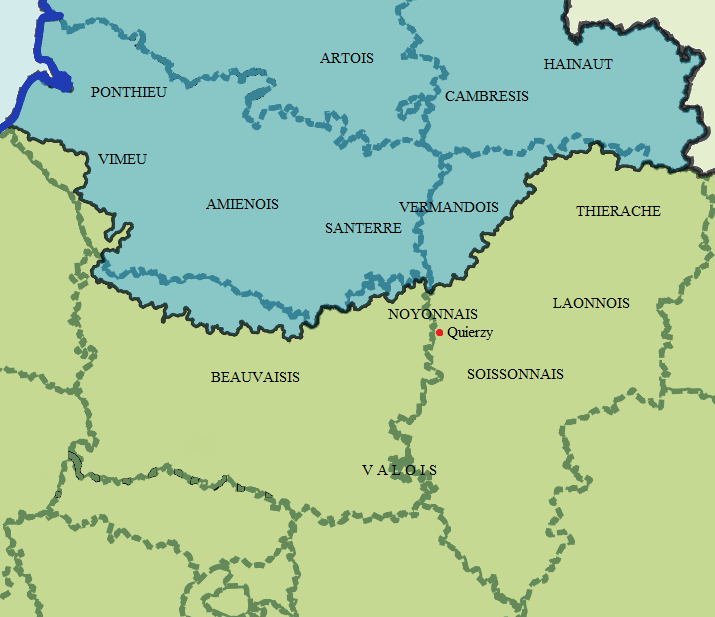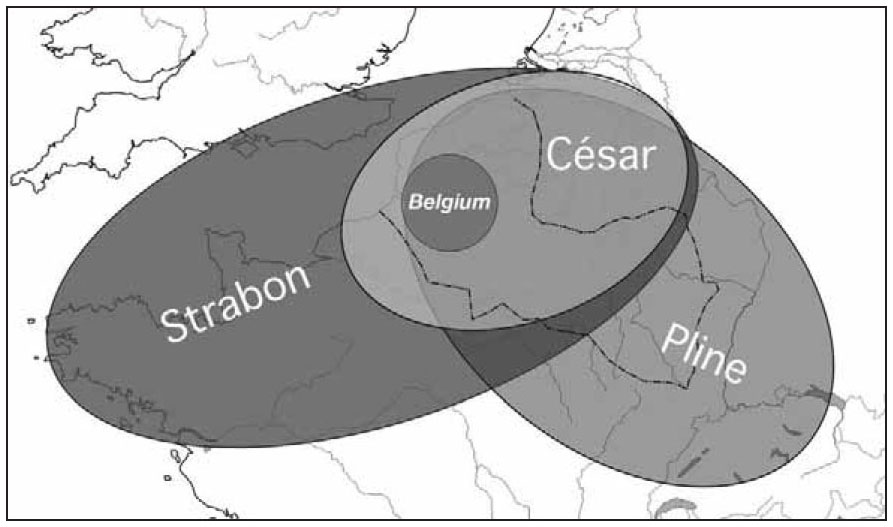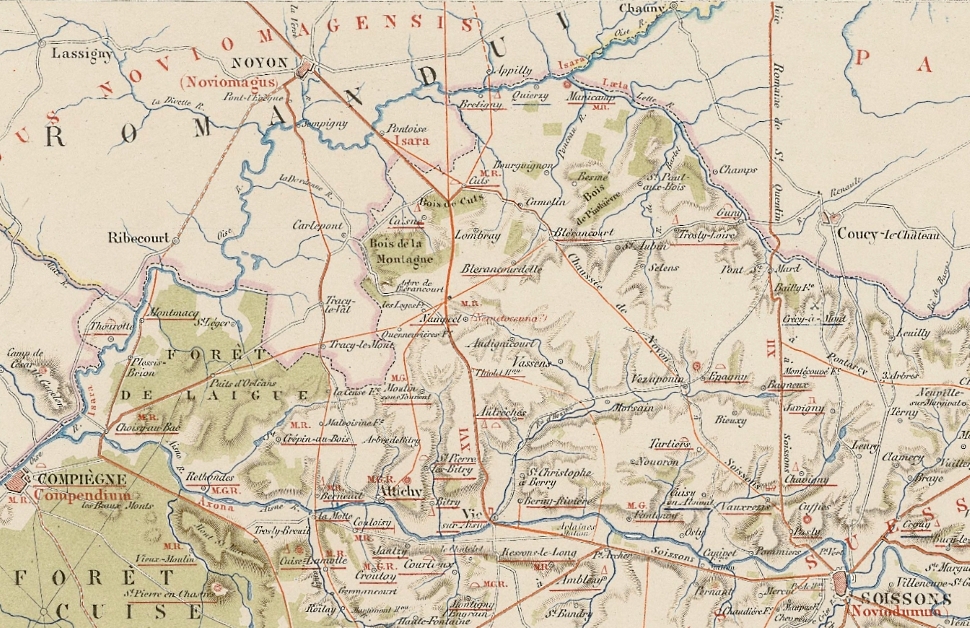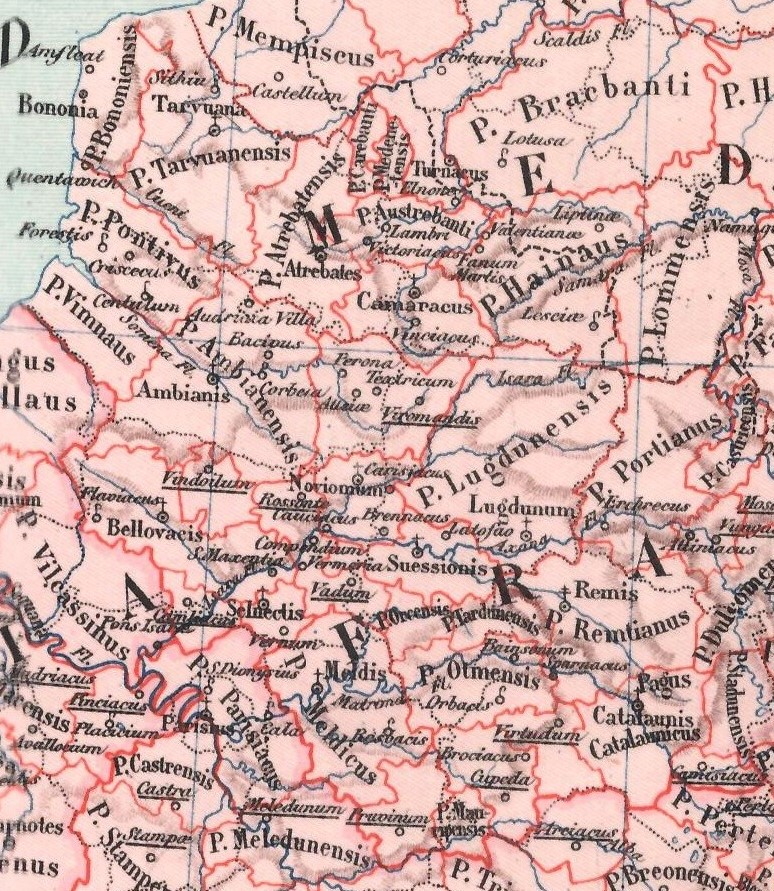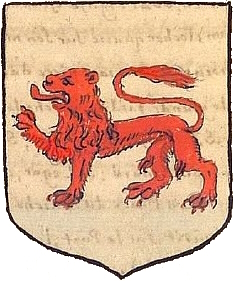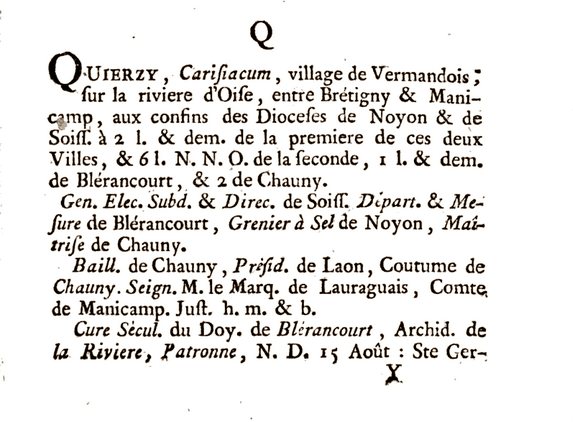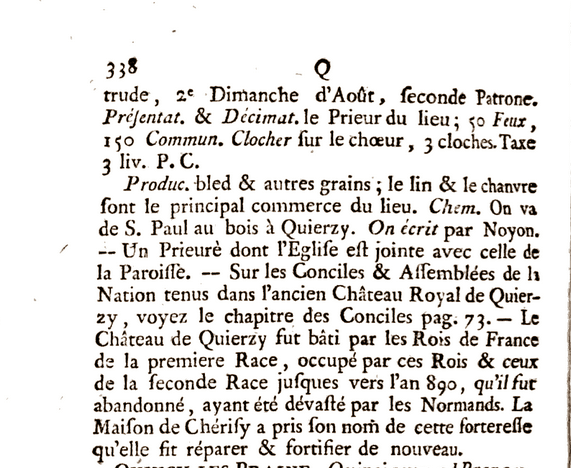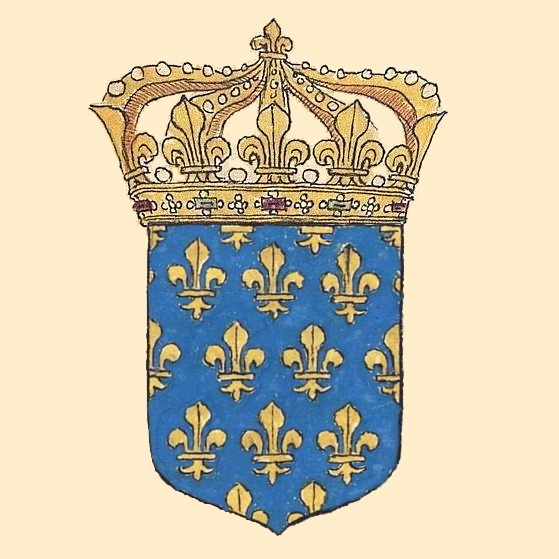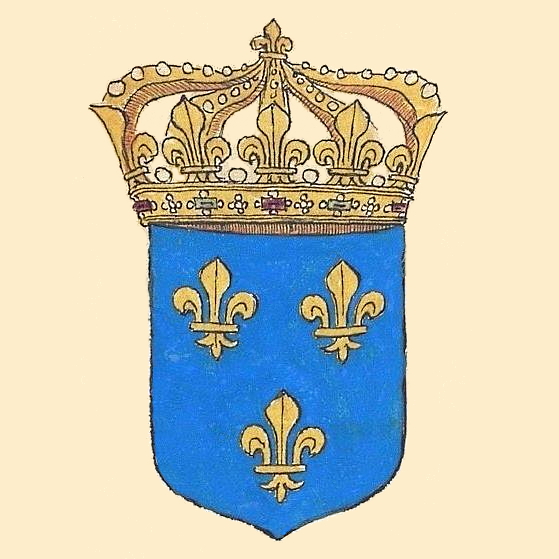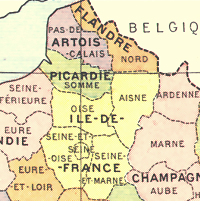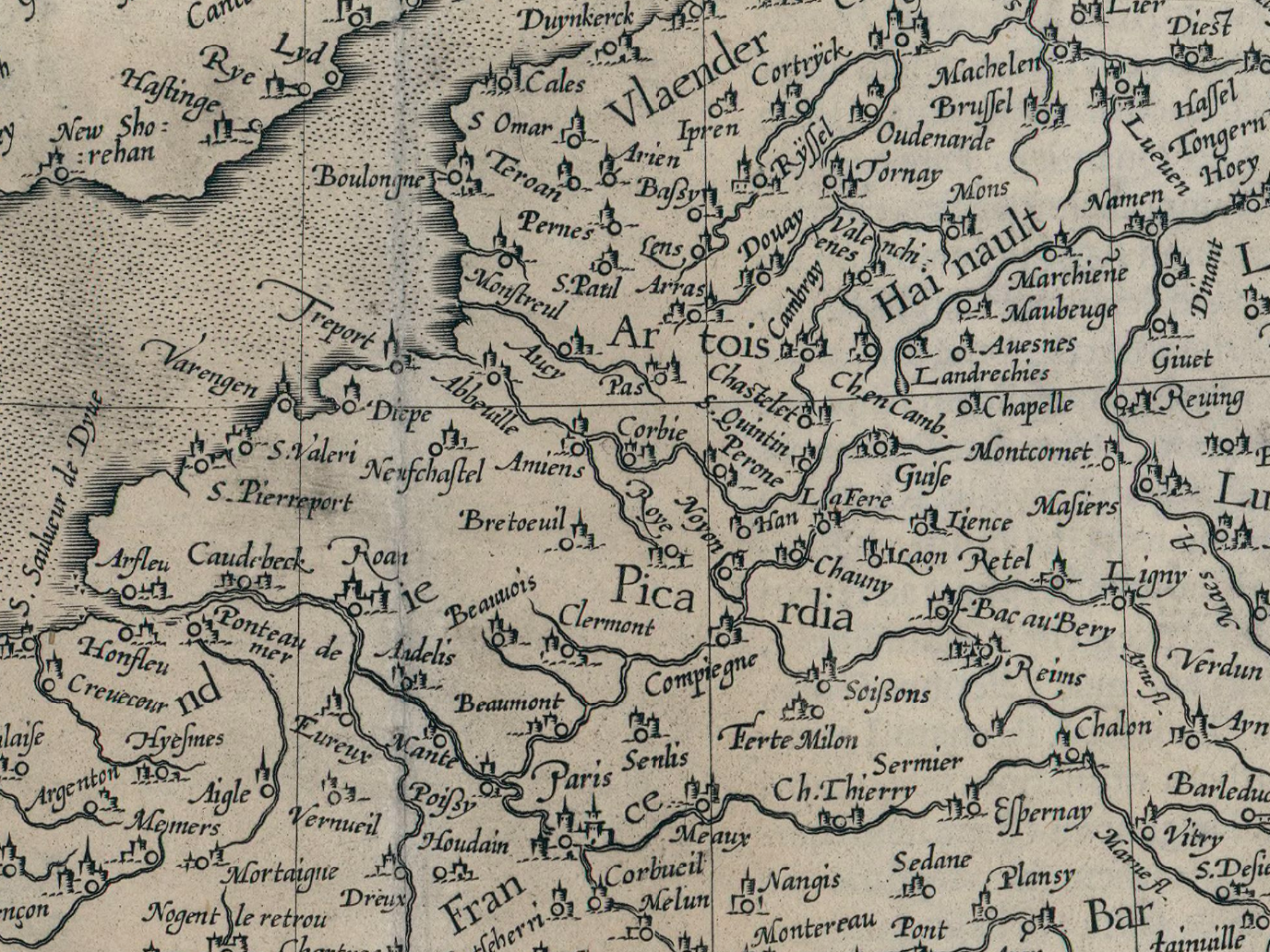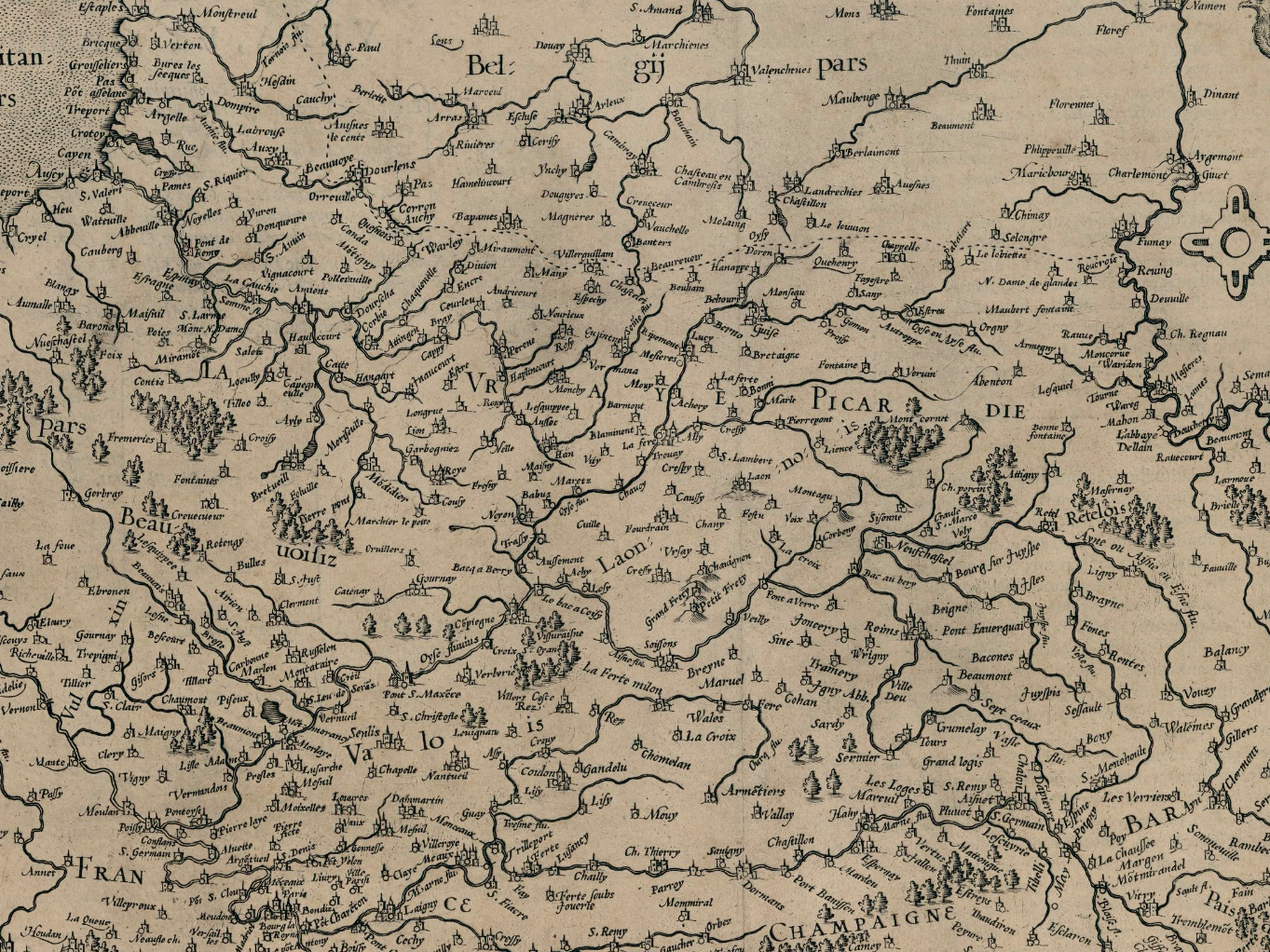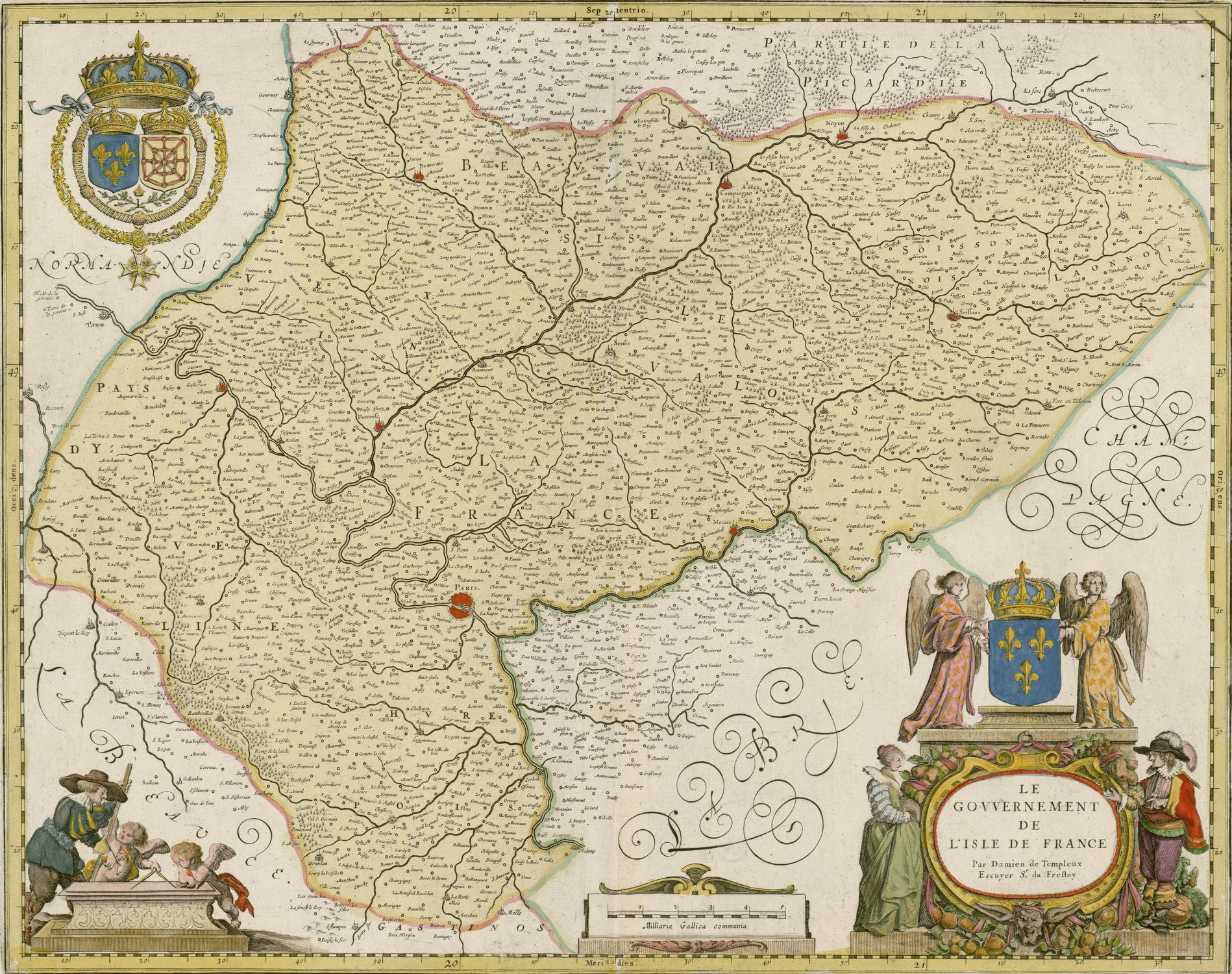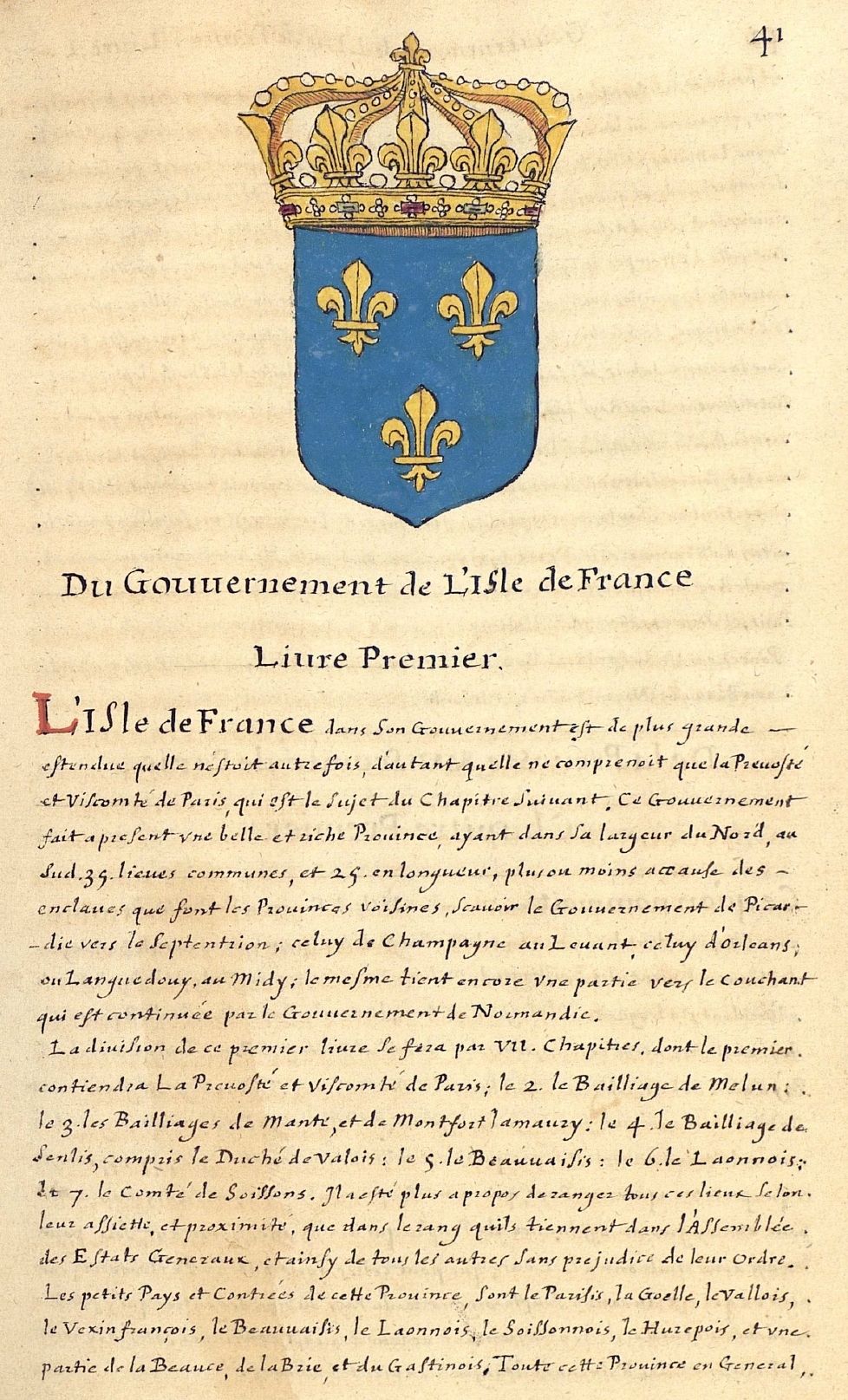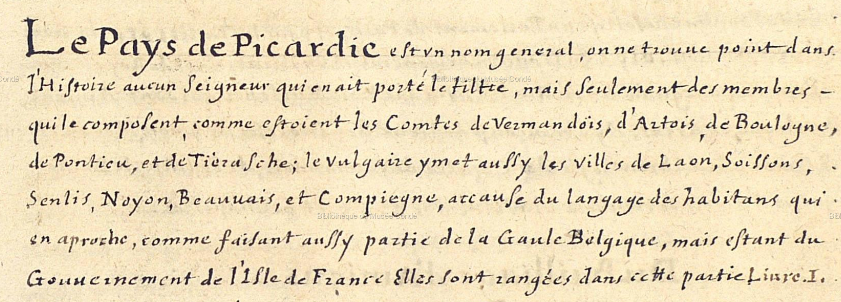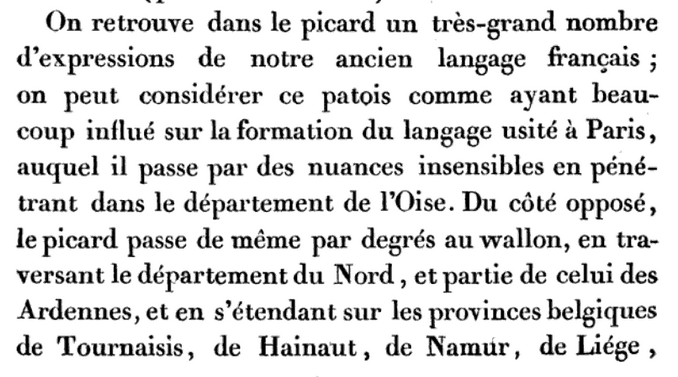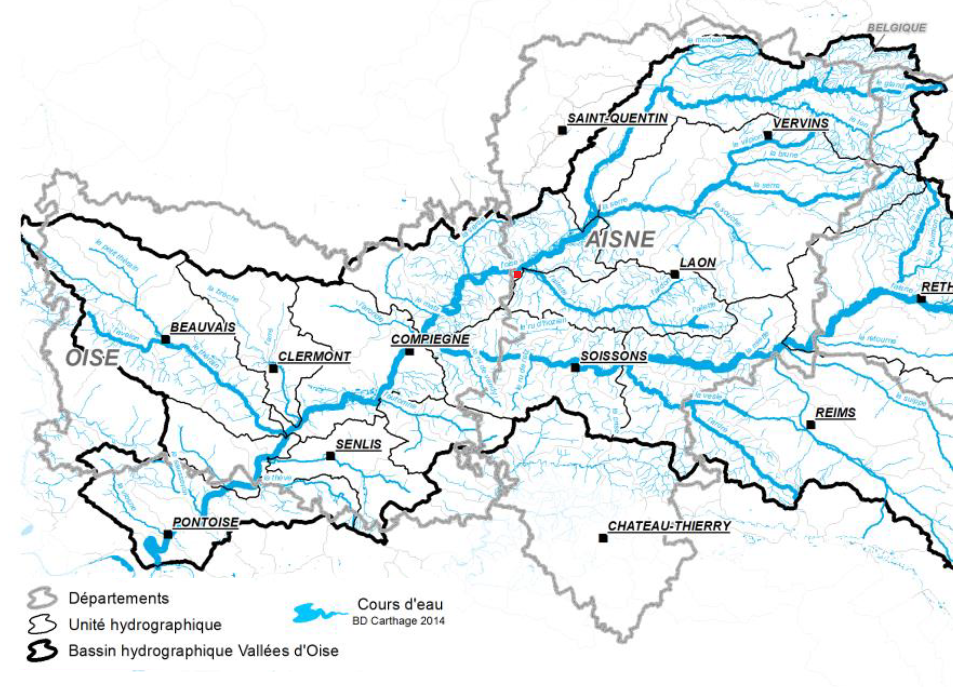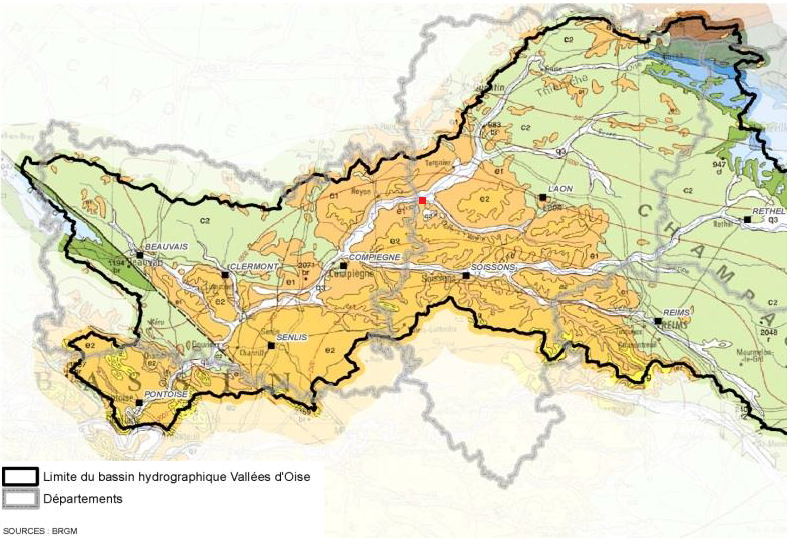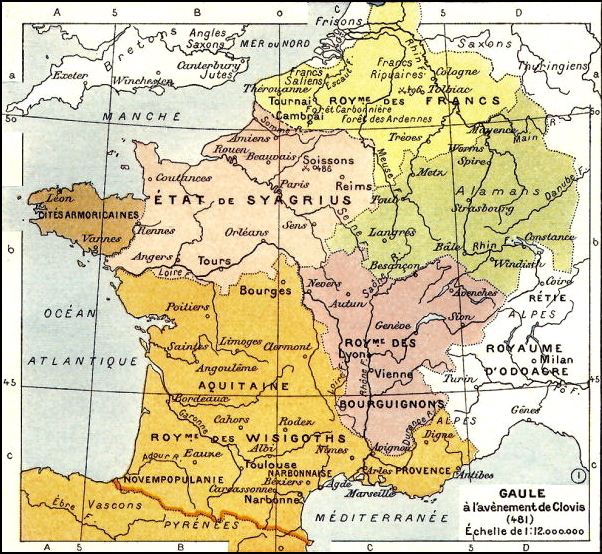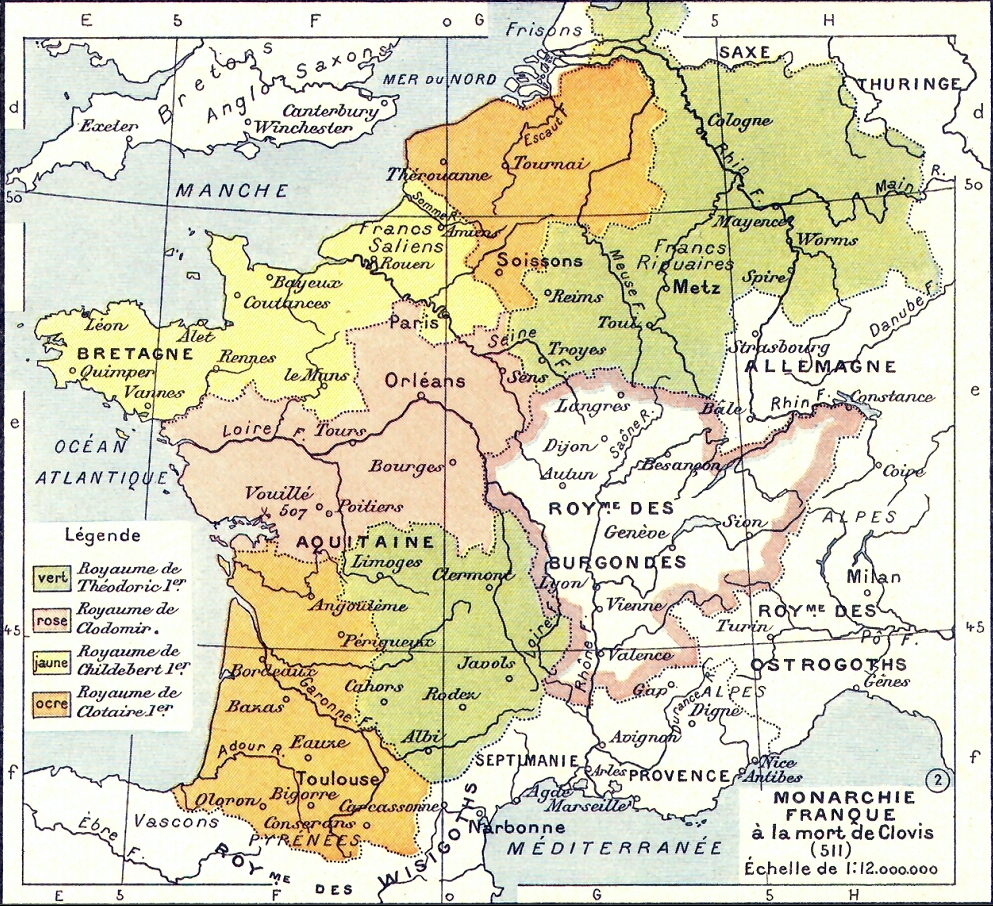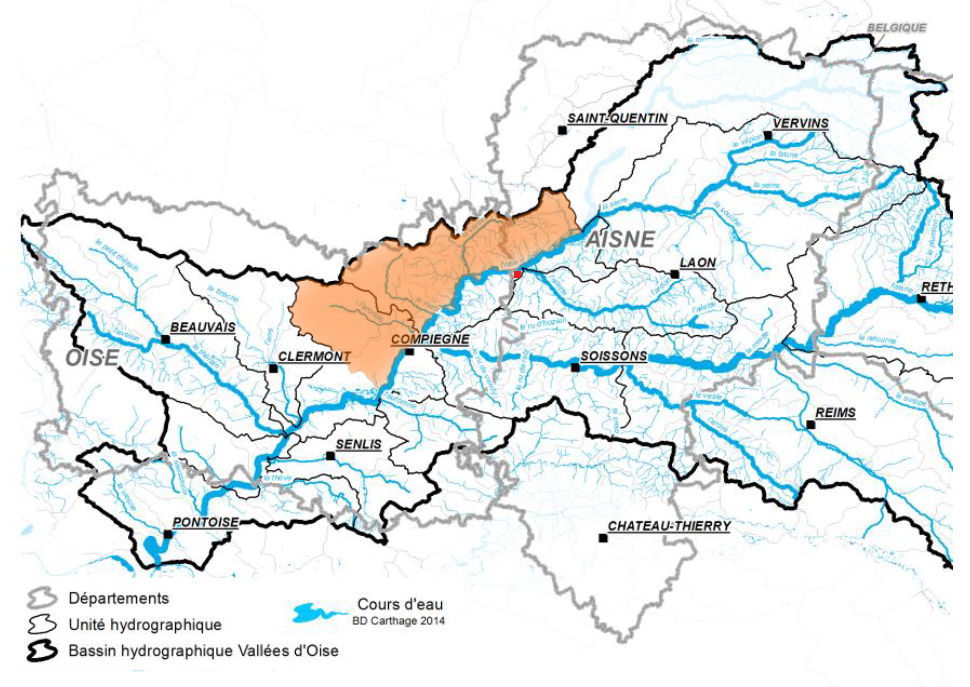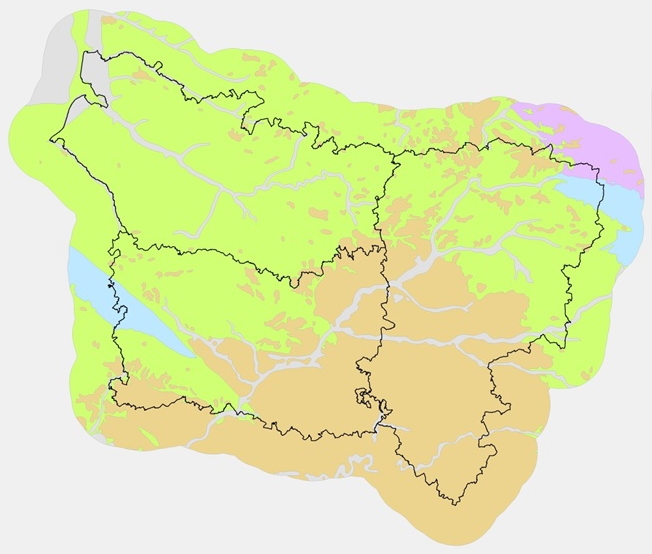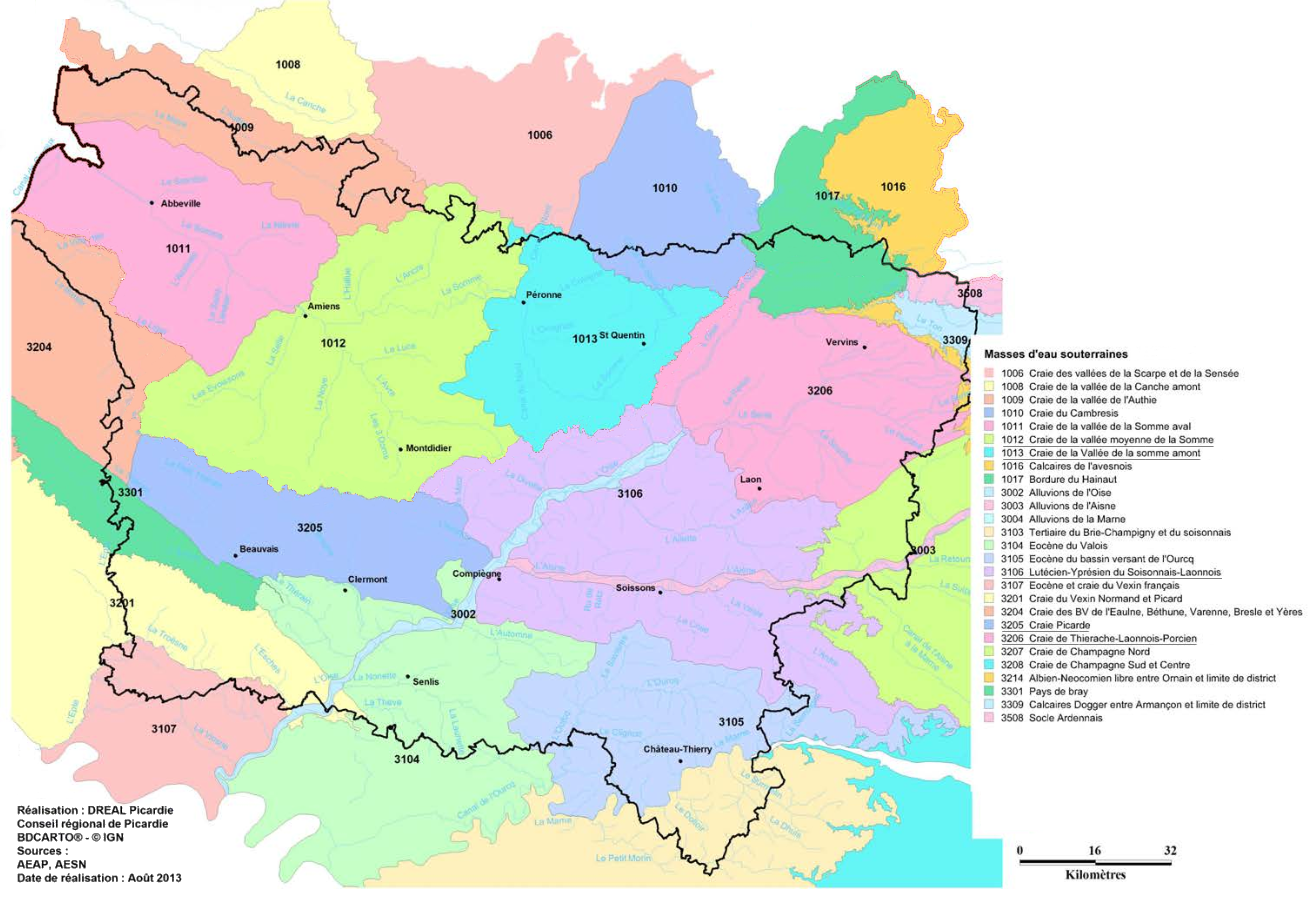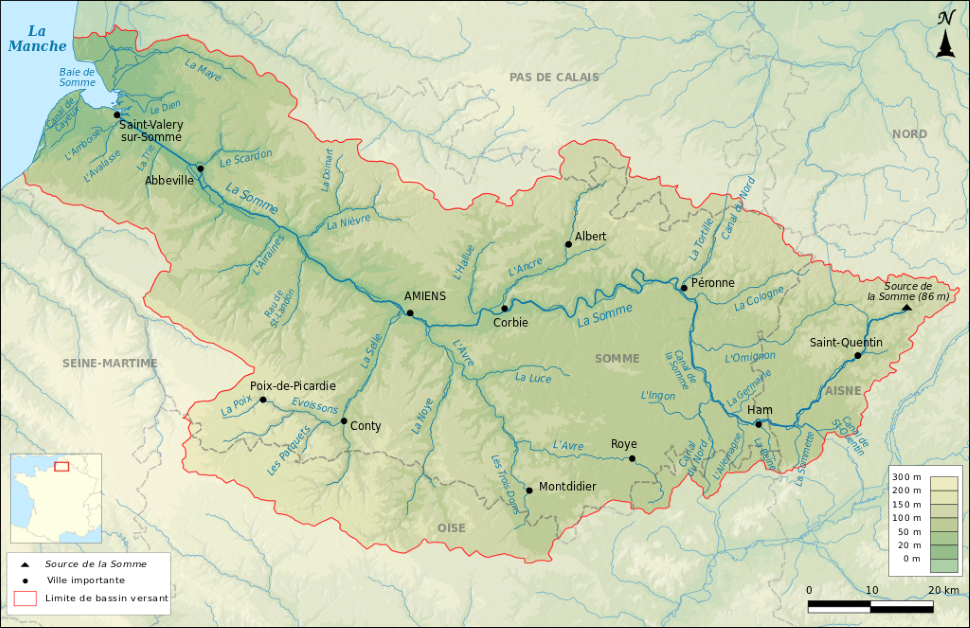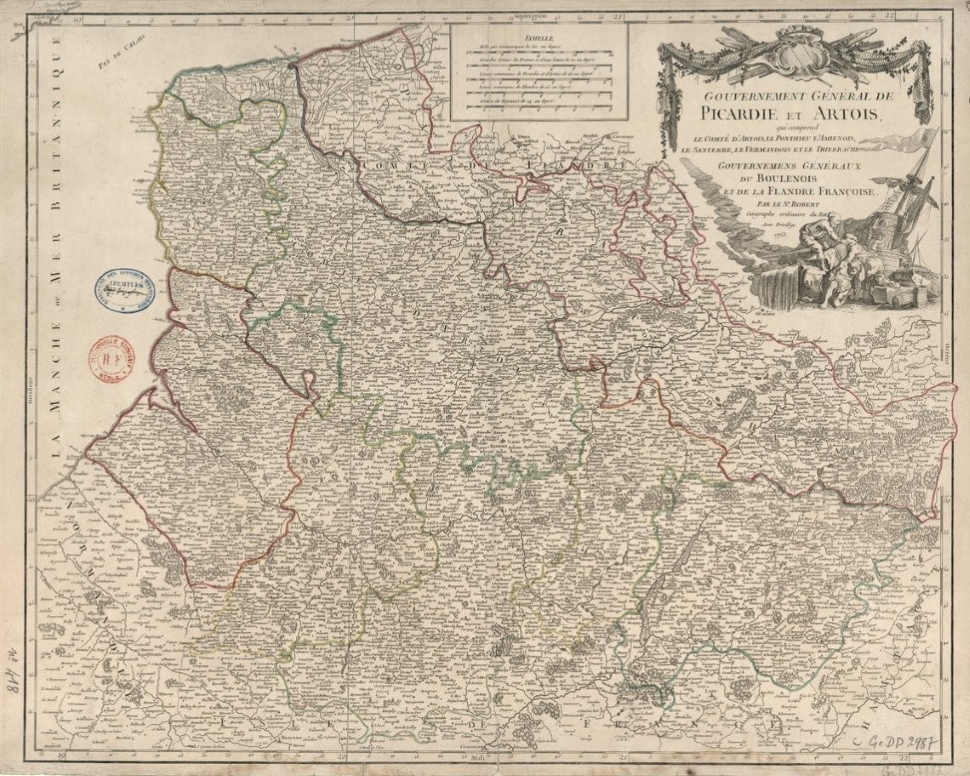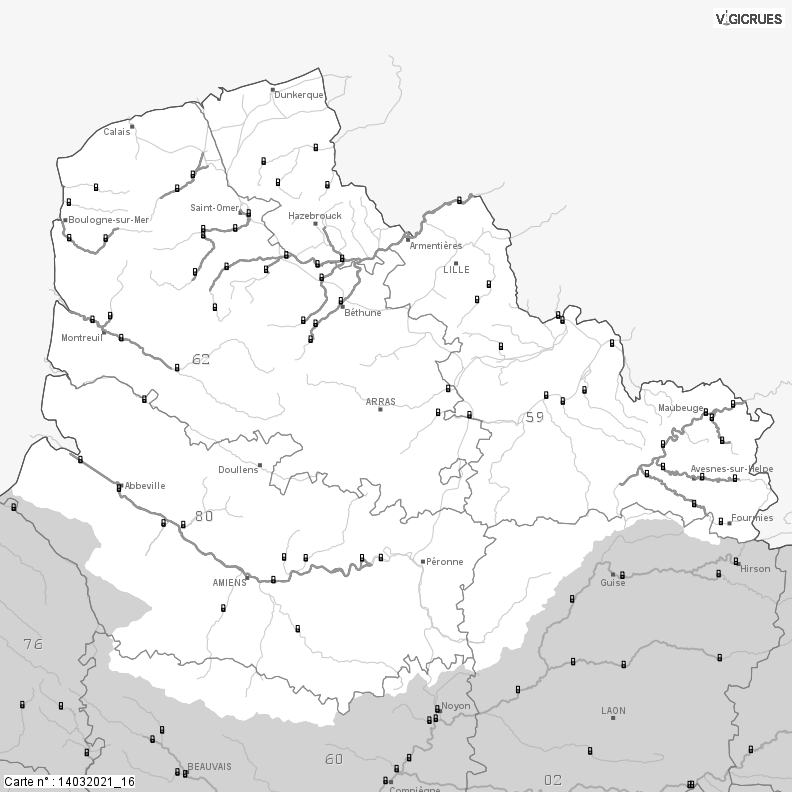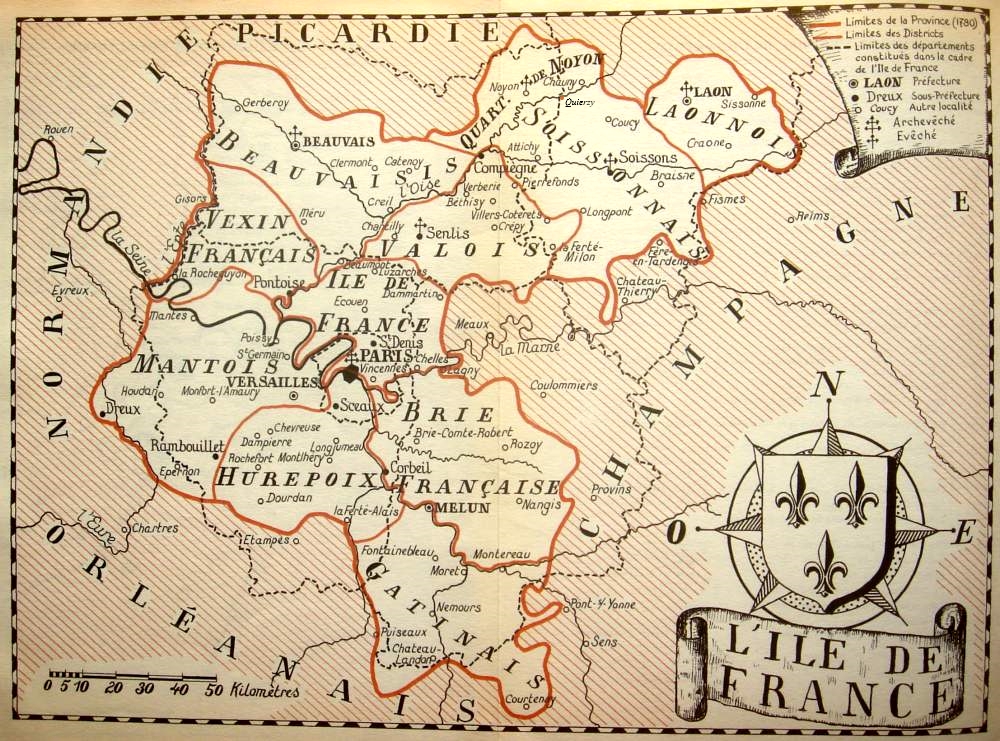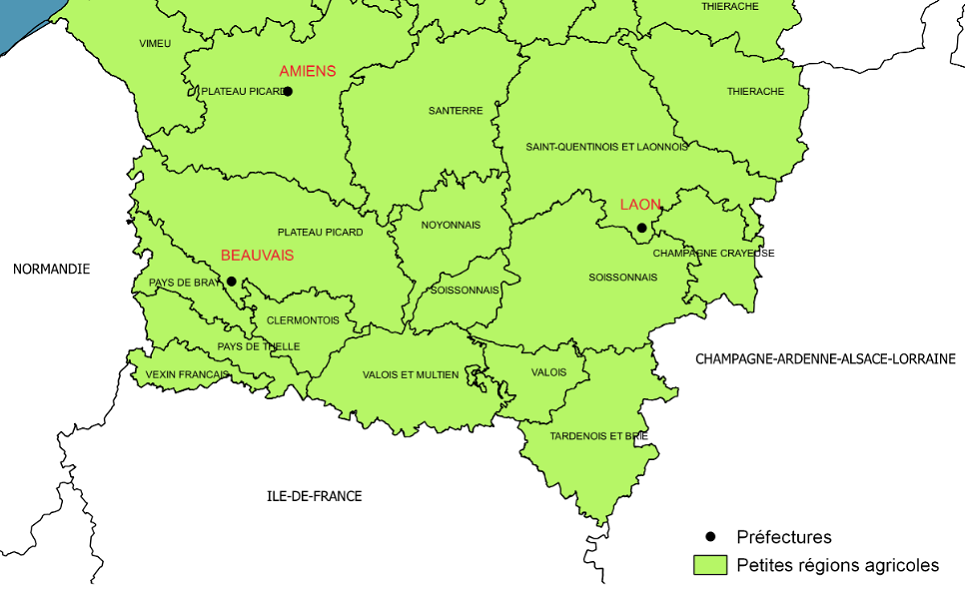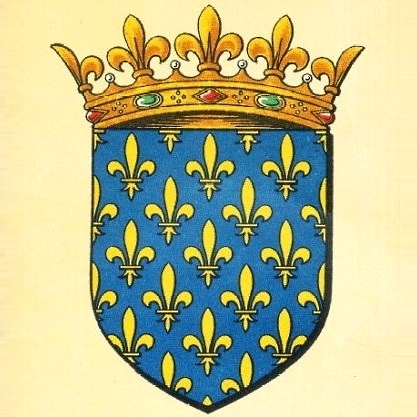Ces Pagi correspondent grosso
modo aux pays et régions naturelles du Soissonnais, du
Noyonnais et du Laonnois, parvenus jusqu'à nous. Ils sont de rattachement ancien
au domaine royal franc, dont ils constituent le cœur
historique. Ces trois pays feront par la suite partie, depuis sa création, de l'Île de France d'avant
1789, Île de France « historique
» ,
qui se veut
l’héritière de ce domaine royal
originel.
«
Il est digne de remarquer que les vieux états gaulois ont
conservé jusqu'à une époque
très voisine de
nous, leur nom, leurs limites et une sorte d'existence morale dans les
souvenirs et les affections des hommes. Ni les Romains, ni les
Germains, ni la féodalité, ni la monarchie n'ont
détruit ces unités vivaces ; on les retrouve
encore dans
les provinces et les pays de la France actuelle. »
Histoire des institutions
politiques de l'ancienne France, Fustel de Coulanges, 1875
|
Ces pays sont
également de la province ecclésiastique de Reims,
ou Belgique
Seconde du Moyen
Âge, qui constituerait
pour certains la Picardie « historique »,
d'avant le XVe siècle ...
L’élan vers
le sens
Il existe
chez l’homme un besoin sémantique, une
nécessité de chercher par tous
les moyens à donner un sens à ce qui lui arrive
et une croyance dans un
cours téléologique de l’histoire vers
un achèvement heureux.
Cette cohésion narrative exprime une unité
synthétique qui dépasse
chaque expérience individuelle et lui confère une
signification
collective. Le Geschichtschema implique un commencement et une fin,
mais aussi une trame narrative plus ou moins continue qui les relie.
Ainsi la réflexion téléologique fait
parler l'histoire dans le sens de
l'intérêt de la raison et plaque de
manière arbitraire sur la matière
multiple et sans cesse changeante de la vie humaine des
schémas
explicatifs réducteurs.
Essais
hérétiques, sur la philosophie de l'histoire, Jan
Patočka (1907-1977)
Penser
l’histoire : Eschatologie et
téléologie Bruce Bégout
L'eschatologie désigne la réflexion sur la
destinée de l'homme et du monde. La
téléologie, ou finalisme, est un courant
philosophique
qui explique un phénomène par un but final
postérieur à ce phénomène.
Qu'il s'agisse de la constitution du domaine royal, de l'expansion du
Vermandois, de la création de l'Île de
France ou de la Picardie, on va chercher dans
l'histoire, le présent ou l'avenir un sens à des
évènements.
|
Le
village actuel
de Quierzy se trouve pour l'essentiel rive gauche
de l'Oise, et donc dans le
Soissonnais, qui s'étend entre Oise, Ailette,
Vesle, Petit-Morin et Automne. Soissons se situe
à 30 kilomètres au sud-est de Quierzy.
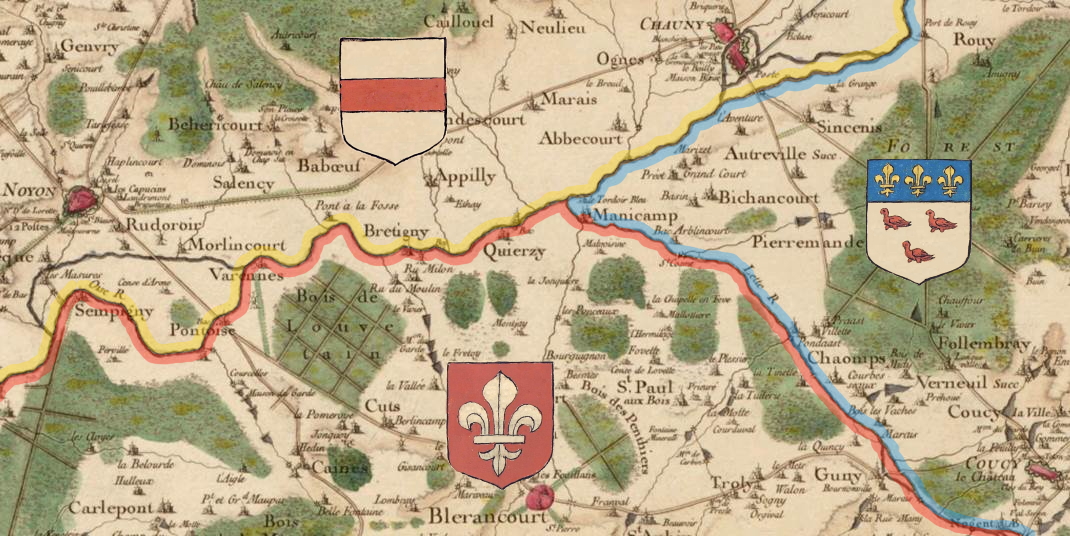
Noyonnais, Soissonnais et Laonnois, limtes naturelles
autour de Quierzy représentées sur la carte des
Cassini
(1756-1815), après la modification
du cours
de l'Ailette de 1690, avec les armoiries de Noyon, Soissons et Laon de
La Description des Provinces et Villes de France, Pierre de La Planche,
1669 |
|
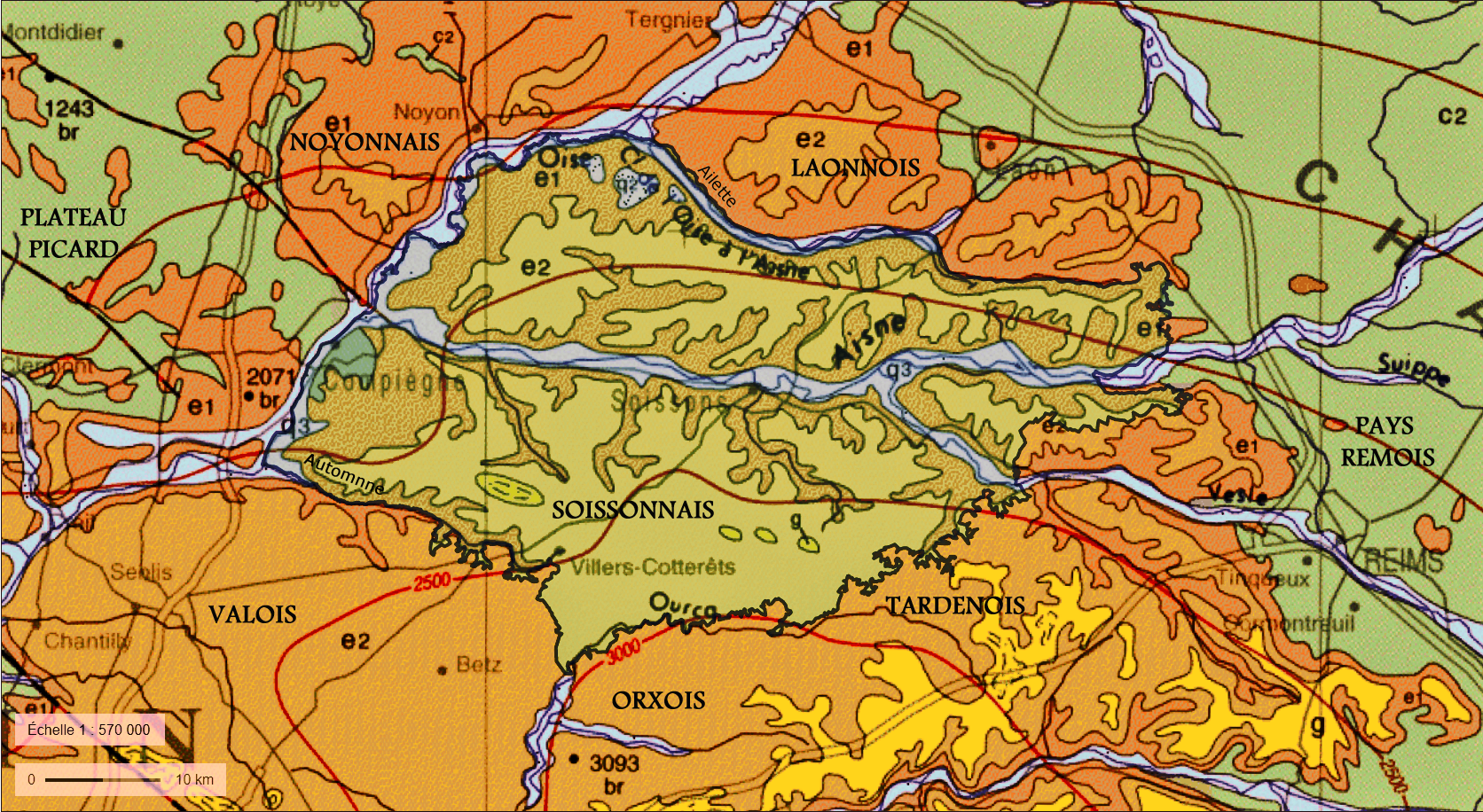
Région naturelle du Soissonnais
Carte Fdouchet, 2017 / Géoportail BRGM
|
Le
fond du blason
soissonnais est
avant 1819 « de gueules »,
c’est-à-dire rouge. Ce blason est alors
identique à celui de Lille. Le champ devient «
d'azur » après accord du maire de
Soissons par lettre du 24 octobre 1818 et ordonnance
du roi Louis XVIII du 3 février 1819.
Le
Soissonnais, cœur historique du domaine royal franc
et pays de
l'Île-de-France originelle
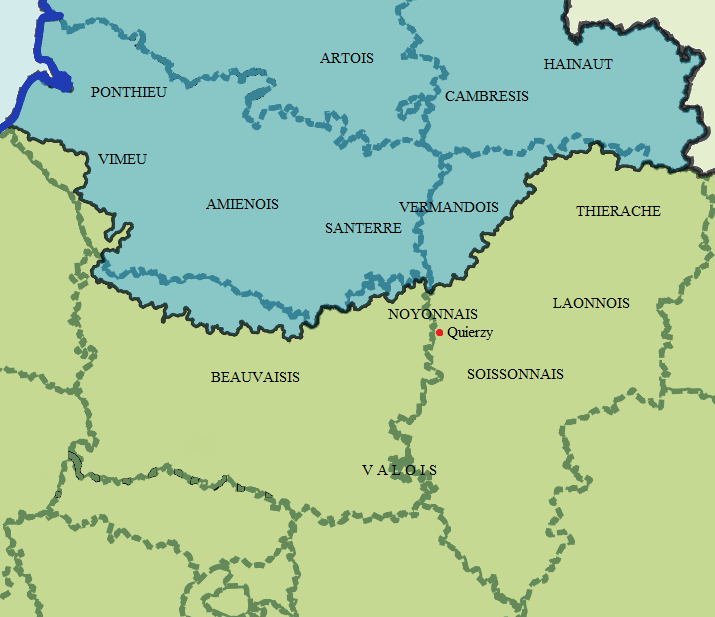 Sous
les Mérovingiens, le Soissonnais, le Noyonnais et le
Laonnois
sont érigés en comtés (ou pagus) et
évêchés. A la période
féodale, tout
ou partie de ces territoires tombent sous le pouvoir des
seigneurs du Vermandois, profitant de l'affaiblissement
du pouvoir royal. Sous
les Mérovingiens, le Soissonnais, le Noyonnais et le
Laonnois
sont érigés en comtés (ou pagus) et
évêchés. A la période
féodale, tout
ou partie de ces territoires tombent sous le pouvoir des
seigneurs du Vermandois, profitant de l'affaiblissement
du pouvoir royal.
En
1185, Philippe Auguste, s'empare des comtés de Vermandois,
d'Amiens et de Valois, les réunit à la couronne
de France et y installe des baillis, sauf dans le
comté d'Amiens (rive sud de la Somme) uni au
domaine
royal, qui disparait sous l'autorité directe du roi. Le siège du
bailliage
de Vermandois est établi à Laon. A cette
brève période de renforcement du pouvoir royal et
de relative prospérité de l'économie
correspond également la construction des
premières cathédrales gothiques, manifestation de
ce pouvoir, à Sens, Noyon, Senlis, Laon, Paris, Amiens,
Beauvais ... sur le domaine royal, dont la limite nord est celle de
l'ancien comté d'Amiens ; la rivière Somme.
Le
territoire du
bailliage de Vermandois, qu'il faut distinguer du comté de
Vermandois (le Saint-Quentinois ou haute vallée de la
Somme),
est connu à travers la Coutume
de Vermandois,
qui survivra jusqu'à la révolution. Dans sa
rédaction du XVIe siècle, cette coutume avait
pour
étendue d'application les bailliages et
prévôtés de Laon et de Soissons, ainsi
que les
territoires dépendant des coutumes particulières
de
Ribemont, Saint-Quentin, Noyon et Coucy. Apparues sur tout le
territoire du royaume à partir du XIème
siècle,
les coutumes correspondent à l'émiettement de
l’autorité royale au profit du pouvoir
seigneurial.
En 1435, le Vermandois est démembré par le
Traité
d'Arras, qui cède certaines « Villes de la Somme
»,
dont Saint-Quentin, aux Bourguignons. Ce traité de paix
ramène la frontière nord du domaine royal
à ligne
de partage des eaux Seine-Oise / Somme.
Après 1482 et le retour à la France des places
fortes de la Somme, on constitue autour de l'Artois resté
bourguignon puis espagnol, une ceinture défensive sur cette
nouvelle frontière, regroupant divers teritoires : Boulogne
en
partie, Ponthieu, Amiens, Saint-Quentin, Guise, à laquelle
on
donne le nom de
« gouvernement militaire de Picardie ». Aucun
territoire n’a porté le nom de Picardie auparavant
: « Le pays de
Picardie est un nom général, on ne trouve point
dans l'Histoire aucun Seigneur qui en ait jamais porté le
titre » indique Pierre de La Planche, La
Description des Provinces et Villes de France, Du Gouvernement de
Picardie, Livre Second, 1669. En l'absence de délimitation
officielle précise, ce qui est courant à une
époque où l'arbitraire est la règle,
les cartographes contemporains de la période
hésitent parfois. C'est principalement durant cette
période d’opérations militaires, que
jusqu'en 1624, certains cartographes
représentent parfois le Vermandois, la Thiérache,
le Beauvaisis, le Noyonnais, le Laonnois, ...
intégrés en tout ou partie dans cette ceinture
défensive. Aucun texte officiel ne semble venir confirmer
ces
représentations, pourtant largement reprises.
Au nord du Soissonnais, seule la
vallée de la Somme, dont Saint-Quentin, de retour dans le
domaine royal, est
intégrée au nouveau gouvernement. Depuis 1435, le
Vermandois stricto sensu désigne la haute
vallée de
la Somme.
En 1641, la France contrôle de nouveau l'Artois.
Au terme de cette sombre période de guerre (fin de la guerre
de 100 ans), Richelieu
met un terme à ces hésitations en confirmant
définitivement l'attachement du Beauvaisis, Soissonnais, du
Laonnois puis du du
Noyonnais
au gouvernement de
l'Île-de-France, dont la frontière naturelle au
nord
est celle de ses pays à savoir la ligne de partage des eaux
Seine-Oise / Somme, qui coïncide pratiquement avec la limite
sud du plateau crayeux entre Amiens et Beauvais. Devant la Flandre, qui
ne sera définitivement française
qu'après 1713, la Thiérache champenoise reste au
gouvernement frontière de Picardie.
Avant 1789,
le Soissonnais se distingue donc du Vermandois Saint-Quentinois depuis
1435, il est du gouvernement de l'Île-de-France depuis
l'apparition, à la fin du XVe siècle, de cette
structure,
fréquemment confondue avec la mythique notion non
officielle et discutée de province : Le terme
province laisse en effet supposer une certaine unification des
structures territoriales de l'ancien régime mais il
peut pour cette époque désigner aussi
bien les
anciennes structures féodales : duchés,
comtés, ... que les diocèses
ecclésiastiques, gouvernements
généraux militaires,
généralités administratives,
bailliages judiciaires, ... On note enfin que selon
l’ordonnance du 18 mars 1776, fixant le dernier
état des gouvernements avant 1789, Soissons constitue un
gouvernement général de première
catégorie (réservé aux princes de sang
et aux
maréchaux).
On
relève donc une confusion assez répandue qui
transforme en terre picarde, le Vermandois féodal,
constitué au sud de la
vallée
de la Somme selon les
meurs de l'époque par la ruse et la force. La « confusion » est donc
bien antérieure à
la création de la circonscription d’action
régionale de Picardie de 1960,
qui l'a réactivée parfois dans une forme
de nationalisme régional. Frank
Tétart
parle de régionalisme inclusif quand
l’objectif
est d’assimiler ou d’incorporer des territoires
culturellement distincts au sein d’une même
région, afin de rendre culturellement homogène
l’ensemble d’une population multiculturelle (Frank
Tétart, Les nationalismes «
régionaux » en Europe, facteur de fragmentation
spatiale ?). Cela semble décrire assez exactement
la situation dans
la circonscription
administrative
de 1960 constituée de
deux territoires pourtant bien distincts,
délimités par les vallées de l'Oise et
de la Seine, qui laissent en réalité la majeure
partie des départements
de l'Aisne et de l'Oise en dehors des limites naturelles, linguistiques
ou culturelles de la Picardie originelle de la
vallée de la Somme.
|
__________
De Gallia Belgica
Toute la Gaule est
divisée en trois parties, dont l'une est habitée
par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par
ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la
nôtre, Gaulois. Ces nations diffèrent entre elles
par le langage, les institutions et les lois. César, Guerre des
Gaules, I, 1
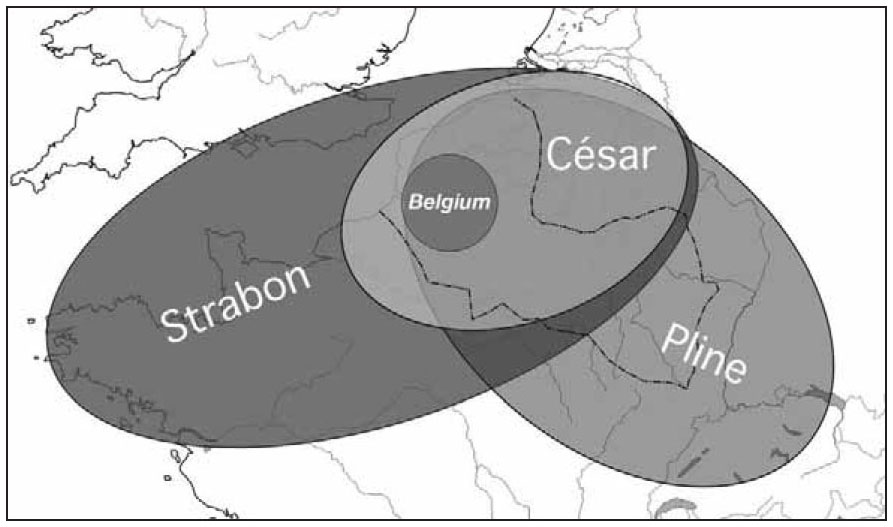
Les
trois visions de la Gaule Belgique
sur les limites de la fin du Ier siècle |
|
Trois auteurs antiques ont
dessiné la « carte » des territoires des
peuples belges : Jules César, qui en fixe les limites dans
son Bello Gallicum, Strabon, dont
l’étude est de peu
postérieure à la conquête
césarienne, et Pline l’Ancien, qui
s’est rendu sur le territoire belge et en décrit
les limites dans son Histoire naturelle.
Pour César, le territoire des Belges
s’étendait de la Marne et la Seine
jusqu’au Rhin. Les Belges représentaient le tiers
de la Gaule. Ce territoire était habité par 12
peuples dits « belges » et 10 peuples dits
« germains » : les Ambiens,
Atrébates, Atuatuques, Bellovaques, Cérosiens,
Calètes, Ceutrons, Condruses, Éburons, Geidumnes,
Grudiens, Lévaques, Ménapes, Morins, Nerviens,
Pémanes, Pleumoxiens, Rèmes, Sègnes,
Suessions, Véliocasses, Viromanduens.
César
établit des sous-divisions territoriales et ethniques dans
cet ensemble. Ainsi, il distingue une portion occidentale de la Gallia
Belgica, dénommé Belgium, où vivaient
les Ambiens, Atrébates, Bellovaques, Viromanduens, qui
pourrait être le domaine « ancestral »
des Belges (S. Fichtl, 1994). Les découvertes
archéologiques attestent une culture matérielle
spécifique qui définit cette
région.
|
L’existence
d’un cœur historique de la
Gaule Belgique, témoigne, de la cristallisation,
à la fin de l’Âge du
Fer, de sociétés complexes, avec des
identités supérieures au village.
Le Belgium est toutefois plus petit que les délimitations de
César,
Strabon et Pline. Dès lors, on peut penser que ces auteurs
ont essayé
d’élargir ce territoire en étendant le
nom d’une de ses parties à toute
la nouvelle division administrative, et ce afin de la
légitimer ...
Pour
Strabon, la
Gaule
Belgique était composée de 15 peuples –
bien qu’il en ait présenté davantage
–, dont le territoire s’étendait
d’ouest en est, du bord de l’Océan, de
la Loire jusqu’au Rhin et descendait vers le sud,
jusqu’aux Alpes. Pline décrit, quant
à lui, une Belgica romaine située entre
l’Escaut et la Seine, et 25 peuples qu’il
considère comme « belges », auxquels il
ajoute 4 peuples germaniques vivant sur l’ancien territoire
de la Gaule Belgique.
L’espace, le
territoire et la nation sont des constructions. Ce qui se
vérifie non seulement dans un passé
récent, mais aussi depuis les tout premiers moments de la
construction d’entités territoriales,
c’est-à-dire depuis l’aube de
l’humanité (cf. Ton Derks et Nico Roymans,
2009). Au vu des
différentes cartes, aucune des frontières
actuelles de ces anciens espaces – le Belgium, Gallia
Belgica, la Wallonie ou la Flandre, le Rhin, les territoires issus des
invasions germaniques ou franques, la Lotharingie et la Bourgogne
médiévales – ne trouve sa justification
dans le passé. Ainsi, pour ce qui est de créer de
nouvelles entités étatiques, à chacun
son credo. Difficile de fonder la légitimité
d’une politique sur des sables mouvants.
Le
manque de sources historiques disponibles pour
l’époque gauloise réduit en
réalité à extrapoler
l’assise du territoire des Belges à partir des
découpages postérieurs. Aussi, ces limites
territoriales, comme pour la plupart des peuples de la Gaule, sont
définies de façon théorique
à partir de la cartographie des diocèses
antiques, ceux-ci étant considérés par
les historiens comme émanant des limites des
cités gallo-romaines. Le vaste territoire qui
découle de cette analyse régressive se
caractérise par sa grande diversité.
Le nom est tout d’abord repris par Auguste pour une des
quatre provinces de la Gaule romaine, organisée en Gaule
Belgique, Gaule Lyonnaise, Gaule Aquitaine et Gaule Narbonnaise. La
province augustéenne de la Gaule belgique était
délimitée au sud par la Seine et la Marne et
s'étendait jusqu'au Rhin ; elle englobait les
cités mosellanes des Leuques, Médiomatriques et
Trévires, les Rèmes, les Suessions, les
Bellovaques, les Véliocasses, ...
Cette
première province est
à son tour divisée en 297 sous
Dioclétien en Belgica Prima
ayant pour capitale Augusta Treverorum (Trèves) et en
Belgica Secunda ayant pour capitale Durocortorum (Reims). La Belgique
Seconde gallo-romaine compte douze Cités, qui constitueront
les douze diocèses de la province ecclésiastique
franque de Reims (voir ci-dessous).
Cette
appellation disparait pratiquement après les
grandes
invasions et ne
subsiste que sous la plume de quelques ecclésiastiques, qui
semble désigner alors la province
ecclésiastique de
Reims. La Belgica réapparait à
la seconde
moitié du IXe siècle après la scission
de l'empire de Charlemagne avec la création de la
Lotharingie. Les clercs de l'époque utilisent le
terme pour
désigner le royaume de Lothaire II
situé entre la Gallia de Charles le Chauve et la Germania de
Louis le Germanique.
Au sud de
l’Oise, la Gaule lyonnaise (Gallia Lugdunensis) donnera la Province
ecclésiastique de Sens. Le pagus gaulois des Meldi,
sur la Marne, qui donnera le territoire du diocèse de Meaux,
était de la Cité des Suessiones ?
Le pagus des Parisi donnera le pays de France. Suffragant de
Sénonaise jusqu'au XVIIe siècle,
l'évêché de Paris est pour sa part
transformé en archevêché en 1622 du
fait du rôle politique de la ville. L'archidiocèse
de Paris s'étend dès lors sur le pays de France,
le Hurepoix et la Brie française. L'abbé de
l'abbaye de Saint-Denis est gardien
des insignes royaux et de la nécropole royale, mais
les
évêques puis archevêques de Paris ne
participaient pas au cérémonial du sacre des rois
de France en la cathédrale de Reims.
Invention de la Picardie antique
Livre
de chevet de générations de
régionalistes, L’Introduction à
l'histoire générale de la province de Picardie de
Pierre Nicolas
Grenier (1725-1789),
alias Dom Grenier car il était ecclésiastique,
plante le
décor dès la première phrase : la
Picardie
s’étend de la Marne au Pas-de-Calais et de la
forêt
des Ardennes à la Mer océane, selon la
description
… de la Gaule Belgique par Jules César dans ses
Commentaires !
Ce territoire,
recouvrant donc le quart nord de la France hormis le
Parisis, est divisé par la suite en haute et basse Picardie
par
la rivière d’Oise. La haute Picardie serait
constituée par la Thiérache, le
Laonnois, le Soissonnais,
le Valois, le Senlisis, le Beauvaisis, la basse par
l’Amiénois, le Vermandois, … Quelle
époque ? Quelles sources ?
Dom
Grenier, sorte de Dom
Pérignon de la Picardie à la
légende
tenace,
l'invente par erreur. La
Gaule Belgique dont il est question ici n'est pas celle de
César mais plus probablement la Belgique Seconde du Moyen
Âge,
c’est-dire la province ecclésiastique de Reims,
que quelques
ecclésiastiques appellaient Belgica. La Gallia
Belgica
originelle a été séparée en deux au IIIe
siècle ; la Belgique
Première a donné la province
ecclésiastique de Trêves et la Belgique Seconde la
province
ecclésiastique de Reims.
Il est
donc curieux de regarder la province ecclésiastique
de
Reims sans y voir sa capitale « la cité des
rois » ou « cité des sacres »,
où
Clovis est baptisé par Saint Remi comme ensuite un grand
nombre
de rois carolingiens puis capétiens pendant plus de dix
siècles de Louis le Pieux en 816 jusqu'à Charles
X en
1825. Même
interrogation pour le Vermandois ayant le siège du
bailliage de à
Laon, le siège du diocèse à
Noyon. Quel
est le message au siècle des Lumières
où
l'église catholique est fortement attaquée ? La
démonstration d'un enracinement local propre ?
L'ouvrage de
Grenier constitue pour le reste une recherche,
à
contresens de l'histoire, d'une cohérence à cette
province
ecclésiastique de Reims qu'il appelle Picardie. C'est pourtant sur ces
affirmations que reposent
aujourd'hui encore nombre de théories : lorsqu’on
lit le
Soissonnais faisait « autrefois, depuis toujours,
traditionnellement, ... » partie de la Picardie, il
est fait référence aux territoires au
nord de la
Marne, Parisis excepté.
Ulrich
Beck, 2006 dénonce «
un nationalisme méthodologique » :
Au risque d’une simplification excessive, on pourrait se
demander si les auteurs appartenant aux nations concernées
par la division administrative romaine étaient en mesure
d’aborder la question de la Gaule Belgique de
façon objective ?
__________
La Civitas Suessionum
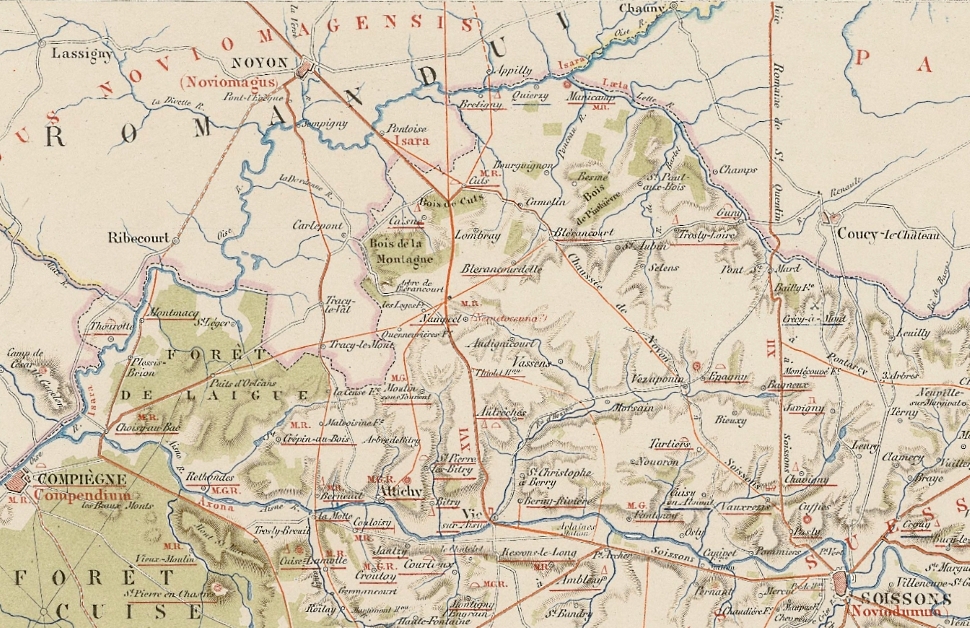
Cartes des Suessiones (Civitas Suessionum) par Stanislas
Prioux 1861, avec les amputations du Concile de 814 sur la rive gauche
de l'Oise
Cartes
des Suessiones (civitas Suessionum), Stanislas Prioux, 1861 - gallica.bnf.fr
La Civitas Suessionum gallo-romaine
s'étend de l'Oise
au nord au petit Morin au sud.
La
Civitas compte cinq pagi ou pays, correspondant chacun au
territoire d'un peuple particulier ou tribu :
· Le
Pagus Suessionicus ou Pays du Soissonnais (futur Comté de
Soissons),
· Le
Pagus Orcensis ou Urcisus ou Pays de l'Orxois,
· Le
Pagus Tardanisus ou Pays du Tardenois,
· Le
Pagus Vadensis ou Pays du Valois,
·
Le
Pagus Briegius ou Briegensis
ou Pays de Brie.
Selon
l'historien du 19e siècle Adolphe
Chéruel, le
pagus repose sur une distinction
naturelle du sol, sur sa configuration géologique ou
géographique. Les frontières du
Pagus Suessonicus et
de la région naturelle du Soissonnais sont donc assez proches : l'Oise
à l'ouest, l'Ailette au nord, l'Automne et l'Ourcq au sud.
Le
Pagus
Suessonicus, ainsi
délimité par quatre cours d'eau,
est entouré au Nord-Ouest, par le Pagus
Noviomagensis (Pays du Noyonnais), au Nord-Est le Pagus Laudunensis
(Pays du Laonnois), au Sud-Est le Pagus Tardensis (Pays du Tardenois),
au Sud-Ouest le Pagus Vadensis (Pays du Valois) et à
l’Ouest le Pagus Rossontensis (Pays de Resson).
|
A
la mort d'Auguste (en 14 ap. J.-C.), les Bellovaci, Ambiani,
Veromandui, Morini étaient comptés parmi les
civitates stipendiariae, peu autonome ; les Suessiones formaient une
civitas libera, plus autonome.
Le royaume de Soissons, dernier
territoire gallo-romain
Au Ve siècle, le nord de la Belgique seconde est envahi
par les Francs saliens (Clodion s’empare entre 440 et 460 du
Cambrésis
et de l’Artois méridional dont héritera
Clovis) tandis que le sud
relève du royaume romain de Soissons, tenu successivement
par les
généraux Aetius, Ægidius et Syagrius,
dotés du titre militaire de
maître de la milice des Gaules (magister militum per
Gallias),
c'est-à-dire commandant en chef des armées
romaines en Gaule.
Dans le même temps, le nord de la Belgique
première est occupé
par les Francs rhénans ou ripuaires et le sud par les
Alamans. La
Séquanaise (Besançon) est quant à elle
prise par les Burgondes.
Le domaine romain ne s'étend donc plus sur toute la Gaule,
il
est enclavé entre des royaumes germaniques en relation
d'allégeance
plus ou moins respectée vis-à-vis de l'empire :
les royaumes des
Wisigoths au sud-ouest, des Francs saliens au nord, des Alamans
à l'est
et des Burgondes au sud-est ; à l'ouest, ce sont les
territoires
contrôlés par les Bretons. Ce domaine
s'étend entre la Somme et la
Loire. Il est maintenu ainsi de l'époque d'Aetius vers 450
à celle de
Syagrius vers 480. Durant le règne de Syagrius, le domaine
gallo-romain
ne compte plus que les terres autour des cités de Noviomagus
Veromanduorum (Noyon), Augustomagus (Senlis) et Augusta Suessionum
(Soissons).
En 481, à l'avènement de Clovis, le royaume des
Francs atteint
donc les vallées de la Somme, l'Oise et la Meuse c'est
à dire le nord
des cités des Ambiens, des Viromanduens et des Remi, qui
sont du
Royaume de Syagrius (capitale Soissons) et dans lequel les Francs sont
déjà présents. Les cités de
Soissons, de Vermand et de Reims et leurs
pays du Soissonnais, du Noyonnais et du Laonnois appartiennent ainsi au
dernier domaine gallo-romain.
Sous le règne de Clovis, les Francs saliens,
installés comme
fédérés autour de Tournai, commencent
à descendre vers le sud sans que
Syagrius réussisse à les arrêter. En
486 à Soissons, les Francs
l'emportent et installent leur nouvelle capitale dans cette
ville.
|
Les cités
et pays dans
l'organisation administrative du royaume Franc
Dès 486, les cités de Soissons, de Vermand et de
Reims et leurs pays du Soissonnais, du Noyonnais et du
Laonnois conquis par Clovis après la Bataille de
Soissons
constituent le cœur du domaine royal mérovingien
à l'origine de l'Île de France
capétienne. Soissons est la première capitale des
Francs et les vallées de l’Oise, de la Somme et de
l’Aisne, deviennent l’épicentre du
pouvoir franc, qui doit s'appuyer sur l'église.
Fusion de différentes cultures, empreinte
de la romanité, héritage
chrétien et influence germanique, la
royauté mérovingienne conserve des structures
administratives romaines la civitas, circonscription de base qui va servir à
définir le comté, également
appelé pagus durant l'époque
mérovingienne, doté d'un chef-lieu, qui est aussi
souvent le siège de
l'évêché. A
la tête de cette circonscription, le comte, un prince
à l'origine, souvent
originaire de la région qu'il administre, provient de
l'aristocratie locale dont les intérêts propres
peuvent aller à l'encontre de ceux de la royauté.
Egalement souvent issu de l'aristocratie locale,
l'évêque est un personnage politique de premier
plan, il jouit du soutien d'un réseau puissant et
gère un patrimoine foncier parfois
conséquent.
Les divisions
ecclésiastiques du territoire qui voient le jour
sont également calquées sur l'organisation romaine.
A
la fin du Ve
siècle, les
frontières naturelles
de la Civitas et du Pagus donnent les limites du
diocèse et de l’archidiaconé, dans
lequel le doyenné (decanatus)
regroupe plusieurs paroisses. Autour de Quierzy, apparaissent les
diocèses de Soissons, de Noyon (531) et de Laon, qui
survivront sans
grand changement jusqu’à la révolution.
Les diocèses ecclésiastiques donneront
également les
diocèses civils,
comtés, duchés, ...
La Belgique Seconde au Moyen Âge ou Province
Ecclésiastique de
Reims
Les
douze diocèses de la province ecclésiastique
franque de
Reims d'avant
1559 semblent
calqués sur
les
douze Cités de la Belgique Seconde gallo-romaine (du nord au
sud) :

|
|
-
Cité
des Morins, chef-lieu : Tarvenna
(Thérouanne)
- Cité des Ménapiens, chef-lieu
de cité :
Castellum Menapiorum (Cassel)
- Cité des Nerviens, chef-lieu de
cité : Bagacum Nerviorum (Bavay)
- Cité des Atrébates, chef-lieu
de cité : Nemetacum (Arras)
- Cité des Ambiens,
chef-lieu de cité : Samarobriva
(Amiens)
-
Cité
des Viromanduens,
chef-lieu Augusta Viromanduorum (Vermand / Saint-Quentin)
- Pays
du Laonnois, Cité
des Rèmes
-
Cité
des Rèmes,
chef-lieu Durocortorum
(Reims), capitale
de la Gaule Belgique
-
Cité
des Bellovaques,
chef-lieu de cité : Cæsaromagus (Beauvais)
- Cité des Silvanectes,
chef-lieu Augustomagus (Senlis)
-
Cité
des Suessions,
chef-lieu Augusta Suessionum (Soissons)
- Cité des Catuvellauni,
chef-lieu Catalaunum (Châlons-en-Champagne) |
|
- Diocèse
de Thérouane
- Diocèse de Tournai
- Diocèse de Cambrai
- Diocèse
d'Arras
- Diocèse
d'Amiens
- Diocèse
de Noyon
- Diocèse
de Laon
- Diocèse
de Reims
- Diocèse
de Beauvais
- Diocèse de Senlis
- Diocèse de
Soissons
- Diocèse de
Châlons-en-Champagne |
<
On détermine
les territoires des Nerviens entre Meuse et Escaut exclu, des
Atrébates dans le bassin de la Scarpe, des Morins sur la Lys
supérieure (Pas-de-Calais),
des Ménapiens
sur la Lys inférieure entre la côte et
l’Escaut inclus.
|
Atlas historique de la France depuis
César jusqu'à nos jours, Auguste Longnon, 1907
|
|
|
Comme la Belgique Seconde, la province
ecclésiastique de Reims a pour capitale
« la cité des rois » ou «
cité des sacres », où Clovis est
baptisé par
Saint Remi comme ensuite un grand nombre de rois carolingiens puis
capétiens pendant plus de dix siècles de Louis le
Pieux en 816 jusqu'à
Charles X en 1825.
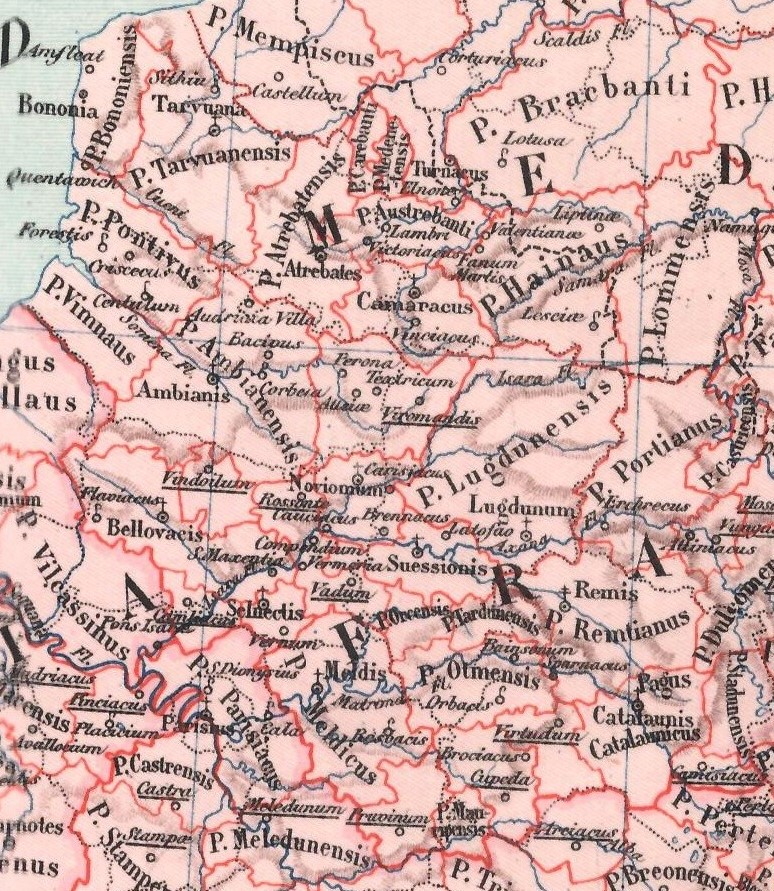
La Gaule à
l'arrivée de César,
Auguste Longnon, 1907
|
|
Le partage de 511
coupe en trois la Belgique Seconde. Le
Royaume de Soissons comprend les diocèses de
la Province de Reims excepté les diocèses de
Beauvais et Amiens qui font partie du Royaume de Paris, ainsi que les
diocèses de Châlons et Reims qui
font partie du Royaume de Reims.
Diocèses du Royaume de Soissons
:
- Diocèse de Thérouane
- Diocèse de Tournai
- Diocèse de Cambrai
- Diocèse d'Arras
- Diocèse de Noyon
- Diocèse de Laon
- Diocèse de Senlis
- Diocèse de Soissons
Les rois Francs créent pour
administrer leur territoire les
comtés et duchés
à partir des diocèses gallo-romains et y
éparpillent des
préposés aux attributions de plus en plus
étendues, qui deviennent peu
à peu inamovibles. La force et la ruse constituent alors le
droit. Le
Soissonnais est limité, au nord, par le Laonnois,
lié à la Champagne,
au sud-est, par le Tardenois, au sud-ouest, par l'Orxois, au sud, par
la Brie et au Multien. Le comté de Soissons ne
coïncide donc pas avec le Soissonnais.
Le Vermandois
comprenant le pays des
Veromandui au nord et le Noyonnais au sud. |
|
Les six pairs
ecclésiastiques primitifs du royaume de France
La pairie est l’ensemble
des pairs de France, titre donnant accès au conseil
du roi, accordé à l'origine aux douze
principaux seigneurs du royaume, six ecclésiastiques (trois
ducs et trois comtes) et six laïcs (trois ducs et trois
comtes). On peut en trouver l’origine dans
les douze pairs légendaires que la Chanson de Roland place
autour de
Charlemagne. Les pairs représentent les
électeurs
primitifs à la royauté à
l'époque où
la primogéniture n'est pas de règle, et assurent
la
dévolution de la couronne selon les lois fondamentales du
royaume, ainsi que le choix de la régence en cas de
minorité.
Au XIIIe
siècle, on reconnaissait douze pairies : trois
duchés-pairies laïques (Bourgogne, Normandie,
Aquitaine), trois
duchés-pairies ecclésiastiques
(archevêque de Reims, évêques de Laon et
de Langres), trois comtés-pairies laïques
(Toulouse, Flandre et
Champagne) et trois comtés-pairies
ecclésiastiques (évêchés de
Beauvais, Châlons et Noyon). À partir de 1297, le
roi procède à
l’érection de nouvelles pairies laïques,
et leur nombre augmente
progressivement ensuite.
Les six pairs
ecclésiastiques primitifs du royaume de France sont
ainsi l'archevêque-duc de Reims,
l'évêque-duc
de Laon, celui de Langres, l'évêque-comte de
Beauvais, celui de Châlons et celui de Noyon.
L'abbé de l'abbaye Saint-Rémi de Reims, gardien
de la Sainte Ampoule, et celui de l'abbaye de Saint-Denis, gardien des
autres insignes royaux et de la nécropole royale. Tous
siègent au nord-est du royaume.
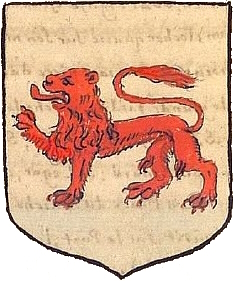
Armoiries d'Eu (Seine-Maritime)
D'argent
au lion passant de gueules
La
Description des
Provinces et Villes de France, Pierre de La Planche, 1669
On présente parfois les armes d'un
comte d'Eu (d'or au lion
passant de gueules), qui fut comte
de Soissons, comme celles du Soissonnais.
Les Comté et Diocèse de
Soissons
Le Comté de Soissons
des époques
mérovingienne et carolingienne trouve son origine dans la Civitas
Suessionum.
A la période mérovingienne, Soissons est à
plusieurs reprises capitale du royaume franc avant de revenir
vers 896
à Herbert Ier de Vermandois, seigneur de
Péronne et de Saint-Quentin, fils de Pépin (pour
qui le Vermandois
a été érigé en
comté par Louis Ier, fils de Charlemagne). Herbert
Ier hérite également des comtés de
Meaux
et du Vexin, ensemble formant une marche pour
lutter contre les Normands.
Le
Bailliage
et Comté de Soissons est
présenté au Chapitre VII de la célèbre
Description des Provinces et Villes de France de Pierre de
La Planche de 1669 dans son Livre I
consacré au
Gouvernement de l'Île de France.
__________
Le
Diocèse de Soissons d'avant 1789,
également
issu de la
Civitas
Suessionum, était
constitué de quatre
archidiaconés eux-mêmes
découpés en doyennés :
· Grand
Archidiaconé : Chrétienté
(Soissons), Vailly, Chacrise et Viviers.
· Archidiaconé de la
Rivière : Vic-sur-Aisne, Collioles, Berthisy et
Blérancourt.
· Archidiaconé de Brie
: Chatillon, Château-Thierry, Orbais, Chézy,
Dormans et Montmirail.
· Archidiaconé de
Tardenois : Bazoches, Oulchy, Neuilly, Fère.
Le
pays du Soissonnais correspond au Grand
Archidiaconé et à l'Archidiaconé de la
Rivière de l'ancien Diocèse de Soissons.
La
paroisse de Quierzy faisait alors partie du Diocèse
de Soissons,
Archidiaconé de la
Rivière, Doyenné
de
Blérancourt.
L'État
ecclésiastique et civil du diocèse de
Soissons, Pierre
Houiller, 1783 fournit
concernant
Quierzy les
informations suivantes :
Houiller
indique
" Vermandois, Gouvernement de
l'Île de France "
pour la partie du Diocèse de Soissons au nord de l'Aisne. Il
est question ici du bailliage de Vermandois qui a son
siège
à Laon.
A
la veille de la révolution, le Diocèse
de Soissons s'étend sur une partie de
l'Île de
France, de la Champagne
et de la Brie. Il comprend une partie du
bailliage de Vermandois, réuni
au Gouvernement de
l'Ïle de
France, outre une grande partie du Valois (Gouvernement de
l'Ïle de
France),
du Pays
d'Orxois, de la Gallevesse (Brie galeuse ), du Tardenois
et du comté de Senlis (Gouvernement de
l'Île de
France).
Siège
du
Royaume après 486, Soissons est
ensuite possédé par les
rois Clotaire, Chilpéric I, Clotaire II et ensuite
gouverné par des ducs, dont plusieurs Maires du Palais, puis
comté héréditaire d'abord
possédé
par les princes de Vermandois descendant de Pépin, puis Duc
d'Orléans depuis 1750. Soissons, qui faisait autrefois
(au XVIe siècle ?) partie
de
la « Picardie », en a été
démembré
et uni au Gouvernement d'Île de France. Soissons est la
capitale
du Soissonnois.
Prieuré
de Quierzy / Prior de Cherisy (dépendance
à Lihons), Ordre de Cluny (État
et carte du diocèse de Soissons d'après les
listes bénéficiales de la fin du XIVe
siècle, Louis Duval-Arnould
Mélanges de l'école française de Rome
Année 1973 85-1 pp. 159-266)
La paroisse de Quierzy sous
l'ancien
régime
Intendance
ou Généralité: Paris puis Soissons
(1595)
(principale
circonscription
administrative territoriale, divisée en
subdélégations. Le bureau des
finances est sous son autorité)
Election
ou diocèse civil (répartit les impôts)
: Soissons
Subdélégation et Direction : Soissons
Parlement (cour de justice): Paris
Coutume : Chauny
Bailliage ou sénéchaussée
(circonscription administrative, financière et judiciaire) :
Chauny
Présidial (tribunal d’appel des bailliages
ordinaires) : Laon
Diocèse
religieux :
Soissons
Archidiaconé de la
Rivière
Doyenné
de
Blérancourt
Paroisse :
Quierzy
|
|
Des territoires liés
au pouvoir royal
Au
gré des partages, successions, alliances de la
période féodale, les territoires des
diocèses de Soissons, de Noyon et de Laon
relèveront du roi, des comtes de Valois, de Vermandois, de
Champagne, de Guise, des sires de Coucy, ...
Liés au pouvoir royal sous les Mérovingiens et
Carolingiens, ces territoires ont pour centre de gravité :
- au sud les axes de l'Oise
vers la Belgique et le Rhin puis Paris, d'une part et de l'Aisne et de
la Vesle* vers la Champagne d'autre part,
- au nord,
l'axe de la Somme (Saint-Quentin, Amiens, Corbie). La basse
vallée de la Somme, plus éloignée de
la « métropole » de Reims
est tournée vers les échanges entre la
(Grande)
Bretagne via Boulogne et Lyon puis Paris.
Les conséquences linguistiques de ces différentes
considérations ne sont certainement pas
négligeables.
__________
* La Vesle relie Soissons à Reims par Fismes, confins sud du
Soissonnais.
La ligne de
partage des eaux entre deux bassins versants, constitue une limite
naturelle parfois invisible mais d’importance.
Il est important de maîtriser cette
énergie depuis sa source ... mais aussi d'en
éviter la pollution par un rival ... |
L'importance
considérable du
comté ecclésiastique de Noyon
Vers 530, Médard, qui avait vécu à la
cour
de Childéric Ier puis de Clovis à Tournai et
assisté l'évêque Remi de
Reims lors du baptême de Clovis, en 496, est nommé
par Remi évêque de
Vermand, près de Saint-Quentin. En 531, peut-être
après une dévastation
de Vermand par les guerres entre les rois
mérovingiens, Médard transfert
son siège épiscopal à Noyon, sans
doute plus aisé à défendre et plus
proche de la capitale royale de Soissons. En 532, à la mort
de l’évêque
de Tournai, sur la demande du roi Clotaire, Médard est
nommé par le
pape Hormisdas à l'épiscopat de Tournai, unifiant
ainsi le diocèse de Tournai
avec celui de Noyon, union qui durera jusqu'en 1146. Vers 1160,
l'Evêché
de Noyon est érigé en comté-pairie.
Cet évêché est en effet
étroitement lié à la
royauté franque : Charlemagne est sacré roi des
Francs à Noyon en 768 ainsi que Hugues Capet en 987.
Diocèse de Noyon,
primitivement de Vermand / Saint-Quentin,
transféré en 531 à Noyon, neuf
doyennés :
Noyon, Chauny, Vendeuil,
Saint-Quentin, Péronne, Athies, Curchy, Nesle, Ham.
Topographie
Ecclésiastique de la France, Jules Desnoyers, 1854
En 987 lorsque Hugues Capet est élu
roi à Senlis et sacré à Noyon,
même morcelé, le domaine royal,
possession directe du roi, peut toujours s'appuyer autour de
Compiègne (entre
Valois, Vermandois et Champagne) sur d'importants
évêchés dans le Soissonnais, le Noyonnais
et le Laonnois.
Vers 1160,
les évêques de Noyon et de Laon (ainsi que celui
de Beauvais)
deviennent vassaux directs de la couronne de France avec le titre de
pair de France. Leurs terres, attachées au domaine royal,
deviennent
intransmissibles. Ces territoires correspondent plus
au Noyonnais ou au Laonnois qu'au diocèse de
Noyon ou de Laon.
Au XIIe siècle, les grands ensembles territoriaux
environnant les comtés de Vermandois, de Valois et de
Montdidier (« la principauté
vermandisienne
»),
sont
les comtés de Flandre et de Hainaut au nord, celui de
Champagne au sud-est, le domaine royal capétien au sud, la
Normandie à l’ouest et Amiens au
nord-ouest.
Le XIIe siècle voit également
l'arrivée de colonies de Flamands, que les
troubles politiques de leur pays font refluer jusque dans les
plaines de la Somme, apportant un
élément précieux d'activité
et de prospérité; la fabrication des draps et
étoffes de laine. Les villes « drapantes
» de la Somme, Abbeville, Amiens, Péronne, etc.,
rivalisaient avec celles des Flandres. Ce développement est
à l'origine d'une classe d'artisans nombreuse
et organisée qui explique
l'élan avec lequel les villes se jetèrent dans le
mouvement d'émancipation communale contre le
despotisme seigneurial (commune de Noyon, 1108 ; Saint-Quentin; Amiens,
1113-1117; charte de l'abbaye de Saint-Riquier, 1126; commune du Ham,
antérieure à 1142; Corbie, 1180; Abbeville, 1184,
etc.). Les révoltes que provoqua ce
mouvement d'affranchissement nécessitent
l'intervention fréquente des rois de France.
Dans le même temps, les querelles sont
incessantes entre le comté de Laon, les sires de Coucy, le
comté de
Champagne, de Guise, de Vermandois jusqu'à la
réunion de ce dernier comté à la
couronne, en 1185-1191. On
multiplie aussi à cette
époque
les structures : création
des bailliages au XIIe siècle sur le
domaine royal, notamment par Philippe Auguste. D'abord très
étendues, l'abus qu'ils firent de leur puissance
obligea les rois à la réduire et au XVIe
siècle, le rôle du « bailli »
était devenu honorifique.
La coutume de
Vermandois - Son étendue d'application
Si on veut
rechercher comment les choses se sont
particulièrement passées pour la Coutume de
Vermandois, on peut dire que, comme première
et
plus ancienne province de la France, le Vermandois a
retenu les
anciennes coutumes générales ; les comtes et
seigneurs qui y ont dominé ont fait de nouveaux statuts pour
les villes ou confirmé leurs usages primitifs : telle fut la
loi dite de Vervins ou de la Bassée, due à un
seigneur de Vervins ; telle fut encore l'ordonnance appelée
« La paix de la Fère », faite par un
Enguerrand de Coucy ; d'autre part, les rois ont agi de même
pour les villes qui leur sont venues par droit de réversion,
composition ou autrement : c'est ce que justifient les chartes des
communes de Saint-Quentin, Péronne, Chauny et autres ; enfin
certaines institutions du droit romain se sont maintenues à
travers les siècles et sont devenues des articles de notre
Coutume.
Avant d'aborder l'étude de la Coutume de
Vermandois, il est indispensable de savoir autant que possible quelle
fut son étendue d'application.
En premier lieu, il faut
distinguer le comté et le bailliage de Vermandois :
Un pays
appelé Vermandois, et situé au nord-ouest de la
Thiérache, autour des sources de la Somme, fut
érigé en comté par Charlemagne en
faveur de son deuxième fils Pépin ; il avait pour
villes principales Saint-Quentin (Augusta Veromanduorum), Vermand, Ham
(Hametum ou Hamum), Saint-Simon, le Câtelet. Ce
comté devint la propriété de Bernard,
roi d'Italie et fils de Pépin, puis passa entre les mains
des comtes qui lui succédèrent. Sous le
règne de Philippe-Auguste, il appartenait au comte de
Flandres ; le roi de France fit la guerre à ce dernier, et
en 1215 le comté de Vermandois fut réuni
à la Couronne.
Philippe-Auguste
établit un grand
bailli (le premier de la France) pour gouverner le pays et
pour y
rendre la justice ; il ordonna que
ce bailli tînt son
siège dans la ville de Laon. Comme nous voulons
étudier la Coutume de Vermandois telle qu'elle fut
rédigée au XVIe siècle, en 1556, c'est
aussi à cette époque que nous nous placerons pour
rechercher sur quelles villes, sur quels territoires
s'étendit son empire. Mais il parait impossible de donner au
Vermandois, envisagé de cette façon, des bornes
fixes et des limites précises ; c'est malheureusement par
une sèche et aride énumération de
villes, villages et hameaux qu'il faut procéder, car parfois
des villages, enclavés de tous côtés
par des territoires soumis à la Coutume de Vermandois,
ressortissaient d'une autre coutume, et parfois la Coutume de
Vermandois s'étendait sur des pays voisins qui semblaient
géographiquement devoir être soustraits
à son autorité.
La Coutume de Vermandois, dont
nous ne voulons donner qu'un aperçu bref et
général, comprenait les bailliages et
prévôtés de Laon et de Soissons, ainsi
que les territoires dépendant des coutumes
particulières de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon et Coucy.
Ainsi, les bailliages et prévôtés de
Laon et de Soissons et les territoires dépendant des
coutumes particulières de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon et
Coucy étaient soumis à la Coutume
générale de Vermandois chaque fois que les
dispositions de ces coutumes particulières ne se trouvaient
pas en contradiction avec celles de la coutume
générale.
Essai
sur la Coutume de Vermandois, M. Tronquoy, Bulletin de la
Société Archéologique de Vervins, Tome
douzieme 1887
Toujours Grenier dans
son Introduction ... relève pour sa
part, sur le territoire de la Gaulle Belgique qu'il étudie
et appelle Picardie, l'existence de trois coutumes, dans un chapitre
consacré au « Gouvernement féodal divisé deux grands
baillages » (pages
6 à 11) : le bailliage d'Amiens et celui de Vermandois, ce
dernier demembré pour former celui de Senlis. S'attardant
principalement sur des hypothèses concernant les ressorts de
ces
baillages, il conclut sans surprise que l'Artois se confond avec la
Picardie et
« Pourquoi
ne pas dire la même chose du Senlisis, du Valois, etc. ? » :
« Charles
V, jugeant qu'il est important de corriger certains abus que ses
officiers commettaient dans l'exercice de leurs charges,
députe,
le 6 avril 1374, les mêmes commissaires avec le titre de
réformateurs dans les diocèses d'Amiens, de
Soissons, de
Noyon, de Beauvais, de Laon, de Thérouane, de Tournai.
Peut-il
donc résulter de cette identité de
privilèges
confirmés, de charges ôtées, d'abus
réformés autre chose, sinon que ces trois
baillages sont
à l'origine de province de Picardie. » Ces trois baillages les seuls
étudiés par Grenier ! De quelle
province est-il question ?
|
1435,
démembrement du puissant bailliage de Vermandois lors de la
cession des « Villes de la Somme »
Le bailliage de
Vermandois réunissant les
pouvoirs judiciaire,
administratif et militaire fut établit par Philippe-Auguste.
L'expansion du
Vermandois culmine alors dans la vallée de l'Oise
au nord du
Soissonnais et
du Laonnois notamment,
bien
au-delà de ses frontières naturelles de la haute
vallée de la Somme.
Après 1185, le comté
d'Amiens, uni au domaine royal, disparait et passe sous
l'autorité directe du roi avant de revenir un temps
au Vermandois.
Le Vermandois
sera démembré
en 1435 par le Traité d'Arras qui cède certaines
« Villes de la Somme », dont Saint-Quentin, aux
Bourguignons.
Ce traité de paix ramène ainsi la
frontière nord du
domaine royal à celle de l'Île de France d'avant
1790 (ligne de partage des eaux Somme-Oise).
Certains croient voir dans ces premières mentions des places
fortes de la Somme, une des origines possibles de la «
Picardie
», au moment où ces territoires
défensifs sont pour
un temps séparés du domaine du roi auquel ils
sont unis
depuis 1185 ! Le traité de paix de 1435, par lequel Charles
VII
cède certaines Villes de la Somme (le Ponthieu reste anglais
jusqu'en 1477) à Philippe III de Bourgogne, qui renonce en
contrepartie à son alliance avec les Anglais, permet
principalement le recul dès lors inexorable des Anglais. La
guerre de Cent Ans prend fin en 1453. Louis XI rachète ces
places à Philippe le Bon de Bourgogne en 1463, le
traité
de Conflans, les rend aux Bourguignons en 1465, Louis XI les reprend
après la mort de Charles de Bourgogne en 1477, puis de celle
de
sa fille Marie en 1482 ...
Cette appellation commune et ces brefs soubresauts ne gomment en rien
la disparité des territoires historiques du bassin de la
Somme,
marche du domaine royal aux frontières d'Artois et de
Flandre,
issue des Civitas
Ambianensium à l'ouest et Civitas Viromanduorum
à l'est : le Ponthieu y compris le pays de Montreuil, la
seigneurie ecclésiastique de Saint-Riquier, le Vimeu, la
seigneurie ecclésiastique de Corbie, l'Amiénois,
le
Santerre et le Vermandois (pays du Saint-Quentinois). Au sein de cet
agrégat de terres féodales de statuts divers, il
n’existe aucun sentiment « régionale
» comme
il n’existe pas encore à cette période
de sentiment
national. Ces pays diffèrent par la langue, le droit, les
institutions, ... comme partout au royaume de France. L'appellation
« Picardie » qui succèdera à
celle de «
Villes de la Somme » ne rend plus compte de cette
diversité.
Ce premier ensemble était donc déjà
lui-même
constitué par une juxtaposition de pays ne
présentant
entre eux que des liens administratifs : le Calaisis, avec ses plaines
alluviales uniformément plates, ses côtes basses
et
sablonneuses; le Boulonnais, fragment de l'auréole
jurassique du
bassin parisien qui se termine sur la côte en roches
blanchâtres, pays au sol argileux, domaine du
pâturage et
de l'élevage, encadré à l'Est, et au
Sud par des
terres crayeuses et arides; vers l'embouchure de la Somme, c'est le
Marquenterre, véritable polder converti en herbage, qu'un
cordon
de dunes protège contre l'envahissement de la mer; la
vallée de la Somme, humide, tourbeuse, bordée
d'hortillonnages, jardins maraîchers et fruitiers
coupés
de canaux, jalonnée de villes industrielles, est le
cœur
même de la région; de chaque
côté de la
vallée s'étendent de grands plateaux crayeux,
bas,
ondulés, coupés de vallons secs aux flancs
inégaux, dépourvus d'arbres; seuls quelques
mamelons
argilo-sableux, lambeaux épars de terrains
cénozoïques entre Péronne et Montdidier,
portent de
beaux bois; du côté de l'Est, dans le Vermandois,
où les sources de la Somme avoisinent celles de l'Escaut et
de
la Sambre, le pays est plus sec encore, comme dans l'Artois, par suite
de la prédominance du terrain de craie; plus loin,
au-delà de la vallée de l'Oise, la
Thiérache,
rattachée par Richelieu, contraste avec ses coteaux aux
formes
adoucies, où l'affleurement des marnes entretient une
couverture
verdoyante de pâturages et de forêts.
Les marches aux «
frontières d'Artois et de Flandre
» des XIVe et XVe siècles
Dans
le détail, et à nouveau selon les
recherches fournies de Grenier dans L’Introduction à
l'histoire générale de la province de Picardie,
abondamment
recopiée, au moment de
leur apparition, tant la marche aux « frontières
d'Artois et de Flandre
» du XIVe siècle que le « gouvernement
militaire de Picardie » du XVe
siècle, ne comprenaient pas le Beauvaisis, le Valois, le
Soissonnais,
le Laonnois, le Noyonnais.
Une
marche est un district militaire établi au voisinage
d'un pays
ennemi, ayant à sa tête un gouverneur. Telle est
la nature de ces deux
circonscriptions devant l'Artois et la Flandre, aux mains des
Bourguignons puis des Espagnols jusqu’au XVIIe
siècle. Grenier utilise
le terme gouvernement.
Le
district militaire du XIVe siècle
était
« composé
des bailliages
d'Amiens, Lille et Douay, qualifiés frontières
d'Artois et de Flandre.
Dans les lettres des premiers
lieutenants-généraux et gouverneurs de la
province, leurs provisions et les Chroniques de Jean Froissart, la
Picardie se limitait à ce qui était
au-delà de la Somme. » La rivière
Somme constitue en effet la frontière nord du royaume de
France depuis
la réunion du comté d'Amiens au domaine royal en
1185.
Le
district militaire du XVe siècle
était pour sa
part constitué autour
des « villes de la Somme », ce qui avance sa
frontière sud sur la ligne
naturelle de partage des eaux Somme - Oise, voisine de la limite sud du
plateau crayeux, qui ne s’appelle pas encore picard. Sans
doute du fait
de sa nature, mais aussi de la confusion avec
l'antique Belgica,
ce district militaire connait différentes
représentations cartographiques au XVIe
siècle, peut-être au gré des
opérations militaires ?
Il s’agit ici d’hypothèses. Quoi qu'il en soit, au XVIIe
siècle, le district
militaire est représenté au sud sur
ses limites naturelles
initiales du XVe siècle.
Grenier lui-même (pages 2 à 6) reconnait que le
gouvernement militaire de Picardie du XVIIIe siècle
« ne renferme
que
l’Amiénois, le Ponthieu, le pays reconquis, le
Santerre, la Tiérache,
le Vermandois et le Vimeux ; mais il n’est pas moins vrai que
le
Beauvoisis, le Laonnois et le Noyonnais faisait encore partie du
gouvernement de cette province au XVIe siècle
» avant de conclure « que le
gouvernement militaire de cette province a essuyé trop de
révolutions pour pouvoir servir de division à la
vraie Picardie ».
|
Création
des grands
gouvernements
militaires ou gouvernements
généraux : tout d'abors quatre grands gouvernements
militaires aux
frontières
A la fin du Moyen Âge, l'autorité
royale se renforce contre les grands feudataires. Les grands
gouvernements
militaires ou gouvernements
généraux sont
créés afin notamment de limiter les
pouvoirs des baillis en
confiant leurs pouvoirs militaires à de hauts personnages de
la famille
royale et de la cour. C'est sous Louis XI puis
François Ier, que la défense du
royaume est organisée avec quatre grands gouvernements
militaires correspondant aux quatre grandes
frontières :
Pays-Bas
bourguignons-espagnols, Allemagne, Italie
et Espagne.
Ces quatre gouvernements frontières de
Picardie, de
Champagne, de
Piémont et de Guyenne sont dotés des premières troupes
régulières formées par la France, « les bandes
françaises », mises sur pied sur le modèle de
bandes suisses,
qui firent merveille à Nancy en 1477. Affectées à
chacune
des quatre frontières du royaume, ces bandes donneront
naissance, au
XVIe siècle, aux « Quatre Vieux », qui
sont les
plus anciens régiments d'infanterie de
l'armée
française : le Régiment de Picardie, le
Régiment de Champagne, le Régiment de Navarre et
le Régiment de Piémont. Ces
différentes unités doivent leur
nom à leur lieu affectation - la
frontière concernée - plus qu'à
l'origine géographique de leurs troupes, venues de
tous les horizons
(francs-archers, aventuriers, pionniers fournis par
les villes, anciennes compagnies de cavalerie, vieux soldats
suisses, ... réunis en 1480 au camp du Pont de
l'Arche, dans l'Eure et envoyées dans le gouvernement de
Picardie en 1483).
Les
campagnes militaires contribuent également à la
diffusion du français, langue officielle du royaume
à partir de 1539 (ordonnance de
Villers-Cotterêts), utilisé de longue
date comme langue
véhiculaire par les couches supérieures de la
société et
dans l'armée royale qui,
lors des croisades, le porta en Italie, en Espagne, à
Chypre, en Syrie, à Jérusalem, ... Le
français prend alors le pas sur les autres
langues
d'oïl (orléanais, champenois, angevin, bourbonnais,
gallo, picard, etc.) et s'infiltre dans les principales villes du
royaume. Au fur et à mesure que s'affermit le domaine royal
et la centralisation du pouvoir, la langue du roi de France gagne du
terrain mais, pour quelques siècles encore, le latin garde
ses prérogatives à l'écrit et dans les
écoles pendant que les « patois »
restent l'apanage à l'oral des classes populaires dans
presque toute la France.
Le gouvernement frontière dit de
«
Picardie »,
une ceinture défensive autour des Flandres et de l'Artois
bourguignons

|
|
Profitant de la mort
de Charles de Bourgogne en 1477, puis de celle de sa fille Marie en
1482, Louis
XI parvient à reprendre possession de terres
qui étaient devenues bourguignonnes cinquante ans plus
tôt : comtés de Boulogne et de Ponthieu, « Villes de la Somme
».
On
s'empresse alors de constituer un glacis défensif ceinturant
l'Artois, les
Flandres, le Hainaut français, le Cambrésis,
restés « bourguignons », qui protègera Paris
et le royaume jusqu'au retour à la France de Calais en 1558 et de
l'Artois en
1559.
On
donne rapidement le nom de gouvernement militaire dit de « Picardie
» à cette ceinture
défensive qui suit la
côte boulonnaise, la
vallée de la Somme et la haute vallée de l'Oise
à travers différents
territoires hétéroclites,
issus de ce premier démembrement des
«
Pays-Bas bourguignons » (comtés de Boulogne et de Ponthieu, « Villes de la Somme
»,
dont Saint-Quentin, partie au nord-ouest du remuant comté de
Vermandois-Guise). Cette juxtaposition est
principalement militaire
et de
circonstance
(affirmation de l'autorité royale) mais certains
régionalistes cherchent
depuis à
y imposer une cohérence à
défaut de véritable unité ...
|
« Les limites des gouvernements
généraux qui se
partageait le territoire de la France en 1789 étaient mal
définies et, dans certains cas,
n’étaient pas
définies du tout. » Provinces,
départements,
régions l'organisation administrative de la France d'hier
à demain - Jean-Louis Masson, 1984 p32 et Les
limites et les divisions administratives de la France en 1789, Armand
Brette, 1907
Il faut ensuite insister sur le fait qu’après
1435, les
écrits mentionnant « Vermandois en partie
» peuvent
ne concerner que la ville de Saint-Quentin et non le Soissonnais.
Le nouveau territoire militaire
s’étend sur quatre anciens territoires
hérités de la période gauloise
(Morins, Ambiens, Vermands, Rèmes) qui ont
donné d’importants diocèses et
comtés dès la période franque :
• diocèse de
Thérouanne et comté de Boulogne,
tournés dès l’époque
gauloise vers le commerce avec les îles britanniques,
• diocèse et comté
d’Amiens, dont est issu le comté de Ponthieu
(Abbeville), établis sur les deux rives du cours
inférieur de la Somme et important carrefour de
communication,
• diocèse de Vermand puis
Noyon et comté de Vermandois-St-Quentin et non Vermandois-Laon, traversés par
le
cours supérieur de la Somme et tourné vers la
Champagne, Troyes, Reims et Chalons,
• diocèse de Reims dans sa
partie nord, dont sont issus les comtés de Laon, de Guise,
capitale de la Thiérache, et la seigneurie de Coucy et de
peuplement antérieur à l'arrivée des
peuples belges (les Rèmes étaient liés
aux Suessions avant la période romaine).
On perçoit ainsi nettement l'artificialité de
l'ensemble avec deux centres d'attaction bien
distincts et anciens :
• le nord-ouest maritime
pour
les
comtés de Boulogne, de Ponthieu et dans une moindre mesure
pour le carrefour d'Amiens (Ambiens vient d'ambi, les deux à
la fois),
• le sud-est champenois
pour le
Vermandois, le
Laonnois et la
Thiérache.
On retrouve trace de ces fortes influences au
plan linguistique en
constatant que le picard du sud est concurencé de longue
date en
dehors de
l'Amiénois par l'anglo-normand à l'ouest et le
champenois
à l'est, mais aussi le chti au nord et le
francilien / français au
sud.
|
|
La « Picardie
» n'existe pas avant la
fin du XVe siècle
A la période gauloise, la vallée de la Somme
traverse le
territoire des
Ambiens (Amiens) et celui des Vermands (Saint-Quentin), qui donneront
les comtés carolingiens de Ponthieu (Abbeville, Montreuil),
de
Vimeu (Saint-Valéry),
d'Amiens, de Montdidier (Santerre) et de Vermandois (Saint-Quentin,
à l'origine distinct du Beauvaisis, du Noyonnais, du Valois,
du
Soissonnais ou du
Laonnois) avant de connaitre des destinées
assez diverses.
Le pouvoir royal s'affirme très tôt sur la
vallée de la Somme. S'appuyant sur l'église, les
Mérovingiens
installent d'importantes seigneuries ecclésiastiques
à Saint-Riquier en
Ponthieu (625) et Corbie en Amiénois (entre 657 et 661),
à l'instar de
celles de Beauvais, Noyon, Laon, Reims, Châlons, ... Relais
de
l'autorité royale et sources de revenus, directement
liées à la famille
royale, ces seigneuries vont servir les rois de France y compris
militairement : Corbie sera une tête de pont royale d'importance durant la
guerre de cent ans.
Après le capitulaire de Quierzy (877), qui étend
l'hérédité des fiefs aux gouvernements
des provinces de l'empire carolingien, commence l'époque
féodale ; les possesseurs des fiefs devenus
héréditaires accroissent leur puissance sous les
derniers Carolingiens et certains de ces grands feudataires deviennent
de fait indépendants.
La limitation des
contacts entre les régions et les divers royaumes de
l'empire, amène également une fragmentation
linguistique ; la lingua romana rustica, ou « langue romane
rustique » prend des formes particulières
à l'intérieur des frontières de ce qui
est aujourd'hui la France. Cette dialectalisation progresse rapidement
autour de l'an 1000, pour s'accentuer encore durant les
siècles suivants.
Par le fait de sa situation
géographique au Nord du domaine royal et de
la France, la région eut constamment à souffrir
de la guerre et des
invasions. Au IXe siècle, elle fut
dévastée par les Vikings (bataille
de Saucourt-en-Vimeux, 881). Durant la guerre de Cent ans, peu de pays
furent aussi fréquemment foulés par les invasions
et l'occupation
anglaises que les campagnes (bataille de Crécy, 1346);
dès 1347 les
Anglais tenaient Calais; en 1360, an traité de
Brétigny, le roi
d'Angleterre obtient le comté de Ponthieu et Montreuil. Sous
Charles
VII, une partie de la région passa sous la rude domination
des ducs de
Bourgogne; en 1423, le roi d'Angleterre, devenu roi de France, confirma
le duc de Bourgogne Philippe le Bon dans la possession des
châtellenies
de Péronne, Roye, Montdidier, etc., tenues par lui depuis
cinq ans
déjà. En 1435, au traité d'Arras qui
scellait sa réconciliation avec
Charles VII, le duc de Bourgogne obtint toutes les villes, terres et
seigneuries que la couronne possédait sur les deux rives de
la Somme, à
savoir la cession à perpétuité des
châtellenies de Roye, Péronne,
Montdidier, et la cession, sous condition de rachat, des villes de la
Somme : Saint-Quentin, Amiens, Abbeville, Corbie, avec le
comté de
Ponthieu, Doullens et Saint-Riquier. En 1463, Louis XI se
hâta de
racheter les villes de la Somme au vieux duc Philippe le Bon; et, en
1477, après la mort de Charles le
Téméraire et l'effondrement de la
puissance bourguignonne, la région devint pour toujours une
province du
domaine royal.
|
Constitution du domaine royal

Provinces
ecclésiastiques mérovingiennes,
Auguste Longnon, 1907 |
|
Dès les premiers
Capétiens,
alors que le domaine royal, les terres relevant directement du
pouvoir
du roi au sein du royaume de France, se limite tout d'abord
à une
partie de l'Île-de-France autour de Paris et
d'Orléans (ailleurs, ce
sont les grands seigneurs qui exercent leur autorité,
notamment les six
pairs laïcs : les ducs d'Aquitaine, de Bourgogne
et de
Normandie, ainsi
que les comtes de Champagne, de Flandre et de Toulouse), ce domaine
s'accroit rapidement dans la vallée de la Somme, importante
place
commerciale où affluent les marchands venus de Flandre, de
Hollande et
de l'Empire germanique, qui va également constituer une zone
tampon
entre Paris et les territoires ennemis de Normandie, de
Flandre, ...
<< Les six pairs
ecclésiastiques primitifs du royaume de France
sont l'archevêque-duc de Reims,
l'évêque-duc
de Laon, celui de Langres, l'évêque-comte de
Beauvais, celui de Châlons et celui de Noyon.
L'abbé de l'abbaye Saint-Rémi de Reims
est gardien
de la Sainte Ampoule, et celui de l'abbaye de Saint-Denis, gardien des
autres insignes royaux et de la nécropole royale. |
En 988, Montreuil (Ponthieu) est le premier port maritime
tenu par les
Capétiens (acquis par mariage par le domaine royal).
En 1068, Philippe Ier annexe une première fois le Vermandois
au domaine royal.
En 1074, la prise de Corbie (rive nord de la Somme) est la seule
acquisition que Philippe 1er ait faite par les armes.
En 1180, Philippe Auguste reçoit le comté
d'Artois en dot.
En 1185, le
comté d'Amiens (rive sud de la Somme) est uni au domaine
royal et disparait sous l'autorité directe du roi.
En 1191, le comté de Vermandois est acquis par le roi,
acquisition confirmée en 1214
et constitué en
bailliage.
En 1223, Louis VIII reçoit en apanage les comtés
de Boulogne et de Clermont en Beauvaisis.
En 1336, première conquête du comté de
Ponthieu, rendu au roi d'Angleterre en 1360, reconquis en 1369.
Le
20 septembre 1435, par le Traité d'Arras, le roi Charles VII
cède les
Villes de la Somme, ... à Philippe III de Bourgogne.
En 1477, le comté de Ponthieu est rattaché
définitivement au domaine royal.
Enfin,
en 1482, par le traité d'Arras, les Villes de la Somme sont
rattachées au
domaine
royal.
Sur
ces territoires étroitement
liés au pouvoir royal, au plan linguistique, le
Français du centre est au contact du Picard au nord, avec lequel
la vallée
- c'est-à-dire le bassin versant et non la
rivière - de l'Oise constitue une
frontière nette, mais aussi du Champenois à
l'est
et dans une moindre mesure de l'anglo-normand
plus à l'ouest.
Abel Hugo note dans La France pittoresque ou description
pittoresque, topographique et statistique des départements
et colonies de la France publié en 1835 : " La
langue française est en usage dans tout le
département à l'exception de quelques cantons
reculés".
Quierzy
n’est donc pas un village picard, du point de vue linguistique, même si son nom
pourrait le laisser supposer. Du
point de vue de l'histoire de son territoire, le Soissonnais n'a jamais
été du gouvernement militaire de Picardie,
apparu à
l'époque moderne, au
XVe
siècle et
pas avant.
|
|
Les armoiries de
l'Île de France sont celles du Roi de France
|
|
|
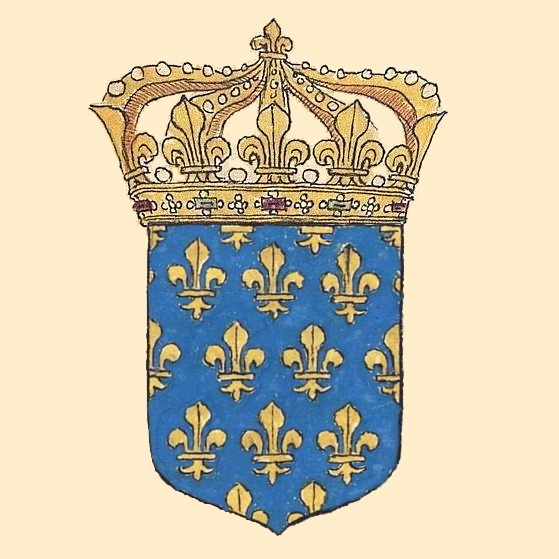 |
|
Elles ont connu deux
variantes :
- le blason de «
France ancien » : champ d’azur
semé de fleurs de lys d'or,
c’est-à-dire sans nombre. La première
apparition attestée des fleurs de lys comme
emblème du roi et du domaine royal date de 1211, sur un
sceau du futur Louis VIII.
- le blason de « France
moderne » : champ d’azur à
trois fleurs de lys d'or, modifié par Charles V en 1376 en
l’honneur de la Sainte Trinité.
Dessins La
Description des Provinces et Villes de France, Pierre de La Planche,1669
|
|
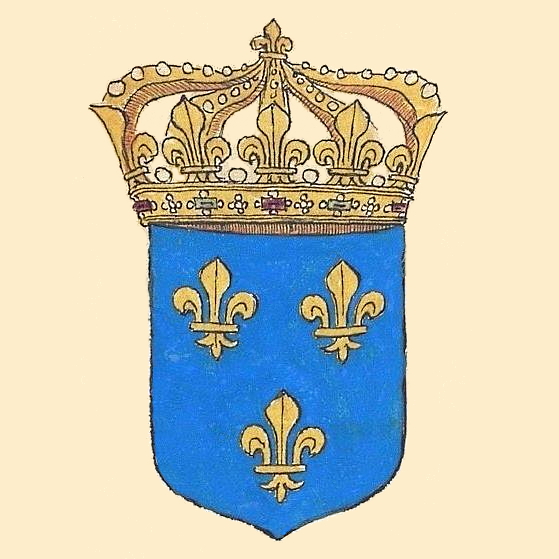 |
On trouve en effet aux origines
de l'Île de France l'épicentre du
royaume des Francs fondé par Clovis, le « pays de
France » délimité ou
irrigué par la Seine, l’Oise, la Marne, le Loing,
qui semblent
l’encadrer et former une île. Le destin de
l’Île de France est quoi qu'il en soit
lié à
celui des capitales franques, Soissons puis Paris, et du royaume dans
son ensemble. La région se couvre très
tôt d’importants complexes
religieux : abbayes de Saint-Denis et de Sainte-Geneviève,
monastère de
Jouarre...
Délaissée sous le règne des
Carolingiens, Charlemagne préférant son
fief d’Aix-la-Chapelle à l’ancienne
capitale du royaume des Francs,
l’Île de France revient au centre du domaine royal
sous les Capétiens,
à la fin du premier millénaire. C'est aussi
l'époque des raids des Vikings le
long de la vallée de la Seine. Le traité de
Saint-Clair-sur-Epte de 911
qui leur donne la Normandie, trace par la même
occasion une première
frontière occidentale pour
l’Île-de-France qui se matérialise par
les
fortifications défensives érigées
à Étampes, Mantes ou La Roche-Guyon. Au nord, la
vallée de la Somme (Corbie, Comté d'Amiens puis
Vermandois) rattachée aux XIe et
XIIe siècles au domaine royal, assure la
défense.
Dès
le XIIe siècle, l’Île de France,
considérée par les textes
comme un territoire spécifique, sous administration directe
du roi, connait une véritable révolution quand
l’abbé Suger initie à
Saint-Denis en 1137,
lors de
l'agrandissement de l’ancienne basilique
mérovingienne, l’architecture
gothique ou opus francigenum, c'est-à-dire,
littéralement, « mise en œuvre
française ». Il est bientôt
imité dans
toute la région : Chartres, Meaux, Mantes, Poissy... mais
aussi
Amiens, Arras, Auxerre, Beauvais, Cambrai, Laon, Noyon, Reims, Rouen,
Saint-Quentin, Sens, Troyes, ... Ces villes vivent en effet
l'avènement des Capétiens et la consolidation de
l'État qui, à mesure
de l'annexion des fiefs féodaux, impose comme symbole du
pouvoir royal
le renouvellement des édifices. Lieu de passage et de
brassage des idées,
l'Île de France et ses environs voient ainsi les premiers
maîtres du
gothique synthétiser les influences architecturales des
régions
voisines : arc brisé de l'abbaye de Cluny, arcs-boutants de
Cluny et
Vézelay, voûte sur croisée d'ogives
anglo-normande de l'abbaye de
Lessay, ...
Aux
premiers siècles du second millénaire, sous les
règnes de
Philippe-Auguste (1180-1223) et de Saint-Louis (1226-1270),
l’Île de France traverse une période
prospère. Elle est alors densément
peuplée et pratique de riches cultures
céréalières, tandis que les
coteaux de la Marne et de la Seine sont plantés de vignobles
et que
les Cisterciens édifient d’importantes abbayes
à Royaumont et
Maubuisson.
|
|
La
célèbre Description des Provinces et Villes de
France de Pierre de La Planche de 1669 présente dans son
Livre I consacré au Gouvernement de l'Île de
France, pour la partie nord, les Bailliage de Senlis et
Duché de Valois, Bailliages et Comtés du
Beauvaisis, Bailliage de Laon, partie du Vermandois, ainsi que les
Bailliage et Comté de Soissons (Chapitre VII).
Confusions
autour des Vermandois
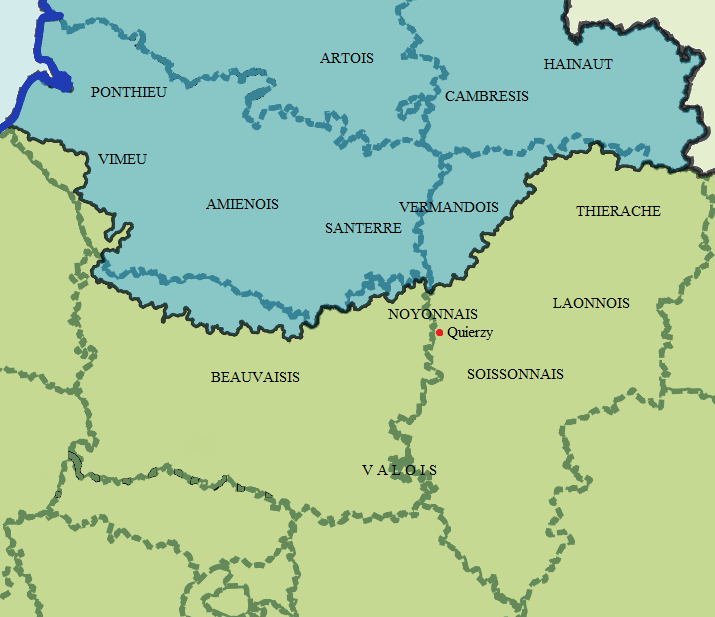 Il
peut donc sembler assez insolite de trouver aujourd'hui au
cœur de cette terre d'histoire une communauté de
communes portant le nom de « Picardie des Châteaux
» ... S’agit-il d’une
référence à la circonscription
administrative du décret
du 2
juin 1960, disparue en 2016 (loi du 16
janvier 2015) ? Est-il
question de la Picardie d’avant 1789 ? N’y
aurait-il pas confusion entre le pays et le comté puis
baillage de Vermandois ? Il
peut donc sembler assez insolite de trouver aujourd'hui au
cœur de cette terre d'histoire une communauté de
communes portant le nom de « Picardie des Châteaux
» ... S’agit-il d’une
référence à la circonscription
administrative du décret
du 2
juin 1960, disparue en 2016 (loi du 16
janvier 2015) ? Est-il
question de la Picardie d’avant 1789 ? N’y
aurait-il pas confusion entre le pays et le comté puis
baillage de Vermandois ?
La frontière naturelle que dessine la ligne de partage des
eaux Somme - Oise coïncide assez bien avec le
découpage des territoires des peuples gaulois. Le pagus
Veromanduensis gallo-romain correspond à la haute
vallée de la Somme autour de Saint-Quentin, le
Saint-Quentinois. Il forme avec le pagus Noviomagensis, ou Noyonnais,
la Civitas Viromanduorum. Hérité de la
cité, le territoire de l'Evêché de
Vermandois atteint l'Oise. Son siège épiscopal
est transféré à Noyon au VIe
siècle.
Érigé en comté par les Carolingiens
(Louis le Débonnaire en 823 ?), les comtes de Vermandois
accroissent considérablement par mariage ou
héritage les limites de leur fief dans les
vallées de la Somme et de l’Oise, autour de
Saint-Quentin, Péronne, Chauny, Roye, Montdidier,
Crépy-en-Valois jusqu’à former une
« principauté de Vermandois, Valois et Montdidier
» plutôt hétéroclite avec des
poches d’autonomie seigneuriale, à Ham par
exemple, des terres abondamment inféodés
à l’aristocratie régionale dans la
partie nord, à l’inverse le Valois reste un espace
directement contrôlé tandis que le
comté d’Amiens n’en fait que
brièvement partie au cours du XIIe siècle.
En ce même XIIe siècle, Philippe d'Alsace, comte
de Flandre, après la mort de sa femme Elisabeth, comtesse de
Vermandois, retint, au détriment d'Aliénor,
comtesse de Saint-Quentin, sœur cadette d'Elisabeth, le
comté d'Amiens, qu'elle lui avait apporté en
mariage. Le roi Philippe II parvient à obliger le comte
Philippe à faire retour de ces terres à la
Couronne. Le surnom d'« Auguste » est
donné à Philippe II après qu'il a
ajouté au domaine royal en 1185, par le Traité de
Boves, les comtés d’Amiens, de Montdidier et des
châtellenies du Vermandois (Saint-Quentin, Ham,
Péronne).
Création du baillage
de
Vermandois-Laon
Le comté de Vermandois est alors
érigé en bailliage, circonscription
principalement judiciaire à l’origine, avec son
siège à Laon, qui n'est en rien une ville
picarde. Au
XVIe siècle, la Coutume de Vermandois « comprenait
les
bailliages et prévôtés de Laon et de
Soissons,
ainsi que les territoires dépendant des coutumes
particulières de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon et Coucy
». Quierzy relevait de la coutume du gouvernement, bailliage
et
prévôté de Chauny.
Lors du Traité d'Arras de 1435, le roi Charles VII
cède
les places fortes défendant le cours de la Somme aux
Bourguignons, qui renoncent en contrepartie à leur alliance
avec
les Anglais. Ce traité « démembre
» le
puissant bailliage de Vermandois (déjà
séparé du bailliage de Senlis au milieu du XIIIe
siècle) : Saint-Quentin, importante ville de ce bailliage se
trouvant dans la vallée de la Somme, est
cédée aux
Bourguignons tandis que « le bailliage de Vermandois,
réservé la ville de Saint-Quentin », en
d'autres
termes, le Soissonnais, le Noyonnais, le Laonnois, Coucy, la
Thiérache (Ribemont), ... restent au domaine du roi et
à
l'Île-de-France. Le grand Vermandois a donc pour
l’essentiel son territoire bien en dehors de la
vallée de
la Somme avec son centre qui s’est
déplacé de
Saint-Quentin vers Laon.
En 1463, Louis XI rachète ces places fortes et on constitue
après 1482 à partir de celle-ci un gouvernement
frontière, communément appelé
province, auquel on
donne
le nom de « Picardie ». Aucun territoire
n’a
porté ce nom auparavant. Ce gouvernement militaire
comprendra
jusqu’à sept : l'Amiénois, le
Boulonnais, le
Ponthieu, le Santerre, le Vermandois Saint-Quentin, la
Thiérache puis le
Pays-Reconquis (Calaisis en 1558). Les cartographes y incluent parfois
et donc à tort le Beauvaisis, le Noyonnais et le
Laonnois.
En 1641, le royaume de France contrôle de nouveau l'Artois.
Après une période militaire de 150 ans, Richelieu
confirme le rattachement du Beauvaisis, et du Laonnois puis du
Noyonnais au gouvernement de l'Île-de-France tandis
qu’on intègre l'Artois au gouvernement
frontière dit de Picardie.
La coutume du bailliage de Vermandois-Laon demeure par endroit en
vigueur au sud de l'Oise jusqu'à la Révolution.
Un examen
historique même rapide de
l’évêché de
Vermandois, avec son siège à Noyon et du
bailliage
judiciaire de Vermandois, avec son siège à Laon,
ne
cependant laisse guère de doute quant à
l’artificialité des liens entre le Noyonnais, le
Soissonnais, le Laonnois ou même la Thiérache, ...
et un
hypothétique « Vermandois picard ».
|
__________
Les interprétations
a posteriori des géographes-historiens
Les
géographes-historiens du XVIe siècle,
époque
à laquelle on ne distinguait pas les deux disciplines, ont
tout
d'abord bien du mal à situer, et pour cause, le territoire
qui
donne son nom au nouveau gouvernement militaire constitué
autour
des « Villes de la Somme » après leur
retour
à la France. La victoire de Louis XI est
alors
d'importance mais on ne trouve la « Picardie »
sur aucune carte avant
le XVIe
siècle. Aucun territoire n'a en effet jamais
porté ce nom
auparavant, pas même l'Amiénois, qui en serait
pourtant le
berceau sur le plan
linguistique ? souvent mis en avant
(qui correspondrait au seul
picard du sud,
que l'on distingue du picard du nord ou ch'ti de
l'Artois-Flandre-Hainaut). Ce
nouveau gouvernement frontière ne correspond donc pas
à
l'aire de
diffusion du picard,
qui n'est déjà plus
parlé depuis
plusieurs siècles en de nombreux endroits, sauf à
considérer l'anglo-normand, le
français ou le
champenois comme
des variétés de picard ! On n'utilise pas non plus
à l'époque le terme « picard
» pour
désigner le plateau crayeux entre Amiens
et Beauvais. Il
ne
faut pas se laisser abuser par les cartes qui sont à
cette époque en latin et
désignent le
royaume de France par le terme Gallia.
Le terme Picardie paraît avoir
été
moins ancien
que celui de Picard. Nicolas, doyen de l'église de Bray,
dans
son poème des Gestes de Louis VIII, écrit avant
1248,
mentionne Philippe de Boulogne « honneur de la Picardie
»;
Mathieu Paris, qui écrivait vers la même
époque,
emploie plusieurs fois la désignation de Picardie.
D'après Grenier, le premier auteur qui mentionne la
région, comme un pays, une province, en citant seulement
quelques-unes de ses principales villes est Barthelemi l'Anglais qui
composa au XIIIe siècle un traité : De
Proprietatibus
rerum. Mais nous ne savons rien sur l'extension territoriale de cette
région. L'incertitude n'est pas moins grande chez les
géographes et les anciens auteurs (André
Thévet,
de Valois, Ortelius, l'abbé Carlier, dom Grenier) au sujet
de
l'origine du mot ; la plupart le font venir de pique, arme
offensive particulière aux habitants du pays (?). Ce, qui
explique que le terme de région n'a
été
adopté qu'assez tardivement dans la nomenclature
géographique et administrative au Moyen âge, c'est
qu'il
ne s'appliquait pas à une particularité
topographique du
pays (comme la Champagne), qu'il n'avait aucun sens ethnique ou
simplement historique (comme la Normandie, la Bretagne); les
désignations particulières et moins
compréhensives
d'Amiénois, Beauvaisis, Laonnais, Noyonnais, Vermandois, qui
étaient beaucoup plus anciennes, rappelaient les antiques
populations fixées dans le pays et les premières
agglomérations urbaines, furent seules d'un usage courant et
prévalurent pendant de longs siècles. Au XIVe
siècle seulement, la région apparaît
dans la
terminologie administrative. En 1350, Charles de Montmorency,
chambellan du roi Jean le Bon, est qualifié de «
capitaine
général pour Sa Majesté sur les
frontières
de Flandre et de la mer et en toute langue picarde »;
Barthélemy du Drach, trésorier des guerres en
1350, porte
le titre de «-capitaine pour le roi aux parties de
région,
de Boulogne et de Calais »; en 1369, Philippe, duc de
Bourgogne,
frère du roi Charles V, est créé
«
lieutenant en tous pays de Picardie ». En 1410, nous voyons
Valeran de Luxembourg, comte de Liney et de Saint-Pol, seigneur de
Fiennes, grand bouteiller de France, mentionné comme
«
capitaine du roi es-pays de Picardie et West-Flandres ». Au
XVe
siècle, lorsque la région, définitivement
réunie au domaine royal, devient
une circonscription financière; en 1477, Louis XI
organise
une recette générale des finances pour la
levée de
la taille et des aides. Cette circonscription n'était, en
fait,
qu'une dépendance de la
généralité
d'Outre-Seine, car les finances de région étaient
administrées ordinairement par le
général de la
circonscription voisine d'Outre-Seine. En ce qui concerne
l'impôt
de la gabelle, la région était, à la
fin du Moyen
âge, divisée en cinq ressorts ou greniers :
Montdidier,
Abbeville, Saint-Quentin, Péronne, Roye.
Un espace avant
tout militaire ?
Les
limites du nouveau
territoire frontière
sont d'autre
part elles-mêmes mouvantes.
Elles vont s'étendre au cours du XVIe
siècle, au
gré notamment
des
opérations militaires qui
se poursuivent. Le
gouvernement militaire traverse quatre grands territoires plus que
millénaires, hérités des peuples gaulois,
avec leurs frontières naturelles : territoire des
Morins (Thérouanne,
Boulogne), des Ambiens (Amiens), des Vermands (St-Quentin) et des
Rèmes (Reims),
qui ont donné les diocèses et
comtés et que l'on fait tout
simplement disparaitre des cartes (approximation
géographique). On est également sans
doute encore dans
une logique de conquête/soumission des pays
protégés qui relève des
mentalités féodales.
On
attribue de
surcroit de manière parfaitement
anachronique une dénomination
administrative et militaire de la fin du XVe siècle
à des territoires ayant fait antérieurement partie de
comtés plus étendus ou
à des comtés
associés, approximations historiques qui permettent
par exemple d'intégrer le Valois à
la « Picardie
» parcequ'il se confond un
temps avec le Vermandois !
Par
extension, depuis
cette époque, la zone des combats entre la France et les
Pays-Bas espagnols et parfois jusqu'au cours des deux guerres
mondiales, est
improprement
appelée « Picardie
».
Au nord de Paris c'est la
Picardie ... et selon la loi de Brandolini,
ou principe d'asymétrie des discours, la quantité
d'énergie nécessaire
pour réfuter cette fausse information est très
supérieure à celle
nécessaire pour la produire. Il faudra probablement
plusieurs heures pour démonter chaque
point et montrer la fausseté de l'ensemble.
C'est la technique de propagande qui consiste à diffuser
de l'infox en masse, afin d'exploiter la
crédulité d'un certain public
en faisant appel à son système de
pensée rapide, instinctif et
émotionnel.
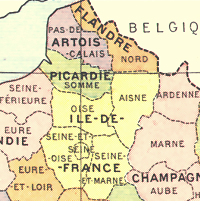
|
Les termes
« Picard » et
« Picardie » s'avèrent
rarement utilisés à bon escient
Anachronique
avant le XVIe siècle, aucun territoire ne porte le nom de « Picardie
» antérieurement,
élastique et
imprécis par la suite, les
notions les
plus précises sont celles de « ceinture
défensive du Calaisis à la Thiérache
autour des Flandres et de l'Artois », ou
Boulonnais, Amiénois,
Vermandois et Thiérache.
Car il s'agit bien
ici avant tout d'une zone de défense tenue
par des troupes venues de tous
les horizons, instaurée sur
quatre anciens territoires, et à l'intérieur
leurs pays bien distincts, qui
ne constituent
à aucun moment,
avant ou
après le XVIe
siècle, un ensemble administratif, culturel ou linguistique
cohérent, contrairement à ce
qu'on tentera d'imposer par
la suite et à nouveau dans
la ciconscription
administrative de 1960.
Le terme
« picard » ne
s'applique en toutes hypothèses clairement pas
à la
vallée de l'Oise et aux
territoires plus
au sud. On a étendu artificiellement,
après 1482 comme
après 1960, une
appellation ne concernant qu'une fraction à un ensemble : la
« Picardie » historique correspondant tout
au plus à un département, celui de la
Somme de 1790,
plus qu'à une région. |
Hétérogénéité
linguistique et territoriale des «
nations » universitaires de Picardie, la
Picardie imaginaire, ceux qui parlent d’autres langues sur
des territoires hétéroclites
Aucun territoire ne porte le nom de Picardie avant la fin du XVe
siècle. Aussi invoque-t-on
généralement la « nation » de
Picardie de l'Université de la Sorbonne du XIIIe
siècle, qui regroupait les étudiants dont les
diocèses d’origine étaient Beauvais,
Amiens, Noyon, Arras et Thérouanne d'une part, Cambrai,
Tournai, Utrecht, Liège et Laon d'autre part (Glossarium
mediae et infimae latinitatis, du Cange, 1678).
L’origine des nations reste obscure. Il s’agit
probablement au début de simples groupes
constitués selon l’origine géographique
de leurs membres.
La nation de Picardie regroupe les maîtres issus des
provinces ecclésiastiques du nord et de l’est de
la France ainsi que des Pays-Bas. (sorbonne.fr)
Il
s'agit donc ici à nouveau de la Belgique Seconde du Moyen
Âge,
c’est-dire la province ecclésiastique de Reims.
Le terme nation n’a pas le sens contemporain et
désignait dans les universités un groupement de
maîtres et d'étudiants selon un
découpage géographico-linguistique et non au sens
politique aujourd'hui de groupe humain dont les membres sont
liés par des affinités tenant à un
ensemble d'éléments communs. A
l'Université de la Sorbonne, la « nation de
Picardie » n'a d'ailleurs été
fixée qu'après plusieurs conflits sur la
« nationalité » des étudiants
... Cette faculté de l'université de Paris
comprenait quatre nations : anglaise (incluant les Allemands),
française (incluant Italiens et Espagnols), normande et
picarde (incluant Flamands, Français, Picards)
(Fédou). Des nations picardes ont également
existé dans les universités d'Orléans,
Bologne, ...
Cette « nation » recouvrait donc un territoire
allant du Beauvaisis jusqu’aux Pays-Bas actuels,
où sont parlés le français, le picard
et le flamand. Certains y voit cependant la « Picardie
» originelle où on ne parlerait que picard,
conformément à un priori populaire tenace : au
nord de Paris, c'est la « Picardie » !
Ces « nations » picardes universitaires ne
correspondent en réalité nullement aux
étudiants qui parlaient le picard (le latin restait la
langue de l’enseignement), elles se distinguaient au
contraire par leur
hétérogénéité
linguistique. Voilà qui donne à nouveau au terme
picard un sens bien différent mais plus conforme
à la réalité de la période
(latins au sud / barbares au nord), ceux qui parlent d’autres
langues et de territoires féodaux
hétéroclites
S’il apparait un trait commun ignoré par des
générations de régionalistes,
c’est l’intégration de longue date de
certains de ces territoires au domaine royal, qui atténue
l'idée de frontière linguistique et culturelle au
nord de l'Île de France entre français et picard
sur la limite naturelle de la ligne de partage des eaux Somme-Oise et
du plateau crayeux.
Sur le plan territorial, il convient en effet de rappeler que
jusqu’au XVe siècle, Cambrai, Utrecht,
Liège, étaient situés en terre du
Saint-Empire Romain, tandis que la plus grande partie du
diocèse de Tournai était, ainsi que les
diocèses d'Arras et de Thérouanne, soumise au duc
de Bourgogne, également possesseur des comtés de
Flandre et d'Artois, de sorte que cette « nation »
de Picardie à l'Université de Paris devait alors
se composer tout au plus d'étudiants des diocèses
d'Amiens, de Beauvais, de Noyon et de Laon. La croyance populaire
attribue encore parfois ces pays à la Picardie
traditionnelle. A nouveau, les
évêchés-comtés-pairies de
Beauvais, Noyon et Laon étaient de rattachement ancien (vers
1160) au royaume de France primitif, à l'origine de
l'Île de France, où les pouvoirs royal et
religieux contribuèrent au développement du
français, y compris la « Picardie originelle
», le diocèse d'Amiens (c'est-à-dire le
département de la Somme), lui-même uni
dès 1185 au domaine royal avec ses importantes seigneuries
ecclésiastiques de Saint-Riquier en Ponthieu et Corbie en
Amiénois.
|
Des institutions d'avant 1789 et
comment s'en affranchir
Un article
publié en 1912 dans le Bulletin de la
Société Académique de Laon par le
Comte Maxime de Sars (1886-1960), qui fut président de cette
société académique, illustre bien
l’utilisation au profit de thèses
régionalistes, des hésitations depuis la
période précédente devant la
complexité des institutions d'avant 1789 et le recours au
mythe de la province, afin de s'affranchir dans leurs
démonstrations hasardeuses de la
réalité de ses institutions.
«
Les historiens et les géographes
modernes placent généralement le Laonnois dans la
province
d'Île-de-France. Certains, se piquant d'érudition,
ajoutent que ce pays
se rattachait autrefois à la Picardie, mais que depuis le
reçue de
Louis XIII, il est bien réellement français.
Cette assertion est
classique, presque officielle. Elle est cependant inexacte. L'erreur
est dans la confusion des mots province et gouvernement. Le
gouvernement est la circonscription militaire. La province n'a jamais
eu d'existence officielle. Au point de vue administratif, la France se
divisait en intendances et en subdélégations ait
point de vue
financier, en généralités et en
élections au point de vue judiciaire,
en ressorts de parlement, bailliages présidiaux et
secondaires,
prévôtés, au point de vue religieux, en
provinces ecclésiastiques et
diocèses, au point de vue militaire, en gouvernements
généraux et
particuliers. La province était une division traditionnelle,
que le
Pouvoir respectait, comme toutes les vieilles coutumes. Ouvrez
l'Almanach Royal pour 1789 : vous y verrez que les sept
élections de la
généralité de Soissons sont
notées en Picardie; de même, trois
élections de l'intendance de Paris (Beauvais,
Compiègne et Senlis).
L'erreur vient aussi de ce que le Gouvernement et la province portaient
le même nom et voyaient généralement
leurs limites se confondre. Il est
à remarquer que les cartographes du XVIIIème
siècle adoptaient souvent,
entre toutes les autres, la division en gouvernements. Mais personne ne
s'y trompait. Robert de Hesseln dit très justement que la
Picardie est
une « province dont la plus grande partie forme un des grands
gouvernements généraux militaires du royaume. La
Picardie
septentrionale est celle qui compose le gouvernement
général militaire
de Picardie; et la méridionale fait partie du gouvernement
général
militaire de l'Île-de-France ».
Contexte
- Le régionalisme
Plusieurs périodes
Avant même la fin de l’ancien régime,
l’absolutisme, qui voit la concentration de tous les pouvoirs
entre les mains du roi, fait notamment émerger en
réaction une critique par l’aristocratie locale
privée de ses prérogatives, en faveur
d’un retour aux pouvoirs locaux.
Par la suite, le provincialisme, ancré sur le mythe des
provinces d’ancien régime, est une constante du
régionalisme. Les monarchistes y sont
particulièrement actifs après
l’échec des dernières tentatives de
rétablissement de la royauté ou de
l’empire au niveau national, définitivement acquis
aux républicains après leur victoire aux
législatives de 1876. Les monarchistes investissent alors le
niveau régional dans un objectif de contestation du pouvoir
républicain, qui irait de pair avec la centralisation,
prolongement de l’héritage
révolutionnaire (centralisation des politiques
éducatives, routières, ferroviaires, militaires,
...
Le courant républicain serait lui-même
traversé par deux tendances plus ou moins
imaginaires : les
« jacobins » partisans de
l’Etat central unifié et les
« girondins » favorables
à une décentralisation donnant plus de poids aux
régions.
Explication
de texte
Il s’agit d’une des nombreuses
démonstrations hasardeuses, concernant ici le Laonnois.
Après avoir indiqué que ce pays était
généralement placé dans la province
d'Île-de-France, l’auteur relève
qu’il se rattachait autrefois à la Picardie, mais
qu’il il est bien français depuis Louis XIII.
Toutefois ceci est inexacte car il y a confusion entre la province, qui
n'a jamais eu d'existence officielle et gouvernement, qui est une
circonscription militaire.
«La province était une division traditionnelle,
que le Pouvoir respectait, comme toutes les vieilles
coutumes. » l’auteur en veut pour preuve
que l'Almanach Royal pour 1789 note « en
Picardie » les sept élections de la
généralité de Soissons ainsi que les
trois élections de l'intendance de Paris de Beauvais,
Compiègne et Senlis.
Pour l’auteur, « en
Picardie » fait référence
à la province, sans l’établir.
Enfin, l’auteur cite le cartographe lorrain Robert de
Hesseln, auteur du découpage de la France par quadrillage,
qui inspirera les révolutionnaires pour la
création des départements et énonce -
sur quel fondement ? que la province de Picardie formerait en
partie les gouvernements militaires de Picardie et de
l'Île-de-France : la Picardie septentrionale
composerait le gouvernement militaire de Picardie et la
méridionale ferait partie du gouvernement militaire de
l’Île-de-France.
|
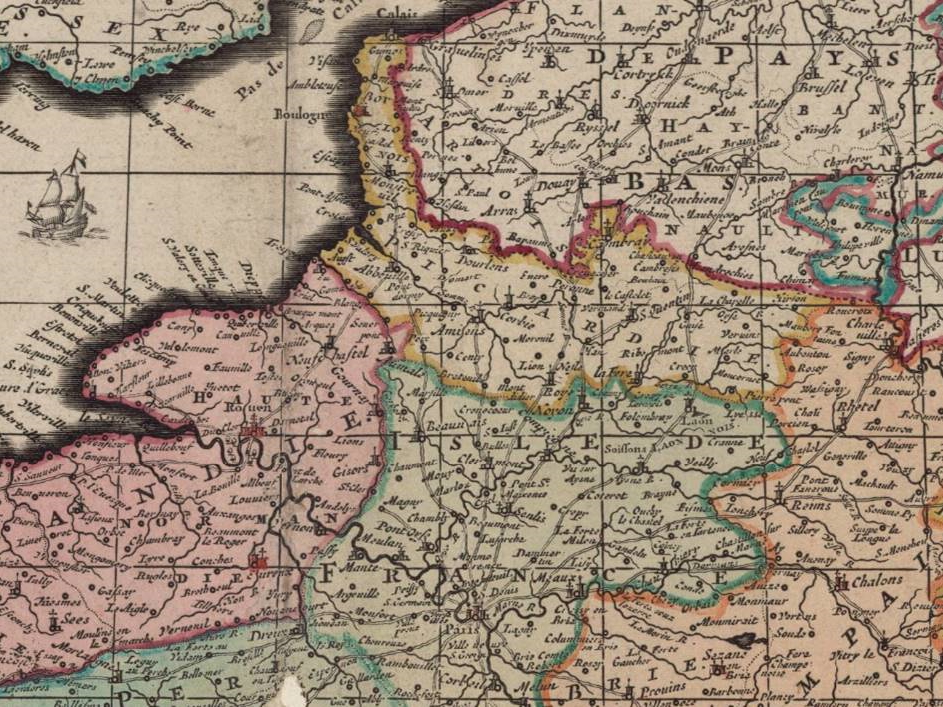 Le gouvernement
général de Picardie de Richelieu
(première moitié du XVIIe s.)
Le gouvernement
général de Picardie de Richelieu
(première moitié du XVIIe s.)
s'étend
du Calaisis
à la Thiérache.
Au
sud, le Beauvaisis, le Noyonnais, le Soissonnais, le Laonnois sont de
l'Île de France
F
Galliae seu Franciae tabula... , per Nicolaum Visscher
(1618-1679)
Gouvernement
Général de l'Isle de France, 1751
Les
pays de l'Île de France (gouvernement
général d'avant
1789) :
Beauvaisis, Noyonnais, Soissonnais, Laonnois, Vexin, Valois,
Mantois ou
Yveline, France, Hurepoix, Brie, Gâtinais.
|
|

Gouvernement
Général de l'Isle de France divisé par
pays de Robert, 1754 |
Carte
du Gouvernement
Général de l'Isle de France divisé par
pays de Robert de Vaugondy, 1754
Carte du gouvernement de
l'Île-de-France, Damien de Templeux ? | Carte du gouvernement de
l'Île-de-France, Damien de Templeux (15..-1620)
Autour de Paris, le domaine royal
à l’origine de l'Île de France, a par le
passé compris le comté d’Amiens, etc.
Les limites des grands
gouvernements sont parfois représentées avec des
modifications successives au cours des XVIe et XVIIe siècles.
S’agissant du nord du royaume, on avance comme explication
possible les exigences de la guerre et de la politique, aucun
écrit officiel ne vient confirmer ces hypothèses.
Le conflit franco-espagnol (guerre de Trente Ans) se poursuit en effet
dans le nord de la France avec la reconquête de Corbie, de
Bohain-en-Vermandois, la prise de Landrecies, de Maubeuge et de La
Capelle en 1636. La Thiérache et le Vermandois sont
désormais à l'abri de la cavalerie
impériale qui sévissait depuis les collines
d'Artois et le comté de Hainaut. En 1638, l'armée
française regroupe ses forces à Saint-Quentin.
L'objectif est de placer l'Amiénois à couvert
après la protection réussie de son flanc oriental
en 1637. Le siège d'Arras se déroule en 1640
durant cette campagne.
Le siège d'Arras est évoqué dans la
pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897,
à l'acte
IV
:
Hélas
!
Rien
de plus compliqué que ce siège
d’Arras.
Nous
assiégeons Arras, nous même, pris au
piège,
Le
Cardinal infant d’Espagne nous
assiège…
En
1641, d'autres places fortes espagnoles ; Aire-sur-la-Lys,
Lens, Bapaume et La Bassée tombent aux
mains des
Français. Fin 1641, le royaume de France contrôle
de
nouveau l'Artois.
Les
limites des grands gouvernements sont alors définitivement
fixées par Richelieu : le Beauvaisis, le Soissonnais, le
Valois, la partie méridionale du Laonnois, parfois
représentés un temps, en partie du
gouvernement militaire dit de Picardie, font définitivement
partie du gouvernement de l'Île de France, qui
possède pour limites septentrionales la Thiérache
(c'est-à-dire la vallée de l'Oise
au-delà de Condren), pour limites orientales et
méridionales, la Champagne et la Brie, etc.
Le comté ecclésiastique de Noyon est pareillement
du gouvernement de l'Île de France tandis que la
Thiérache champenoise est rattachée, ainsi que le
Vermandois Saint-Quentinois, au gouvernement frontière dit
de Picardie.
Au
nord-est de
l'Île de
France, deux territoires
millénaires se trouvent démembrés
:
- le
Vermandois
/ Diocèse ecclésiastique
de Noyon, qui
demeure
jusqu'à la révolution, et
regroupe le Noyonnais et le Vermandois Saint-Quentinaura une
partie
en Île
de
France, le Noyonnais, et une en dehors : le Vermandois
(Saint-Quentin),
- la
Thiérache / Diocèse
ecclésiastique
de
Laon,
qui demeure
jusqu'à la
révolution,
et regroupe le
Laonnois et la Thiérache aura une partie
en Île
de
France, le Laonnois, et une en dehors : la
Thiérache.
Le découpage de 1790 du département de
l'Aisne réunira en partie le Noyonnais et
le Vermandois ainsi que le
Laonnois et la Thiérache champenoise.
|
La
partie centrale du gouvernement de « Picardie » correspond au Diocèse
d'Amiens (bassin
de la Somme inférieure jusqu'à la
Canche au nord). On y joint au nord de la
Canche, une
bande maritime du Diocèse
de Thérouanne : Montreuil, Boulogne et Calais
reconquis sont sous
l'autorité de la province frontière.
Lors du retour à la France, en 1559, des parties
françaises des diocèses de Thérouanne, Arras, Tournai et Cambrai,
une province ecclésiastique
de Cambrai est créée, par partition de
celle de Reims avec les diocèses d'Arras, de Cambrai, de
Saint-Omer
(partie de l'ancien diocèse de
Thérouanne), de Tournai (à cheval sur la France
et les Pays-Bas
autrichiens, d'Ypres (à cheval sur la France et les Pays-Bas
autrichiens). Le diocèse de Boulogne (partie de l'ancien
diocèse de
Thérouanne), pareillement
créé, reste pour sa part à la province
ecclésiastique
de Reims.
La
perception des impôts relève pour sa part des généralités,
élections,
aides, gabelles et tailles établies au XIVe
siècle. Le Laonnois et la
Thiérache, de l'ancienne
généralité de Champagne, formaient une
élection dont le chef-lieu était Laon. Cette
généralité a été
modifiée
en 1595 avec la création
de la
généralité et du bureau des finances
de
Soissons, constituée avec :
- les élections de
Château-Thierry, Clermont,
Crépy-en-Valois et Soissons,
démembrées de la
généralité de Paris,
- l'élection de Noyon,
détachée de la
généralité d'Amiens,
- les élections de Laon et Guise,
prises à la généralité de
Champagne.
En 1635, la généralité est
pourvue par Richelieu d'organes administratifs et politiques, par
l'intermédiaire de commissaires ou intendants, auxquels il
donne un
contrôle sur l'administration, la police, les finances et la
justice.
La Description des Provinces et
Villes de France, Pierre de La Planche, 1669
Rédigé
pendant le règne de Louis XIV, "L'Armorial de La
Planche" regroupe un précieux inventaire
des principaux pays et villes du royaume de France avec des
descriptions
très précises (géographie,
fortifications, églises et établissements
religieux, productions locales, etc.), classées selon
les circonscriptions administratives de l'époque
(Gouvernements,
Prévôtés, Bailliages,
Sénéchaussées, ...).
Le premier volume commence par un Livre I consacré au
Gouvernement de l'Île de France, divisé en sept
chapitres :
I -
Prévôté et Vicomté de
Paris
II -
Bailliage de Melun
III -
Bailliages de Mantes et de Montfort l'Amaury
IV -
Bailliage de Senlis et Duché de Valois
V -
Bailliages et Comtés du Beauvaisis
VI -
Bailliage de Laon, Ière partie du
Vermandois
VII -
Bailliage et Comté de Soissons
Le Livre II décrit le Gouvernement de Picardie :
« Le pays de
Picardie est un nom
général, on ne trouve point dans l'Histoire aucun
Seigneur qui en ait porté le titre ».
Il se compose des « comtés
de Vermandois,
d'Artois, de Boulogne, de Ponthieu et de Thiérache ; le
vulgaire y met aussi les villes de Laon, Soissons, Senlis, Noyon,
Beauvais, et Compiègne, à cause du langage des
habitants qui en approche, comme faisant aussi partie de la Gaule
Belgique, mais étant du Gouvernement de l'Île de
France. » |
|
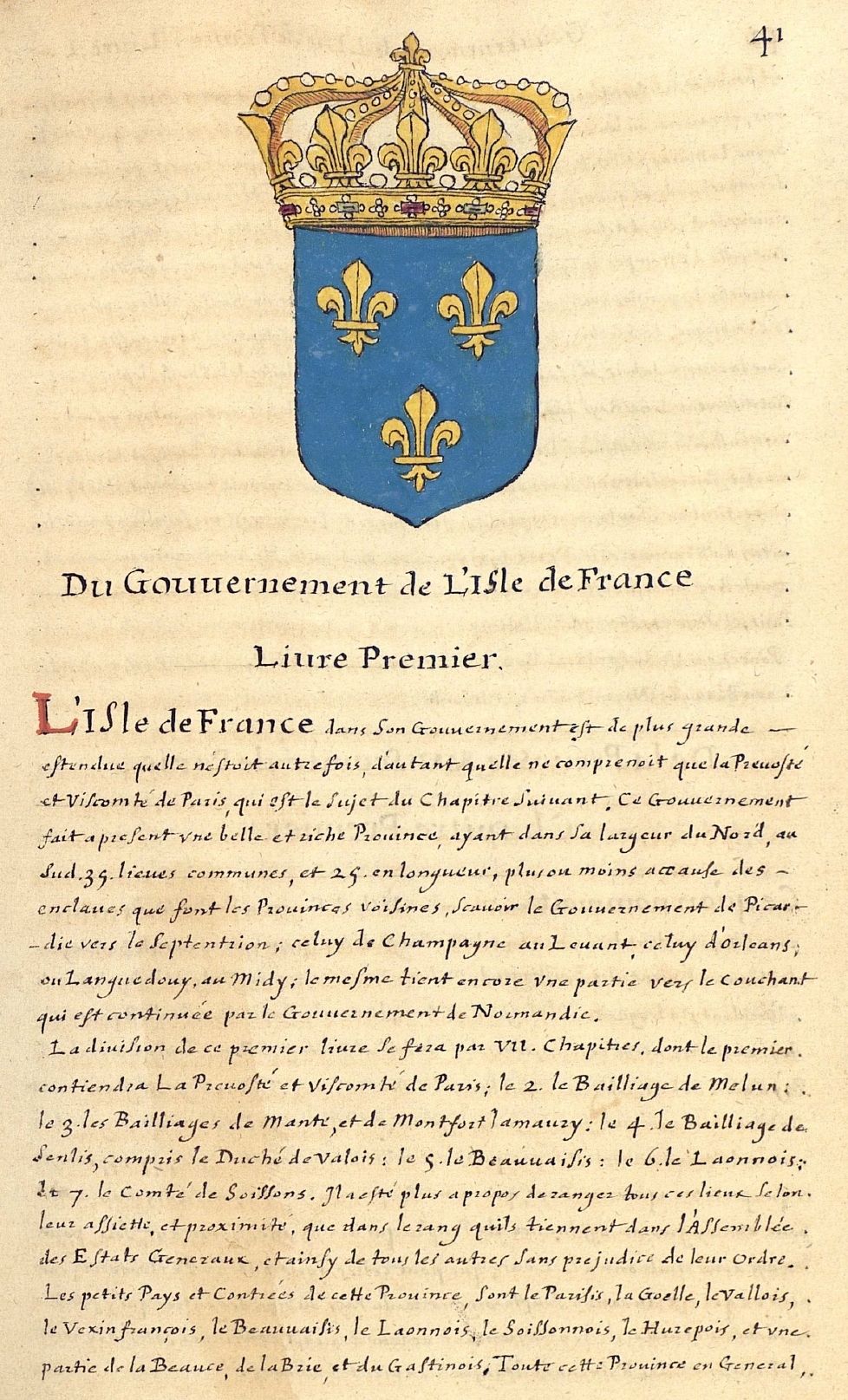
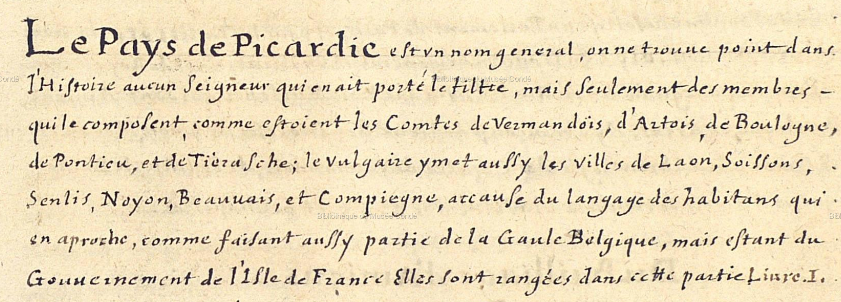
|
Source
: Bibliothèque du Musée Condé
Château de Chantilly
Extraits
sur Herald Dick Magazine
Chapitres
VI & VII
La
remarque de de La Planche : « langage
des habitants qui en approche », pour les villes de Laon,
Soissons,
Senlis, Noyon, Beauvais, et Compiègne, est rarement
relevée. Un mot de
picard, un accent suffit généralement
à faire basculer un pays entier
d’une « province » à
l’autre.
Intéressante également la
référence à la Gaule Belgique, dont
faisant
partie ces villes, province de la Gaulle romaine, qui persistait dans
la province ecclésiastique de Reims et
s’étendait de Tournai en
Belgique à Châlons-sur-Marne, avec Reims pour
capitale …
|
|
Le Règlement du
24 janvier 1789 pour la convocation des Etats
généraux de 1789
fixe les noms des bailliages principaux de la
Généralité de
Soissons, nombre de députés à
élire et bailliages secondaires comme
suit :
- Bailliage
de Château-Thierry, 4 députés (1
clergé, 1 noblesse, 2 tiers-état),
- Bailliage
de Clermont en Beauvoisis, 4 députés (1 clergé, 1
noblesse, 2 tiers-état),
- Bailliage
de Crépy-en-Valois, 4 députés (1 clergé, 1
noblesse, 2 tiers-état),
- Bailliage
de Soissons, 4 députés (1 clergé, 1
noblesse, 2 tiers-état),
- Bailliage
de Villers-Cotterêts, 4 députés (1 clergé, 1
noblesse, 2 tiers-état),
- Bailliage
du Vermandois à Laon
(bailliages
secondaires : Chauny,
Coucy, Guise, La Fère, Marle, Noyon), 12
députés, (3 clergé, 3
noblesse, 6 tiers-état).
La mise
en œuvre des convocations et le processus de
désignation des
députés donneront lieu à un
contentieux abondant du fait notamment de ses circonscriptions
(bailliages et sénéchaussées)
historiquement mal définies ...
Carte jointe à la
convocation adressée aux
délégués des trois ordres le 24
janvier 1789 >>
|
|
 |
__________
La
limite septentrionale de l'Île de France historique
se trouve
sur
la frontière naturelle constituée par la ligne de
partage
des eaux de l'Oise
et de la Somme.
La « Picardie
» dans ses limtes
départementales,
la Somme
|
|
Les cartographes du XVIIe
siècle représentent parfois le Vermandois et une
partie du Soissonnais compris dans le gouvernement frontière
issu des territoires reconquis entre 1477 et 1482, on parlerait au XXe
siècle de « Zone des Armées
». À cette époque, le nord du royaume
pâtit de la rivalité entre les rois de France et
d’Espagne, qui menacent Paris depuis leurs possessions des
Pays-Bas et les cités riveraines de l'Oise
arrêtent alors nombre d'invasions en cette période
de guerres incessantes : Guise, La Fère, Chauny,
pratiquement ruiné en 1472, Noyon en 1552 notamment ...
Champ de bataille et territoire de défense sans doute,
« Villes de la Somme » certainement pas.
Autre souvenir de
cette époque funeste ? le village d'Oussencourt, qui
touche Quierzy, prendra bien plus tard le nom
de Bourguignon-sous-Coucy ou Henri IV, qui fait
construire une
citadelle à Laon en 1595.
La vallée de l'Oise ne fait pour autant clairement partie ni
des
Villes de la Somme, ni des territoires reconquis entre 1477 et 1482, ni
de la « Picardie » géographique du
bassin
hydrographique de la Somme inférieure (Ponthieu, Vimeux,
Amiénois, Santerre) au sens très large (soit
presque tout
le département de la Somme) et plus probablement dans
l'Amiénois au sens strict.
Au plan géologique, et tout en découle, la
vallée
de l'Oise, mais aussi le Noyonnais, le Soissonnais, …
parties du
Bassin Parisien calcaire, se distingue également du plateau
crayeux d’Amiens. Il en résulte qu'au plan
historique,
linguistique ou architectural, Soissonnais, Noyonnais et Laonnois se
rattachent à l'Île de France, quand bien
même on y
entendrait un picard du sud véhiculaire et non
vernaculaire.
|
|