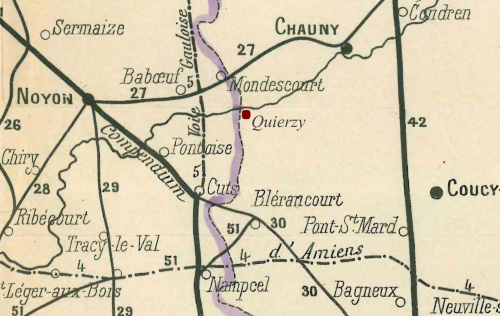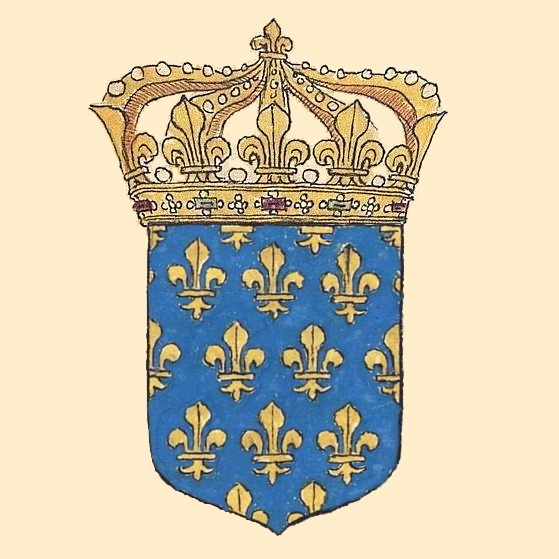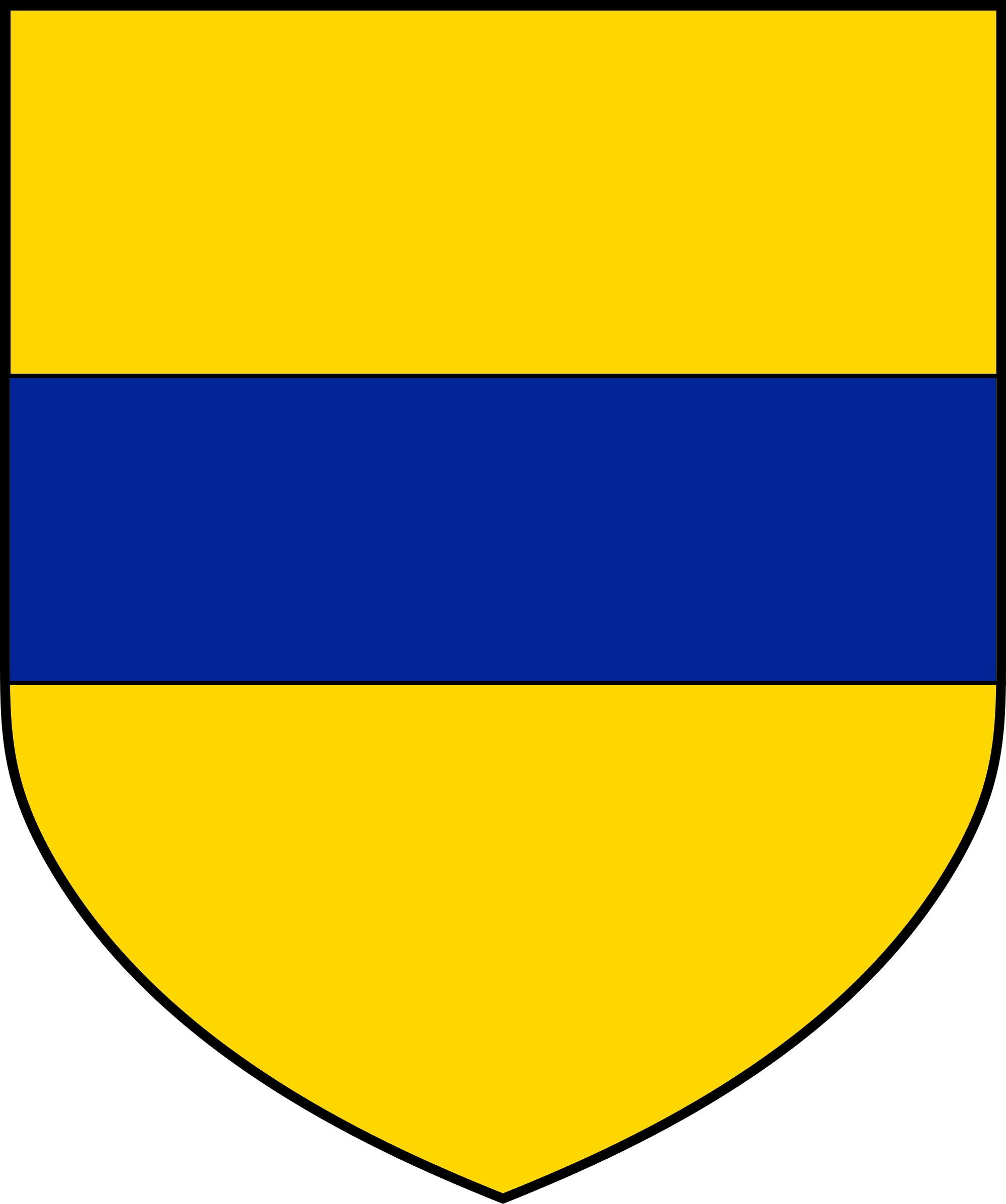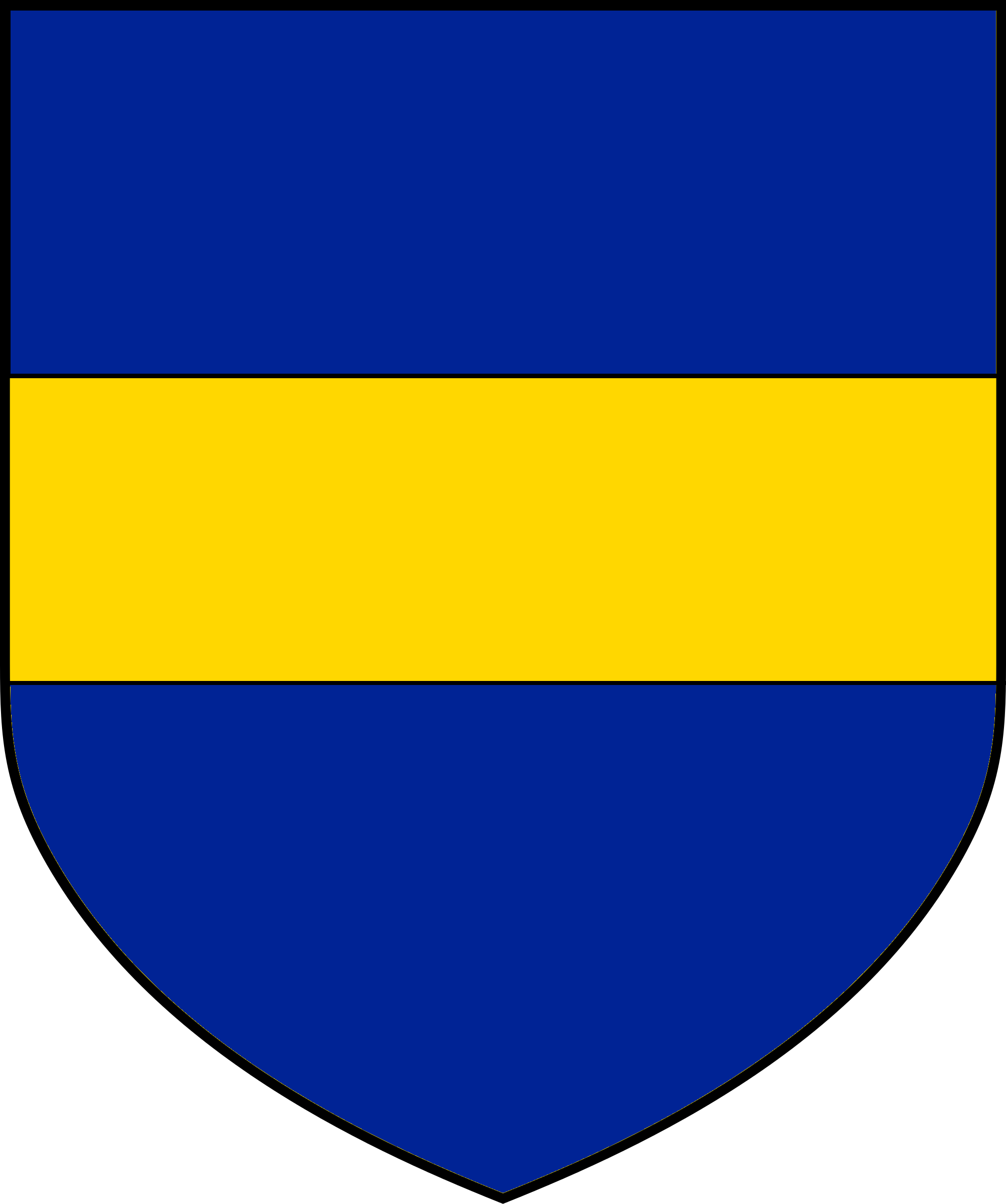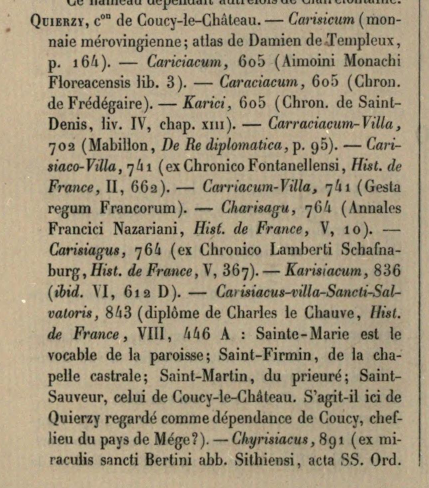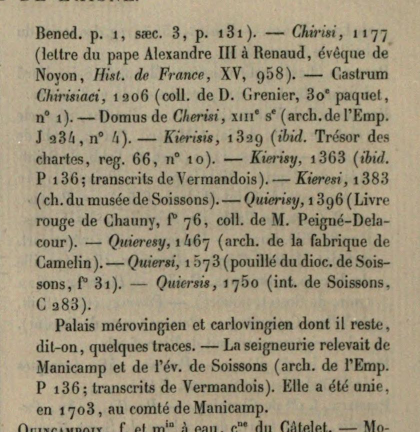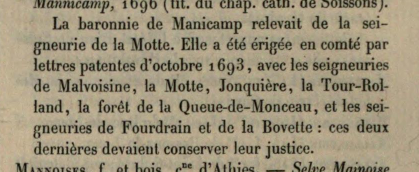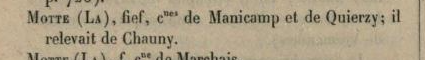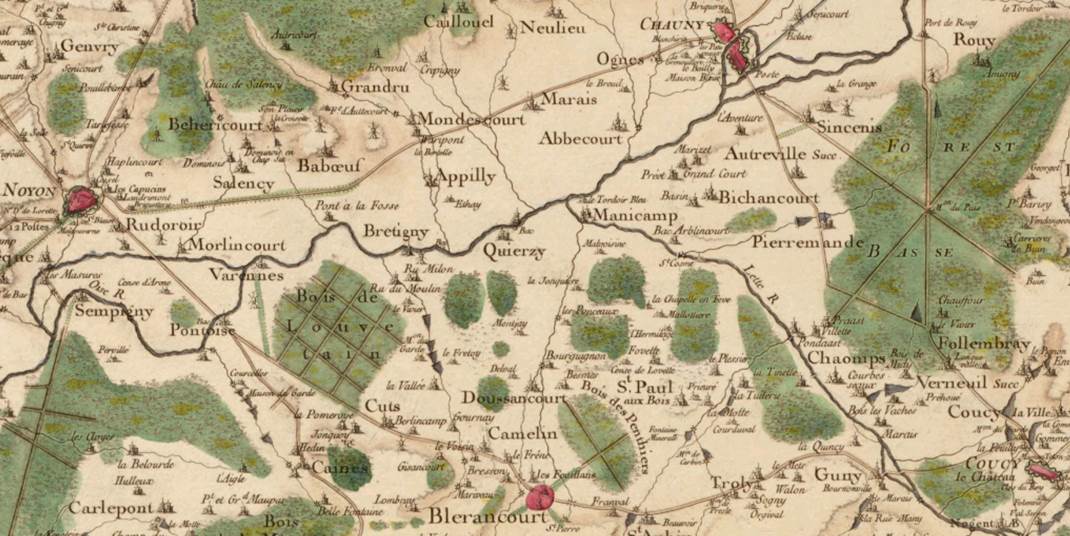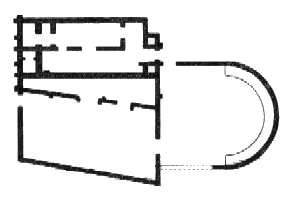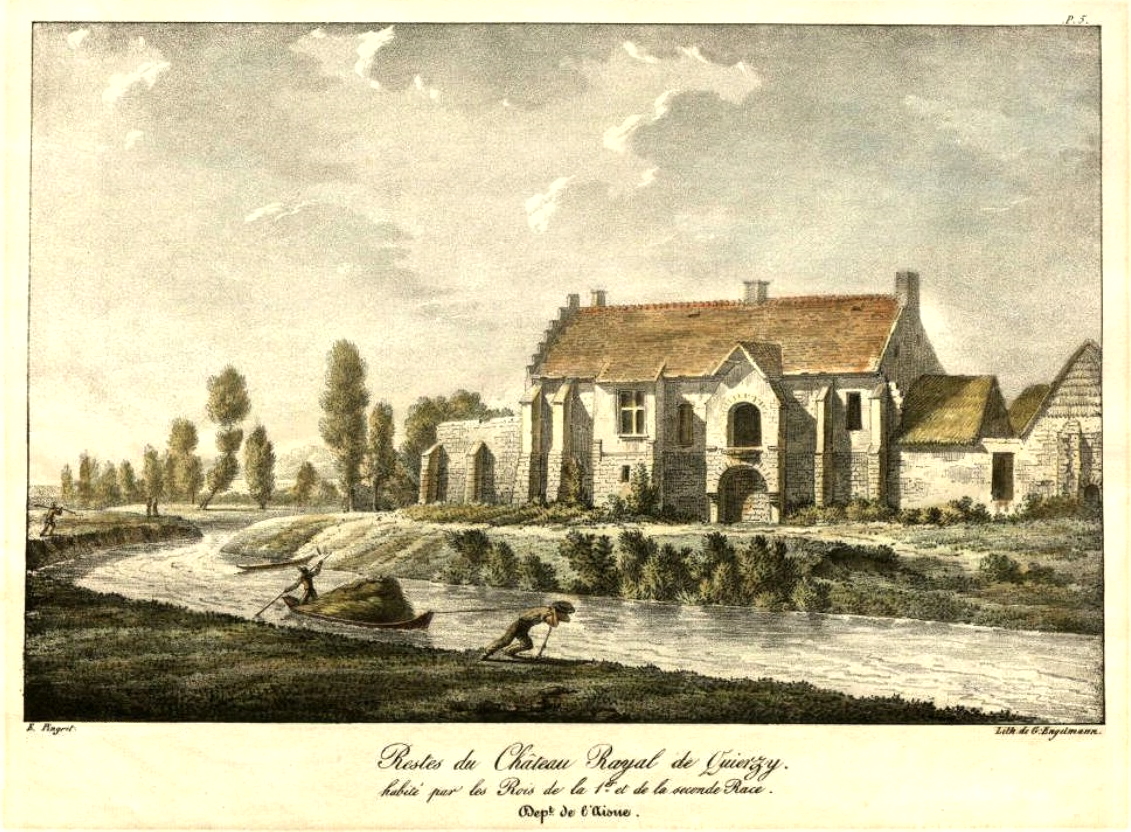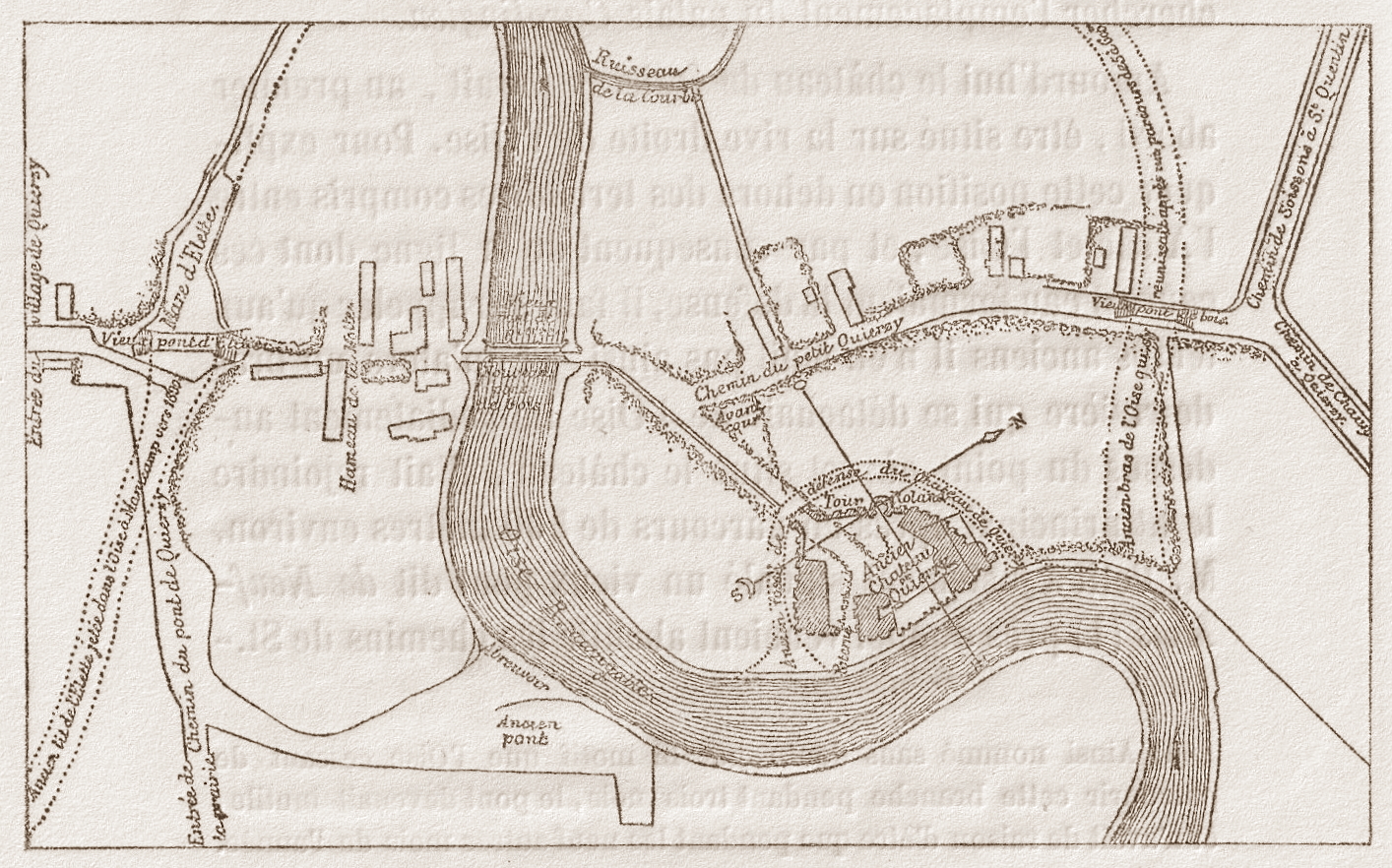|
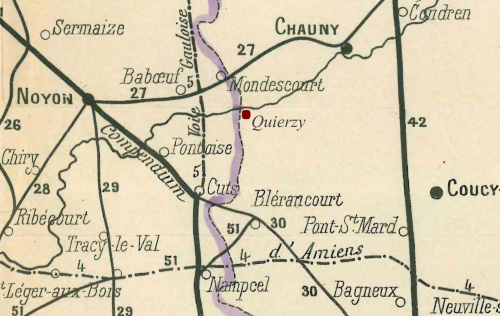
|
| Les voies romaines autour de Quierzy |
On doit, selon
l’historien Reinhold Kaiser, la
présence d'un palais royal à Quierzy aux
époques mérovingienne et
carolingienne à la proximité d'une route romaine
passant
l'Oise, trait commun aux palais de la civitas suessonum de Quierzy,
Compiègne, Berny-Rivière et Verberie, jouxtant
tous des endroits où des routes romaines passent l'Oise ou
l'Aisne (1).
Les points routiers où l'on passait la rivière
près de Quierzy étaient
Pontoise-lès-Noyon ou le castrum de Noyon
lui-même. C'était la Via Agrippa de Lugdunum
(Lyon), capitale la Gaule à Gesoriacum (Boulogne-sur-Mer),
port d'embarquement pour la (Grande) Bretagne, qui passait par
Durocortorum (Reims), capitale de la Gaule Belgique, Augusta Suessionum
(Soissons), Noviomagus (Noyon), Rodium (Roye), Samarobriva (Amiens),
...
Plus
tard, une voie mérovingienne de Compiègne
(point de passage de l'Oise) à Saint-Quentin (gué
permettant de franchir la Somme), traversait l'Oise à Quierzy pour
aller rejoindre la voie romaine d’Augusta Suessionum
(Soissons), point de passage de l'Aisne, à Augusta
Viromanduorum (Saint-Quentin).
Quierzy
se trouve également au confluant de l'Oise et de l'Ailette
(2), précisément à l'endroit
où l'Oise devient navigable, ce qui souligne, outre
l'habitude franque de s'installer près d'un cours d'eau,
l'importance de plus en plus grande des rivières en tant que
voies de communication.
Le palais se situait certainement entre l'Oise et l'Ailette, qui
forment très tôt des frontières
naturelles entre les territoires des Viromanduens établis au
nord de l'Oise, des Rèmes installés à
l'est de l'Ailette et les Suessions au sud de ces deux
rivières. Les territoires des différents peuples
de la Gaule étaient pour la plupart
déterminés par des limites naturelles, telles que
fleuves, le forêts ou les reliefs et lignes de
partage des eaux.
Autour de
Quierzy, ces
frontières naturelles demeurent jusqu'à la
révolution celle de
la Civitas Suessionum (capitale
Soissons) et du Pagus Suessionicus
autour de Soissons, puis du Diocèse
de Soissons, celle de la Civitas Viromanduorum (capitale
Saint-Quentin) et
du Pagus Noviomagensis autour de Noyon, puis du Diocèse de
Noyon, celle de la Civitas Remorum des Rèmes (capitale
Reims) et du Pagus Laudunensis autour de Laon, puis du
Diocèse de Laon.
La situation des palais près de l’Oise
(à équidistance de Soissons, Compiègne
et Laon pour ce qui est de Quierzy) dans une région
où les diocèses voisins s'entrecroisaient et se
neutralisaient, a peut-être préservé
les propriétés royales, dans les
époques de faiblesse, de la mainmise des églises.
A Quierzy, trois diocèses se rencontrent (3).
Enfin, l'établissement de domaines royaux et aristocratiques
par transfert des domaines de l'Etat romain dans le fisc
mérovingien reste difficile à
démontrer mais très probable. Clovis et ses fils
disposaient en tout cas d’un district fiscal très
étendu dans les régions de l’Oise, de
l’Aisne et de la Seine, c’est-à-dire
précisément dans le noyau de la puissance de
Syagrius (Royaume de Soissons) et la royauté
mérovingienne reste tributaire des traditions
léguées par le " Romanum
Rex Syagrius ".
Carisiacum désignerait la Domoculta, la
maison bien
située des préfets romains qui plaira aux rois
à
cause des agréments et des nombreuses commodités
qu'ils y
trouvaient.
Le capitulaire
de Quierzy de
juin 877 met en évidence l'importance du palais de Quierzy
avec ses forêts propices aux chasses royales, mais la place
essentielle de Quierzy parmi les palais carolingiens est bien
antérieure au règne de Charles le
Chauve : Du locus au palatium : naissance et
affirmation du palais de Quierzy à l’aube des
temps carolingiens, Josiane Barbier
_____
Notes et sources :
(1) Aspects de l'Histoire de la
civitas suessionum et du diocèse
de Soissons aux époques romaine et mérovingienne,
Reinhold Kaiser, Cahiers archéologiques de Picardie,
Année 1974, Volume 1, Numéro 1, pp. 115-122. Reinhold Kaiser
est l'auteur d'études concernant la
région de
Soissons publiées, avec plans et cartes, sous le titre de
Untersuchungen zur Geschichte der Civitas und Diozese Soissons in
romischer und merowingischer Zeit dans la série du
Rhemisches Archiv N° 89 (1973), par l'Institut
d’histoire régionale de l'Université de
Bonn.
(2) Le cours de l'Ailette a
été modifié en 1690 pour rejoindre
l'Oise entre Quierzy et Manicamp.
Les
villages de Quierzy et Manicamp restent rive ouest de
l’Ailette après 1690.
(3) Les diocèses, sous la
responsabilité d'un évêque ou d'un
archevêque, adoptées à partir du IIIe
siècle par l'Église latine, correspondent aux
circonscriptions territoriales de l'Empire romain pratiquement
maintenues jusqu’à la révolution : Le
Concile de Noyon de 814 cède quelques paroisses de la rive
gauche de l'Oise à l'évêque de Noyon :
Varesnes, Pontoise, Ourscamp, Carlepont, Tracy (Haut et Bas) et ne
rétablit donc pas la frontière antique de l'Oise.
Diocèses de
L'Aisne
Avant 1790, le Diocèse de
Soissons s'étendait au sud de l'Oise et sur la
rive ouest de l’Ailette : les villages de
Brétigny, Quierzy et Manicamp en faisait partie
même après 1690.
A l'est de l’Ailette, s'étendait le Diocèse de
Laon : la Motte de Quierzy, quelques maisons de
Manicamp, Bichancourt, Pierremande, Champs, …
A l'ouest de Brėtigny, depuis Varesnes inclus, et rive nord de
l’Oise jusqu’à Tergnier inclus (Beautor
La Fère exclus) s'étendait le Diocèse de
Noyon (Doyenné de Noyon à l'ouest
de Quierzy, Doyenné de Chauny à l'est).
Le territoire actuel de la commune de Quierzy relève ainsi
des trois diocèses mais le village, situé pour
l'essentiel au sud de l'Oise se trouve dans le Soissonnais aux confins du Noyonnais et
du Laonnois, tous trois pays de l'Île-de-France d'avant 1789.
Il existe de nombreux
écrits sur les fréquents séjours des
rois mérovingiens et carolingiens, qui affectionnaient la
campagne, sur leur "cher domaine", Carisiacum en latin, qui a
donné Chérisy puis Quierzy, idéalement
situé à la rencontre de l'Oise et de l'Ailette,
défendant les abords de la résidence et
permettant la pêche, au milieu de terres fertiles et de
forêts giboyeuses, assurant approvisionnement et loisirs.
Les Mérovingiens
(Ve siècle - 751)
Le document le plus ancien mentionnant "Caraciaco"
date de 605. Représentatif de l'époque, il a
trait à l'assassinat de Protade, Maire du Palais de
Bourgogne, qui permet d'éviter une des guerres fratricides
(entre Théodebert d'Austrasie et Thierry de Bourgogne) qui
marquent cette période.
On connaît ensuite, à partir
de 660, plusieurs actes signés à Quierzy par les
rois mérovingiens Clotaire III, Thierry III, Childebert III,
Thierry IV, Childéric III et Charles-Martel, Maire du Palais.
Ce dernier acte, de 741, mentionne à son
tour le "Palais de Quierzy". Le vainqueur de Poitiers (732) y meurt en
octobre de la même année.
Il est parfois fait mention de
monnaies frappées à Quierzy à cette
époque. Si Carisiaco correspond à Quierzy, sous Dagobert, des coins
préparés (la tête et le revers y étaient
déjà gravés sans la légende "moneta
palatina")
suivaient
le roi dans ses voyages et lorsqu’il
résidait en quelque lieu où l’on
n'avait pas la
commodité de fabriquer des pièces, on ajoutait le nom du palais ou maison
où le roi était alors, comme
Carisiaco, Banniaciaco, Catoiaco, Viriliaco. Les
ouvriers et officiers de cette monnaie étaient
commensaux
de la maison royale. La cour des monnaies de Paris a
conservé ce
privilége. (Abot De Bazinghem, Traité des
monnaies, t.
II, p. 91, art. monnaie.).

Les Carolingiens (751 - 987)
C'est surtout de la période
carolingienne que l'on possède de multiples
écrits dans l'Histoire de France confirmant l'importance de
Quierzy.
En janvier 754, Pépin le Bref
reçoit le Pape Etienne II à Quierzy; il s'agit
tout d'abord du premier déplacement d'un Pape en France, et
c'est là que Pépin signe la donation faite au
Pape de l'Exarchat de Ravenne, qui constitue l'acte de
création des États Pontificaux, domaine temporel
de la papauté, disparu en 1870.
En 754 toujours, Pépin
célèbre la fête de Pâques
à Quierzy et en 760, 761 et 764, entre deux campagnes
militaires, Noël et Pâques, selon une tradition
semble-t-il ancienne, qui fait présumer la naissance de
Charlemagne à Quierzy le lundi de Pâques 2 avril
742 ... (Cf
Abbé Carlet)

Charlemagne fait également de
fréquents séjours à Quierzy
où il signe un nombre important d'actes à partir
de 773. Il y passe l'hiver 775, y célèbre
Noël et Pâques. Il est encore à Quierzy
en juin de la même année. Il y passe l'hiver 781,
y célèbre Noël et Pâques.
En 804, Quierzy a l'honneur du principal
séjour du Pape Léon III auprès de
l'Empereur. Ils célèbrent là
Noël ensemble, avant de se rendre à Aix-la-Chapelle
fêter l'Épiphanie.
Louis le Pieux à son tour affectionne le
Palais de Quierzy, il y signe plusieurs actes à partir
d'octobre 820, alors qu'il passe là selon la coutume,
l'automne à chasser avant d'y réunir une
Assemblée à la fin de l'année. Il
reçoit ses fils Pépin et Louis à
Quierzy en 835 et s'y repose à la mi-carême.
En 838, l'Empereur réunit à
Quierzy une importante Assemblée
Générale, à laquelle assistent ses
fils Pépin et Charles, ainsi qu'un Synode
Général d'Evèques. C'est lors de cette
Assemblée que Charles reçoit à l'age
de 14 ans le Royaume d'Aquitaine.
Après la mort de son père,
Charles le Chauve revient rapidement à Quierzy où
il signe dès décembre 840 plusieurs actes et
réunit une diète, Lothaire menaçant la
Francia. En décembre 842, Charles convoque à
nouveau les Grands du Royaume à Quierzy pour
célébrer son mariage avec Hermantrude.
Plusieurs Conciles se tiennent à Quierzy
en 849, 853, 857, 858, ainsi qu'un synode comprovincial en 855. En 852,
Charles a passé l'hiver à Quierzy.
En mars 858, le roi rassemble ses grands vassaux
à Quierzy avant de marcher contre les Normands. Charles est
encore à Quierzy en août 860, en juillet 861, ...
, pour Noël en 862 et 865, ... En 876, au retour de son
couronnement à Rome, le roi de France revient à
Quierzy.
Enfin, en juin 877, Charles le Chauve convoque une
dernière assemblée avant de partir faire la
guerre au delà des Alpes et signe le fameux Capitulaire de
Quierzy.
Après sa mort au Mont-Cenis, la Reine
Richilde, sa seconde épouse, se retire à Quierzy.
Une nouvelle assemblée y a lieu en septembre 882.
Donation du
château de Quierzy
Après 891, les Normands s'installent dans la
région ;
Quierzy et ses environs sont complètement
détruits.
Hugues Capet, qui préfèrera résider en
ville,
donne à l'occasion de son couronnement ses terres de Quierzy
à l'Evêque de Noyon. Ce dernier y fait construire
une
forteresse pour se défendre du puissant seigneur de Coucy.
Philippe Ier confirme la donation vers 1068. Le castellam Carisiacum in
pago suessionico situm / castel de Quierzy situé dans le
pays du
Soissonnais, « parce qu'il est proche de son
évêché et qu'il est
nécessaire à son
église, pour la défendre contre les attaques
fréquentes des ennemis voisins » est
donné à
l'évêque de Noyon.
Dès 1070, les seigneurs se désignant de
Chérizy,
soutenu par ceux de Coucy, revendiquent le château de Quierzy.
En 1110, l’évêque de Noyon doit demander
l’intervention du roi de France, Louis-le-Gros, pour
reprendre
possession du château. Le roi fait alors abattre les murs de
la
forteresse, raser le manoir, avec défense de les
rétablir.
Plus tard, Louis VII accorde aux Chérisy la permission de
reconstruire son château, sous la condition de ne pas
l'entourer
de défenses et, en 1158, confirme les Chérisy
dans la
possession du domaine de Quierzy avec permission de relever les
fortifications du château, sous certaines conditions.
Au mois d'Août 1226, la cause est finalement
réglée
par un arbitrage : « la forteresse de Quierzy serait remise
à l'évêque de Noyon dans toute guerre
entreprise
pour lui ou pour les intérêts de son
évêché, contre tout autre que le sire
de Coucy
», « de même la dite forteresse serait
remise au sire
de Coucy ou à ses héritiers, dans toute guerre
entreprise
pour lui ou pour les intérêts de son domaine,
contre tout
autre que l'évêque de Noyon «
et « en
cas de guerre entre eux deux, elle resterait entre les mains des
seigneurs de Chérisy qui seraient obligés de
garder une
stricte neutralité. »
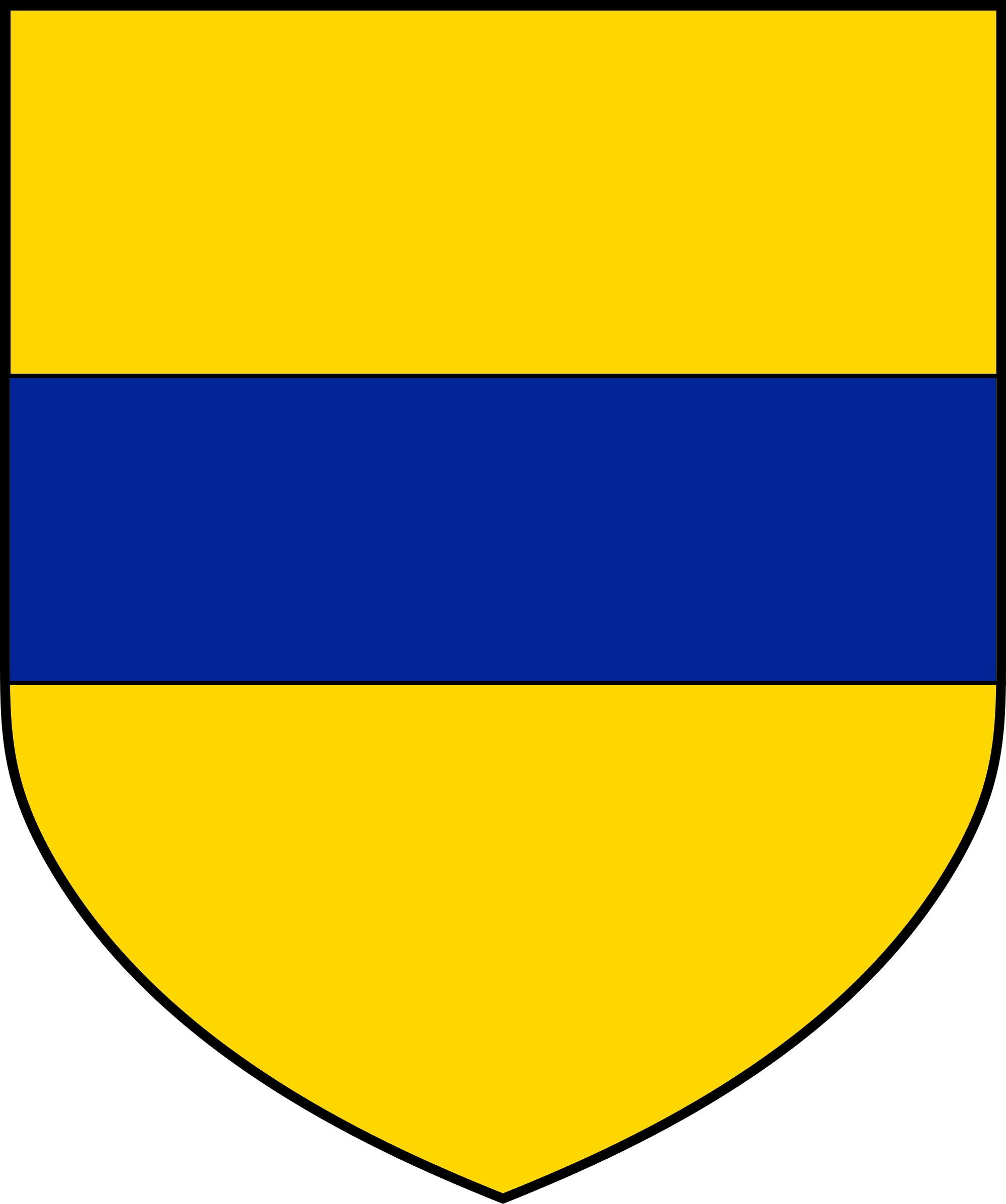 D'or à fasce
d'azur
D'or à fasce
d'azur
Couleurs de la famille De
Quierzy, ou De Chérisy, dont est issu notamment Nivelon de
Querzy ou de
Chérisy, mort en 1307 à Bari, 60e
évêque de Soissons et croisé, fils de
Gérard II, seigneur de Quierzy et d'Agnès de
Longpont.
|
|
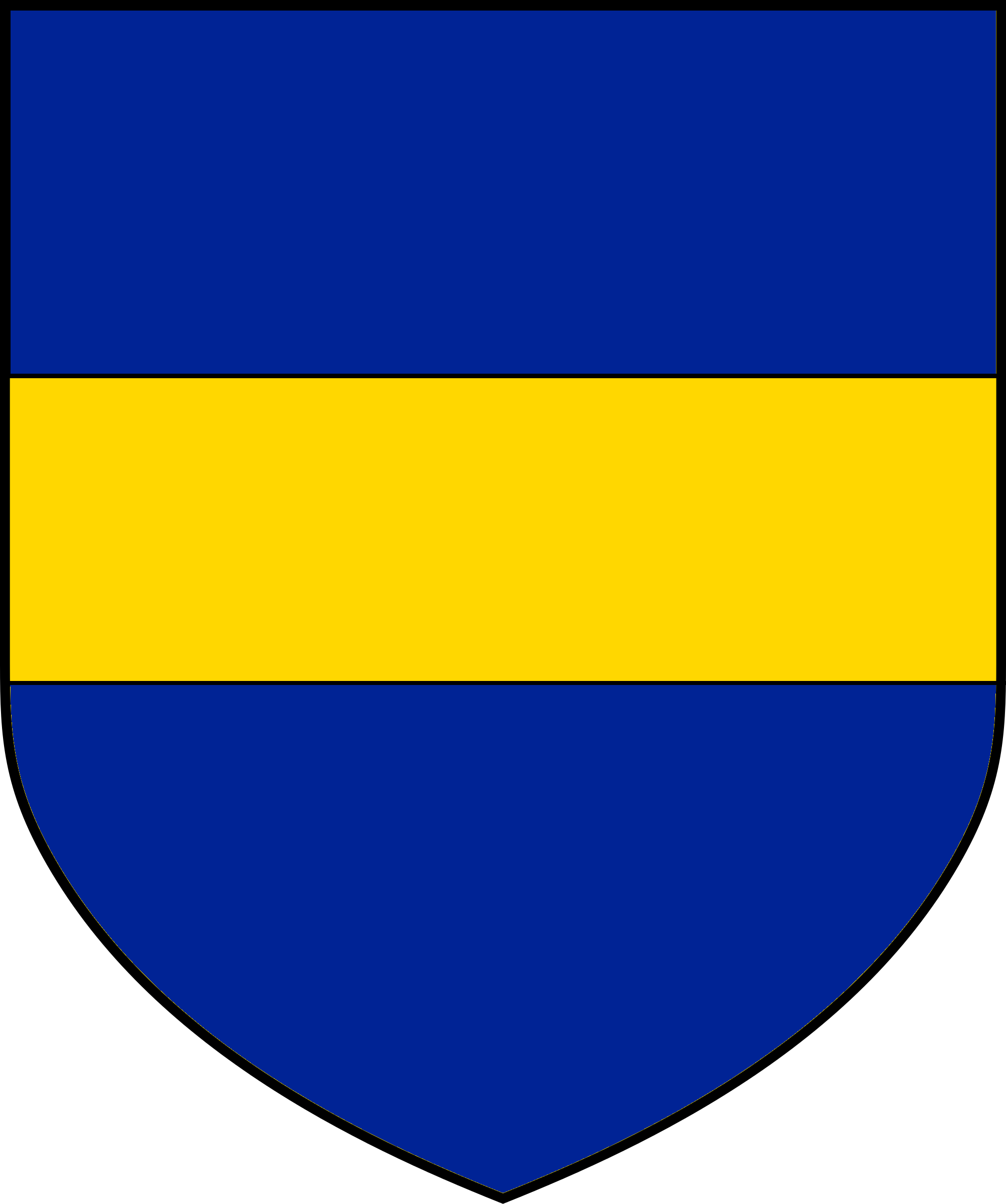
D'azur à fasce d'or
La commune de Quierzy utilise inversées les
couleurs de la famille De
Quierzy ou De Chérisy
|
Emiettement de la
terre de Quierzy
Dès le XIVe siècle, la terre de Quierzy, qui
comprenait
plusieurs fiefs, commence à s'émietter. On
distingue le
fief de Quierzy et Camelin, le fief de la Jonquière, le fief
de
La Motte et le fief de la Tour Roland.D'azur à la fasce
d'or.
La commune de Quierzy relève et inverse les couleurs de la
famille De Quierzy, ou De Chérisy, dont est issu notamment
Nivelon de Querzy ou de Chérisy, mort en 1307 à
Bari, 60e
évêque de Soissons et croisé, fils de
Gérard
II, seigneur de Quierzy et d'Agnès de Longpont.
- Le fief de Quierzy et Camelin
comprenait « Un manoir à Kierzy, entre les
fossés
et les murs qui sont entour, excepté la Tour de grez qui
siet
entre les maisons du dit manoir pardevers la rivière d'Oise
;
tout le village de Kierzy, excepté ce qui s'étend
entre
le pont de Clerc et le pont de Neuf-mois, avec la justice et seigneurie
jusqu'au rû du moulin de Pontchiaux (Poncel en 1600) ; les
terres
et le village de Camelin et les terres de Manicamp du
côté
de Chauny. »
- Le fief de La Motte
était situé entre le Pont de Clerc et le pont de
Neuf-mois, ce que l'on appelle aujourd'hui le hameau de Lamotte et le
petit Quierzy.
- Le fief de la Tour Roland
se trouvait au-delà de l'Oise, le pré de la Tour
Roland ?
Où s'élevait la tour de grez, siège de
ce fief ?
- Le fief de la Jonquière
s'étendait jusqu'au territoire de Saint-Paul-aux-Bois. Le
bois de Fêve en faisait partie.
Le fief de Quierzy
passe aux mains des Chérisy, puis des Montmorency,
des
Roye, des Halluin, Brûlart et Bussy-Rabutin
jusqu'à la
révolution.
Les paysans de la Jacquerie de 1358 gagnent le
Soissonnais, le Laonnois
et le Noyonnais. Ils y détruisent les forteresses. Quierzy
n’est pas épargné. La destruction de
l’église de la Capelette daterait de cette
époque.

Haut de page
|
|
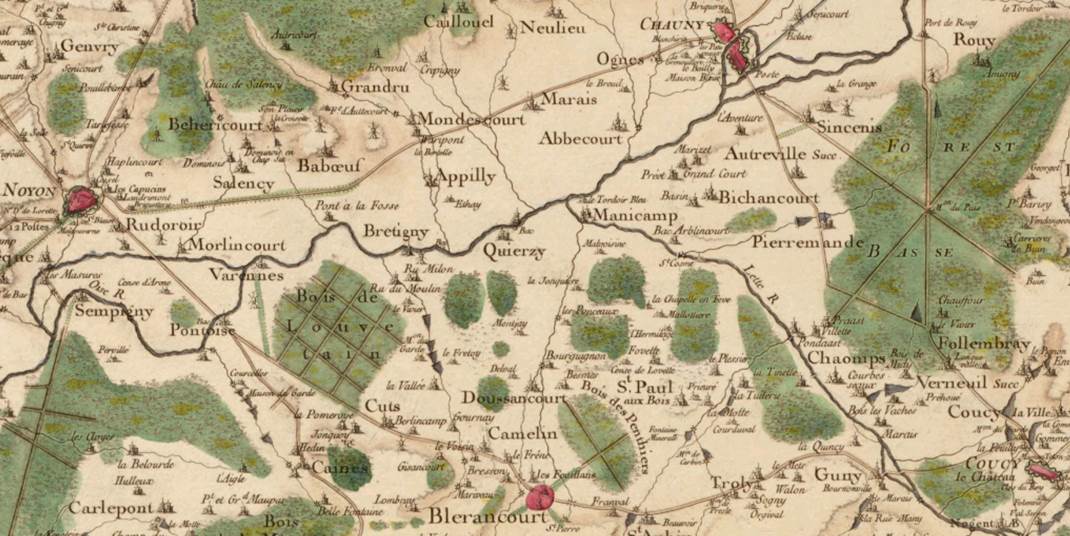
Extrait de la Carte des Cassini
La Capelette
|

|
| Plan
général des fouilles de 1916 (env. 130 m x 95 m) |
Il existait encore au XIXe siècle rive
gauche de l'ancien cours de l'Ailette des restes de murs qui permirent
d'entreprendre des fouilles et d'identifier, les "fondations d'une
ancienne église construite sur les ruines d'un ancien
château mérovingien" (Bulletin
Archéologique de Soissons, 1868). Capelette signifie petite
chapelle.
Avec ces premiers éléments,
de nouvelles fouilles sont entreprises en 1916 par
l'historien de l'art allemand Georg
Weise à la recherche du
palais de Charlemagne ...
Interrompues par les inondations puis la
reconquête de Quierzy par les français en mars
1917, les fouiles confirment l'importance du site.
Il a tout d'abord existé à
cet endroit une villa gallo-romaine du IVe siècle,
qui correspond à l'implantation par les romains sur le
déclin de colons (barbares infiltrés
pacifiquement) pour défendre l'empire et cultiver le sol.
La villa gallo-romaine est
généralement un ensemble en bois et torchis plus
ou moins fortifié entouré d'une palissade et d'un
fossé et regroupant dans une première cours les
communs, les logements du personnel du domaine, la basse-cours et dans
une seconde les greniers, les écuries et l'habitation du
propriétaire. Les villae plus importantes sont
dotées d'une forteresse ou d'une simple tour
protégée par un fossé qui sert
d'habitation. A proximité se trouvent des exploitations
familiales plus petites dépendantes de la villa.
Au siècle suivant, lors des grandes
invasions, les Francs constituent au nord de la Gaule un
véritable royaume, qui à l'avènement
de Clovis joint l'Oise au sud. Quierzy est sur la frontière
et c'est sans doute à cette époque que la villa
gallo-romaine fait place à une villa
mérovingienne semble-t-il plus petite,
fortifiée à la romaine avec donjon, palissade et
fossé.
|

|
Photo Roger
Agache
Quierzy : site royal en péril ?
Jean-Claude Malsy
Revue archéologique de l'Oise 1973 |
De ces greniers-forteresses,
Clovis part
à la conquête de la Gaule battant tout d'abord en
juillet 486 Syagrius à Soissons, dont il fait sa capitale.
A la mort de Clovis en 511, le royaume est
partagé entre ses fils, Quierzy est en Neustrie, sur la
frontière avec l'Austrasie. La forteresse
stratégique est certainement alors non seulement
améliorée mais aussi
fréquentée par les rois francs à la
recherche de l'unité du royaume, sur les traces de Clovis ...
Cette construction est très
tôt transformée en abbaye
fortifiée (Monastère Saint-Remy de
Quierzy ?).
Selon "l'archéologue aérien" Roger Agache, Quierzy serait parmi
les grands palais du haut Moyen Âge le seul dont
l'emplacement est discernable.
La Motte
|
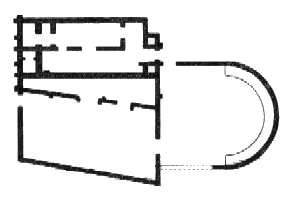
|
Plan
du Palais de
Samoussy (env. 90 m x 60 m)
avec son fossé semi-circulaire semblable à celui
de Quierzy
(d'après G. WEISE) |
Une nouvelle villa
mérovingienne est édifiée
plus près de l'Oise bien qu'il n'en soit fait mention
qu'ultérieurement, en 709. C'est cette seconde villa qui va
être agrandie pour devenir le
palais de Charles Martel et de ses descendants
Pépin le Bref, Charlemagne, Louis le Pieux, Charles le
Chauve.
Le palais carolingien est
généralement établi au centre
d'exploitations rurales plus petites et abrite une population de
paysans, d'artisans, de clercs, de fonctionnaires dans des
bâtiments plus ou moins grands. Il reçoit le roi
et sa suite au gré des fêtes religieuses, des
grandes chasses de printemps et d'automne, des assemblées
générales ou des expéditions
militaires. Il y eut également un atelier
monétaire à Quierzy.
La demeure est séparées des
bâtiments agricoles par un fossé ou un cours
d'eau. A Quierzy, les bras de l'Oise et de l'Ailette
formaient idéalement plusieurs bras et donc autant
d'enceintes. L'Ailette se jetait alors dans l'Oise à Quierzy
et non à Manicamp comme aujourd'hui. Il fut ainsi possible
d'établir à Quierzy un port sur l'Oise navigable.
Plusieurs ponts permettaient de franchir les
différents cours d'eau. Sur celui de la Fosse-Barre, le bras
nord de l'Oise, aujourd'hui à peu près recouvert
par le Canal Latéral à l'Oise, passait la voie
mérovingienne qui allait de Compiègne
à Saint-Quentin, en suivant la rive gauche de l'Oise
jusqu'à Quierzy, où elle traversait cette
rivière, pour aller rejoindre la voie romaine de Soissons
à Saint-Quentin.
Mais ces différents cours d'eau
expliquent également les hésitations des
historiens quant à la situation exacte du Palais de Quierzy
et les revendications territoriales le concernant. Selon que l'on prend
en effet l'un ou l'autre des bras de l'Oise et de l'Ailette pour le
principal, le Palais se trouve sur la rive gauche ou sur la rive droite
!
Or, la rive gauche de l'Oise appartenait
au Soissonnais et l'autre au Noyonnais
tandis que l'Ailette délimitait le Soissonnais du Laonnois.
Ainsi, le palais de Quierzy pouvait appartenir au Noyonnais, au
Soissonnais ou au Laonnois, et devenir terre de Neustrie ou
Soissonnaise, ... propriété de l'Evêque
de Noyon, réclamée par les Sires de Coucy une
fois la région dévastée à
la fin du IXe siècle par les Normands, qui se regroupent
dans le port de Quierzy.
Abandonné par les rois, le Palais royal
a fait place à une forteresse seigneuriale
(Evêques de Noyon / de Chérisy).
On devine encore aujourd'hui rive
droite de l'ancien cours de l'Ailette notamment un fossé
semi-circulaire identique à celui du Palais de Samoussy.
Le château
L'actuel
château
de Quierzy a
été rebâti au XVIe siècle
à l'emplacement de la forteresse des Evêques de
Noyon, aujourd'hui rive droite de l'Oise. Il y avait au nord du
château un "Ancien bras de l'Oise qui s'y
réunissait après un parcours de 5 à
600
m", selon le plan extrait des Recherches sur l'Emplacement de
Noviodunum et divers autres lieux du Soissonnais
de Peigné-Delacourt (1859). Un "vieux pont de bois"
traversant
ce bras nord menait aux chemins de Chauny à Quierzy
à
droite et Soissons à Saint-Quentin à
gauche.
Il existe encore une tour
visible à cet endroit, la tour Roland.
Château de Quierzy
(8
Fi 1228
8 Fi 1229,
8 Fi 1230)
Amédée
Piette (1808-1883) - Archives
Départementales de l'Aisne
Vue
générale de l'église de 1865, la porte
de
l'ancien prieuré au second plan (8 Fi 1223) - L'église de 1865 faisant face au face
sud-est, le prieuré à sa gauche (8 Fi 1224)
Amédée
Piette (1808-1883) - Archives
Départementales de l'Aisne
Le prieuré
Situé au coeur du
village actuel, le
prieuré (Saint-Martin ?) s'élevait à
l'origine à proximité du château
carolingien. Ce prieuré était vide de religieux
au XVIe siècle. Vendus en 1790, les bâtiments
furent en partie détruits. L'église primitive qui
existait encore au milieu du XIXe siècle, mais en mauvais
état, fut remplacée entre 1855 et 1865 par une
église néo-gothique, détruite au cours
de la Première Guerre mondiale
et remplacée par une nouvelle construite entre 1920
et 1930. De cet établissement
religieux clunisien, il ne reste aujourd'hui que les ruines du logis
prioral. Une tourelle en encorbellement du mur de clôture,
protégée MH en 1928, a disparue depuis
...
Porte de l'ancien
prieuré (8 Fi 1225), Porte et tourelle d'angle du
mur de l'ancien prieuré, clocher de
l'église à gauche (8 Fi 1227), Tourelle d'angle du mur de
l'ancien prieuré (8 Fi 1226)
Amédée
Piette (1808-1883) - Archives
Départementales de l'Aisne
Ce site fait
également l'objet de fouilles sommaires en 1916-1917
menées par Georg
Weise puis dans les années 70.
Les vestiges du logis
prioral en totalité, les murs d'enclos
incluant la base de l'ancienne tourelle d'angle disparue sont inscrits
MH depuis 2007, au moment
d'un projet de destruction initié
soutenu par le
maire de la
commune
!



Plan
de la villa mérovingienne du prieuré (G. Weise)

Aujourd'hui,
une simple pierre au centre du village
rappelle la prestigieuse histoire de Quierzy.
|
Bibliographie
sommaire
Melleville - Notice historique
sur Quierzy ; Paris, Dumoulin. - In-8° de 3 f.
1/4 - 1853
Ferdinand
Lot lien - Les jugements d'Aix et de Quierzy (28 avril et 6 septembre
838) - Bibliothèque de l'école des
chartes - Année 1921 - Volume 82 - Numéro 1
- p.
281-315
Abbé
Th. Carlet / Abbé N. Caillet - Annales
de Quierzy - publiées en 1935 par
le
Comité Archéologique et Historique de Noyon (Ed.
A. Baticle - Chauny).
Merci à Alain Labruyère.
|
Nous
devons également au Chanoine Carlet
l’ancienne église de Quierzy qu’il
souhaitait « digne
non seulement de la religion catholique,
mais aussi des souvenirs qui donnent à ce village une place
intéressante dans l'histoire de l'Eglise et de la France
».
Le chanoine Carlet aurait désiré graver sur le
fronton de l'église nouvelle cette pensée
cueillie dans un diplôme de Thierry IV :
«
En
maintenant les œuvres de nos ancêtres, nous
assurons la stabilité des nôtres
».
|
L'Abbé
Carlet
mentionne plusieurs notices sur le Palais Royal de Quierzy :
- Damien de Templeux,
Description du Duché de Valois
- Hadrien de Valois,
Notitia Galliarum
- Mabillon, Disquisitio de
Carisiaco traduit en français par Bruzen de la
Martinière, Grand Dictionnaire Géographique
- P. Christophe
Labbé, Histoire Manuscrite de Chauny, 1715
- L'Abbé
Carlier, Histoire du Duché de Valois
- L'Abbé
Colliette, Mémoires pour le Vermandois
- M. Melleville,
Historiographie du Département de l'Aisne, 1851
- M. Suin, Historiographie
du Département de l'Aisne, 1849
- M. le Baron de la
Fons-Melicocq, ?, vers 1855
- M.
Peigné-Delacourt, Supplément aux Recherches sur
l'emplacement de Noviodunum et de divers autres lieux du Soissonnais,
1859
- M. Petit, renseignements
fournis aux assises de la Société des Antiquaires
de Picardie, en l856
- M. Poquet, Rapport
à l'occasion d'une visite de la
Société Soissonnaise à Manicamp et
Quierzy
J
F L Devisme, Manuel
Historique du Département de l'Aisne, Laon, 1826
Dietrich
Lohrmann, Trois
palais
royaux de la vallée de l'Oise d'après les travaux
des érudits mauristes
: Compiègne, Choisy-au-Bac et Quierzy, 1976
Jean-Claude
Malsy - Quierzy : site royal en péril ? Revue
archéologique de l'Oise - Année 1973 - Volume 3 -
Numéro 1 p. 11
Georges
Samson - Le Palais de Quierzy et les
villas dépendantes de celui-ci du VIe au Xe siècle
- publié vers 1973 par le Groupe
Archéologique du
Noyonnais
Kaiser Reinhold. Aspects de
l'Histoire de la civitas suessionum et du diocèse de
Soissons aux époques romaine et mérovingienne
- Cahiers archéologiques de Picardie. N°1, 1974. pp.
115-122 (PDF
1,2
Mo)
Philippe Racinet -Les
prieurés clunisiens en Picardie au Moyen Age et au
XVIème siècle - Revue
archéologique de Picardie - Année 1982 -Volume 4
- Numéro 1 - pp. 199-230
Georges Samson - Essai de
datation du site carolingien de Quierzy-sur-Oise - Revue
archéologique de Picardie - Année 1985 - Volume 1
- Numéro 1 - pp. 132-136 (PDF 1,2
Mo)
Philippe
Racinet - Bretigny, Quierzy et Notre-Dame-en-Faves : trois
prieurés clunisiens au nord du diocèse de
Soissons (XIIe-XVIe siècles) - Revue
archéologique de Picardie lien Année 1989 -
Volume 3 - Numéro 1 - pp. 229-236
Pierre Riché
- La vie quotidienne dans l'empire carolingien
- Hachette 1973
François-Guillaume
Lorrain - Quierzy, capitale de la France
- "Voyage en France : retour sur quelques
lieux qui ont
fait notre pays" Le Point
http://www.lepoint.fr/histoire/quierzy-capitale-de-la-france-1-28-02-2015-1908676_1615.php
http://www.lepoint.fr/histoire/quierzy-capitale-de-la-france-2-01-03-2015-1908832_1615.php
Ce
travail a été également
réalisé grâce aux notes de
mes grand-parents, qui furent respectivement Institutrice et
Secrétaire de Mairie à Quierzy, aux recherches
commencées par mon père, ...
Archives
départementales de l'Aisne

Haut de page
|