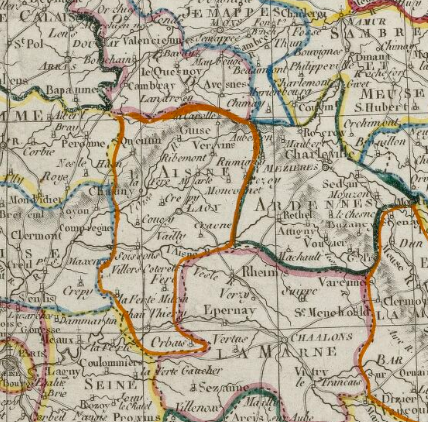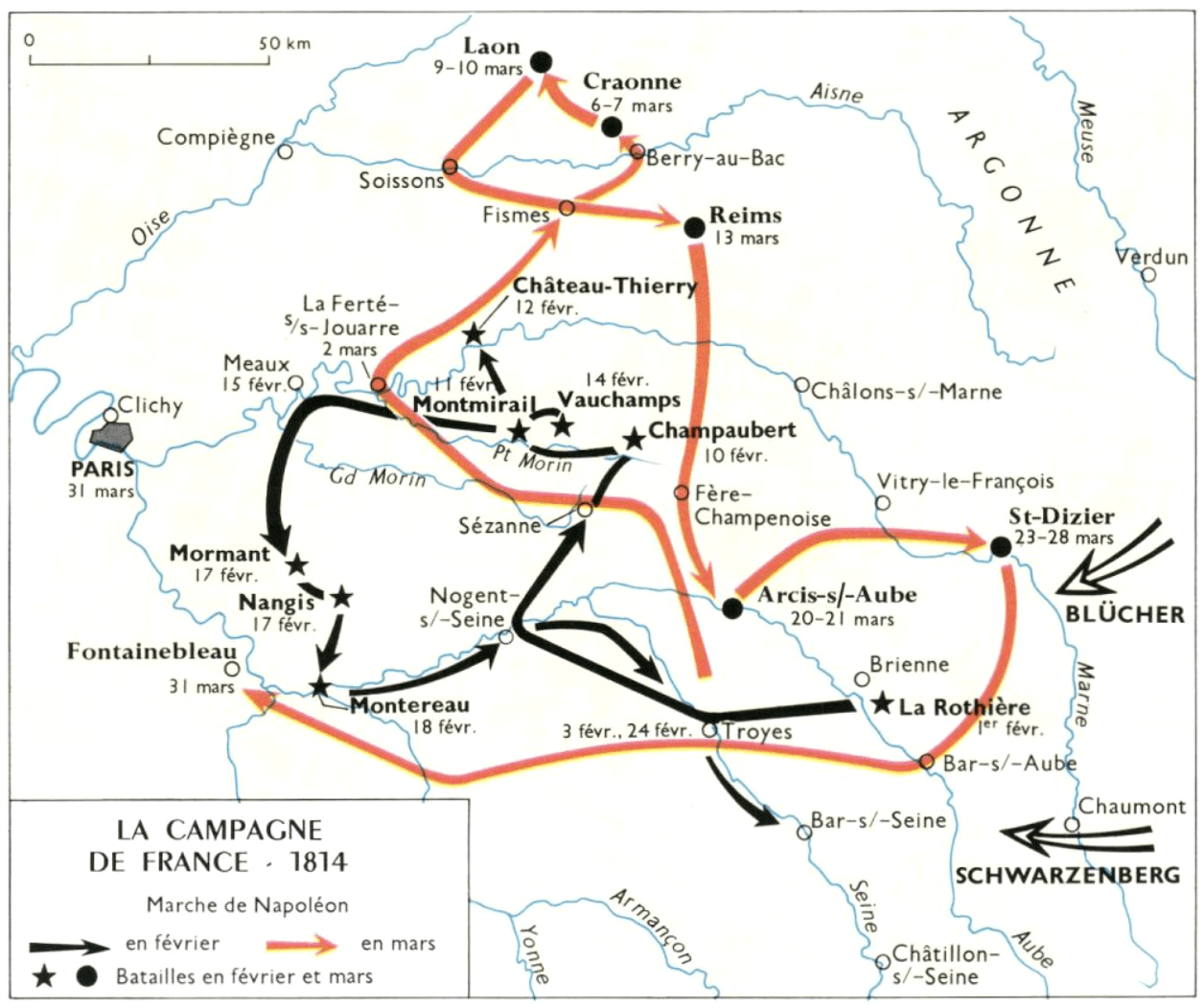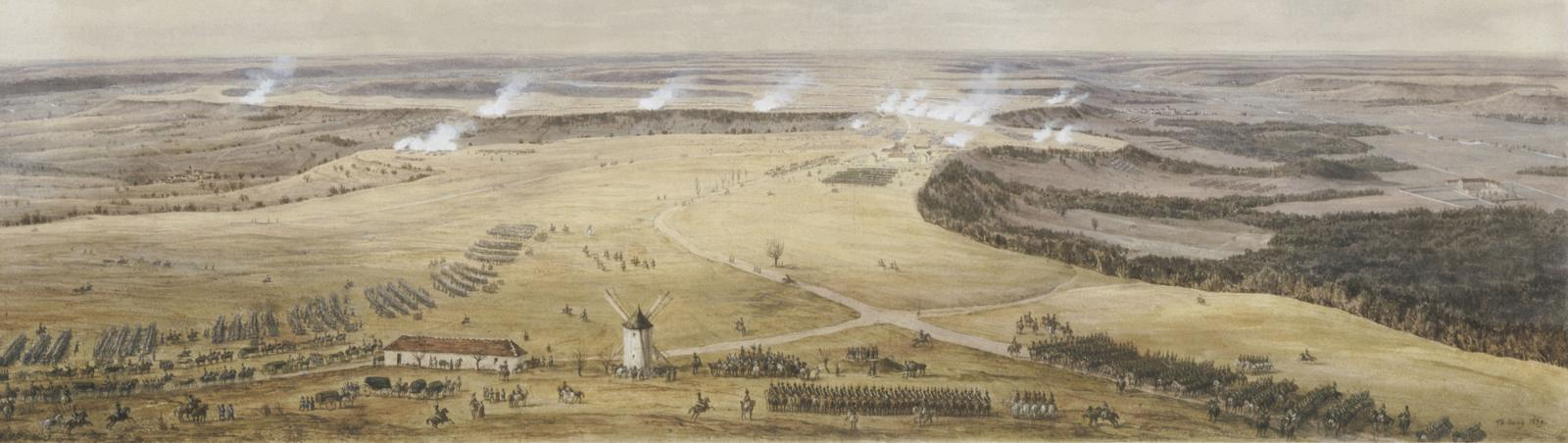La campagne de France de 1814
dans
l'Aisne
Au cours des premiers mois de l’année
1814,
qui marquent la fin du régime impérial, les
soldats de Napoléon vont combattre dans l’Aisne
sur les lieux mêmes où cent ans plus tard, les
Poilus combattront à leur tour : Château-Thierry, Craonne, Berry-au-Bac,
Soissons, ... La population civile souffre également des
combats, destructions et réquisitions, qui
désolent les villes et les campagnes, mais aussi des
exactions des troupes étrangères, qui ne sont pas
que des actes isolés.
D'autant que le département est menacé,
début 1814, au nord-est par les troupes
détachées par Bernadotte et au sud-est par celles
de Blücher.
En décembre 1813, l'armée du Nord,
commandée par le prince royal de Suède
Bernadotte, a envahi sans résistance la Hollande
dépourvue de troupes françaises et s'est
avancé vers
la Belgique alors occupée par la France. La
frontière
nord de la France est presque
totalement dégarnie pour faire face aux armées
coalisées. L'armée française en 1814,
décimée par les défaites et les
épidémies, a le plus grand mal à
assurer la conscription. Le 17 décembre 1813,
Napoléon ordonne de rétablir la Garde Nationale
pour veiller sur les places de l'intérieur, mais par
décret du 30 décembre, la moitié des
gardes nationaux de l'Aisne, avec ceux de l'Eure-et-Loir, du Loiret et
de l'Oise, sont envoyés à Meaux rejoindre
l'armée de Napoléon.
Le 10 janvier 1814, un décret renouvelant celui de la
mobilisation de 1792, ordonne la création d'un grand camp
retranché à Soissons pour couvrir les
frontières du Nord et des Ardennes. La conscription
rencontre peu de résistance active, bien que des
réfractaires se cachent dans les forêts, mais
l'état d'esprit de la population est sans enthousiasme et il
impossible de trouver des fusils utilisables, on doit
réquisitionner les fusils de chasse, les uniformes et effets
militaires manquent, le baron Malouet, préfet de l'Aisne,
doit engager sa fortune personnelle pour équiper les
recrues.
Les habitants apprennent l'invasion des départements de
l'est, dont les dépôts militaires sont
déplacés vers l’ouest. Des
réfugiés des Ardennes arrivent à
Soissons où une compagnie de Garde nationale est
levée le 21 janvier. Le général de
division Rusca est nommé commandant du camp
retranché de Soissons, où doivent se rassembler
les gardes nationaux de l'Aisne et d’autres.
Le 5 février, le corps d'armée russe du
général Wintzingerode,
détaché de l'armée du Nord de
Bernadotte qui vient d'occuper la Belgique, atteint Philippeville.
Rejoint par celui de Vorontsov, il entre en France le 6 avec
14 000 fantassins et 12 000 cavaliers pour
aller faire sa jonction avec l'armée de Silésie
de Blücher par Laon et Soissons.
Le 9 février, les cosaques de Tchernychev arrivent
à Avesnes-sur-Helpe, une des places de l'ancienne ceinture
fortifiée de Vauban. L'hiver est exceptionnellement froid et
le gel permet aux troupes d'invasion de manœuvrer sur des
chemins d’ordinaire impraticables. Un détachement
de cosaques, l'avant-garde de Tzernitschoff, se dirige vers Chauny et
Laon.
Le préfet de Laon, apprenant que l'armée ennemie
est proche, prépare l'évacuation des
administrations civiles et militaires vers La Fère. Elles
quittent la ville le soir du 11 février et les Russes y
entrent le lendemain tandis que Soissons reçoit les
administrations et un grand nombre de fugitifs de Reims. Une cargaison
de 2 000 fusils arrive de Paris le soir du 12
février. Beaucoup d'hommes n'auront pas le temps
d’apprendre à s’en servir.
Le 12, tandis qu'au sud Napoléon poursuit les
Russo-Prussiens en direction de Château-Thierry afin de parfaire sa victoire
à Montmirail, Wintzingerode occupe Laon et arrive devant
Soissons, prise
d'assaut le 14. Wintzingerode apprend alors les défaites
subies par Blücher et reçoit l'ordre de le
rejoindre à Epernay ; il évacue Soissons
où les troupes françaises rentrent le
lendemain.
Le
25 février, une colonne volante du colonel von
Geismar (avant-garde du 3e
corps d’armée d’Allemagne) est entrée dans Roye avec un régiment
de cosaques du Don, un escadron de Uhlans
et un escadron de
Hussards saxons. Les cosaques investissent
Noyon par la porte d’Huez dans la nuit du 25 au 26
février, vers une heure
du matin.
Dès le lendemain, ils quittent Noyon pour se
rendre à Chauny, pillant tout sur leur
chemin. Le 27, après s’être
avancée jusqu’à La Fère
où elle est reçue à
coups de canon, la troupe revient sur ses pas et
stationne de nouveau à Chauny et Noyon non
sans semer la terreur chez l’habitant.
Le
27
février, Bülow, qui se dirige aussi vers
le sud par Laon, assiège la faible garnison de La
Fère, commandée par le Colonel
d’artillerie Pommereuil. Ce dernier se rend se rend
après un
court bombardement. Les Prussiens occupent la ville jusqu’au
22 mai suivant pillant l’Arsenal de fond en
comble et accablant la ville et le canton de
réquisitions et de privations tout en répandant
une proclamation
annonçant que les alliés ne venaient pas pour
combattre la France mais pour libérer les peuples
opprimés par Napoléon.
Soissons change encore de mains plusieurs fois pendant cette
campagne : assiégée le 2 mars par les
corps réunis de Bülow et Wintzingerode, elle
capitule le lendemain tandis que Blücher ayant
repris son offensive sur Paris, Napoléon est parti
à sa
rencontre. La chute de Soissons, basculement de la
campagne, empêche Napoléon
d’atteindre
l’Aisne et les rencontres ont lieu à Berry-au-Bac
le 5, Craonne le 7,
victoires françaises, et à Laon, qui voit
l’échec de nos troupes les 9
et 10.
Attaquée
et reprise par les
Français le 5 mars, les
coalisés assiègent encore Soissons du 20
au 31 mars sans pouvoir
l'emporter ; ils se contentent ensuite d'un blocus
à distance jusqu'à la fin de la guerre.
Lorsque les Cosaques
quittent rapidement Noyon mais le 13 mars, la ville connaît une nouvelle
occupation. Deux régiments prussiens, un
de cavalerie et un d’infanterie, entrent « en
conquérant » dans la ville. Il s’agit d’unités du 3e
corps de l’armée prussienne de Bülow. Les mille « hussards de la
mort prussiens » sont logés chez l’habitant.
Des hommes en
patrouilles partent en reconnaissance dans les
environs, inspectant les collines et les sentiers et
contrôlant chaque personne rencontrée.
Durant cette période, Noyon verra le passage
d’un corps de six mille cavaliers, d’un régiment
d’artillerie, de deux mille hussards de la mort, de
sept mille autres soldats...
L’occupation s’achèvera le 31 mars 1814, date à
laquelle les troupes quitteront Noyon pour faire le
siège de Compiègne au cours duquel s’illustrera
le major Otenin.
A Noyon, une rue du Champ des
Cosaques rappelle l’occupation de la ville par les
troupes du colonel von Geismar.
Napoléon Ier abdique le 11 avril 1814 puis signe le 13 avril
le traité de Fontainebleau et est envoyé en exil
sur l’île d’Elbe.
Commence alors la première occupation du
territoire d’avril à juin 1814. Les cantonnements
des troupes alliées sont répartis comme
suit :
Grande armée alliée :
Garde impériale russe et réserve, plus la Garde
autrichienne, à Paris
Intendance en Seine-et-Oise
Armée de Silésie :
Corps Vorontsov dans l'Oise
Corps Langeron dans l'Aisne
Le 30 mai 1814, les coalisés signent avec le nouveau royaume
de France le premier traité de Paris. Les alliés
décident de rester
jusqu’à l’établissement
d’une constitution royale. Le 4 juin 1814, Louis XVIII
octroie la Charte constitutionnelle. Rassurée par le nouveau
régime et le réel désir de paix de la
population française, les troupes alliées
évacuent peu à peu le territoire.
A partir du mois de mai 1814, les troupes
coalisées prennent la route du retour. Les habitants de Noyon les voient passer
« pendant au moins huit jours par 10 ou 12.000 à
la fois, avec voitures chargées de grains, farine,
vivres de toute espèce et quantité de bétail ».
Chronologie
12 février 1814 : Bataille de Château-Thierry
14 février 1814 : prise de Soissons
22 février 1814 : deuxième combat de
Château-Thierry.
28 février 1814 : reddition de La Fère
2 mars 1814 : reddition de Soissons
3 mars 1814 : Neuilly-Saint-Front
4 mars 1814 : Combat de Montfaucon
5 mars 1814. Combats de Braine
5 mars 1814 : Combat de Berry-au-Bac
7 mars 1814 : Bataille de Craonne
9 mars 1814 : bataille de Laon
14 mars 1814 : affaire de Berry-au-Bac
15 mars 1814 : Une colonne prussienne venant de Noyon se
présente devant Compiègne. |
L'héritage
de 1814
En 1814, le
plan des alliés pour envahir la France,
prévoit
d’emprunter les vallées des grandes
rivières menant à Paris,
l’Oise (armée du Nord de Bernadotte),
l’Aisne, la Marne (armée de
Silésie de Blücher), l’Aube et
la Seine
(armée de Bohème de Schwarzenberg).
Les traités de Vienne (1815), puis de Versailles (1871)
laissent aux Allemands ces voies
d’accès à la capitale
française ouvertes. Face à cette menace, le haut
commandement
français va s’inspirer des combats
menés
par Napoléon pour concevoir son plan de
défense !
Le général Séré de
Rivières, chargé de fortifier les
frontières du
nord et de l’est, établit un
dispositif avec des points de blocage des
accès aux cinq vallées dans les secteurs
où l’Empereur avait obtenu ses succès
les plus significatifs en 1814.
Dans l’Aisne, il vérouille la vallée de
l’Oise à Guise et au nord de la Fère et
celles de
l’Aisne et de l’Ailette en s’appuyant sur
les premières élévations du massif
karstique de l’Île-de-France à Laon, qui
est
fortifiée, et appuyée
par les fortifications de Bruyères, Montbérault
et Mons-en-Laonnois. Ces dispositifs sont
complétés par le fort de la Malmaison,
qui couvre l’Ailette et celui de
Condé l’Aisne.
Enfin, le commandement organise des manœuvres dans
le
secteur entre Berry-au-Bac et Laffaux s’inspirant de la
bataille de Craonne du 7 mars 1814.
Ces défenses seront progressivement abandonnées,
permettant aux
Allemands de s’approcher de Paris en 1914.
Les batailles de
Soissons
486, Clovis contre Syagrius,
718, Charles Martel contre Chilpéric II, Rainfroi et Eudes
d'Aquitaine,
923, Charles III contre Robert Ier,
978, Lothaire et Hugues Capet contre Otton II,
1414, durant la guerre de Cent Ans, siège de la vile
défendue par Enguerrand de Bournonville et prise par Charles
VI de France,
1814 et 1815, sièges de Soissons,
14 février 1814, pendant la campagne de France, les troupes
russes d'Alexandre Tchernychev prennent d'assaut la ville
défendue par des conscrits peu exercés, leur
chef, le général Rusca, est tué dans
la bataille,
3 mars 1814, la ville se rend aux forces conjointes russes et
prussiennes,
5 mars 1814, attaque par les troupes françaises, les Russes
repoussent l'attaque mais évacuent la ville deux jours plus
tard,
20 au 31 mars 1814, les Prussiens de Bülow
assiègent encore la ville, défendue par le
commandant Gérard sans pouvoir l'emporter, la ville
résiste et les assiégeants se retirent pour
marcher sur Paris,
Juillet-aout 1815, blocus de la ville par le corps russe du
général Ouchakov (septième coalition),
11 septembre au 16 octobre 1870, siège de la ville durant la
guerre de 1870,
31 août 1914, prise de Soissons par les Allemands,
12 septembre 1914, reprise de Soissons par les Français
durant la première bataille de la Marne,
Janvier 1915, bataille de Crouy,
Juillet 1918, bataille du Soissonnais,
7 et 8 juin 1940, les légionnaires du 12e
régiment étranger d’infanterie
défendent l’Aisne à Soissons,
28 août 1944, libération de Soissons par la 3e DB
US. |
|