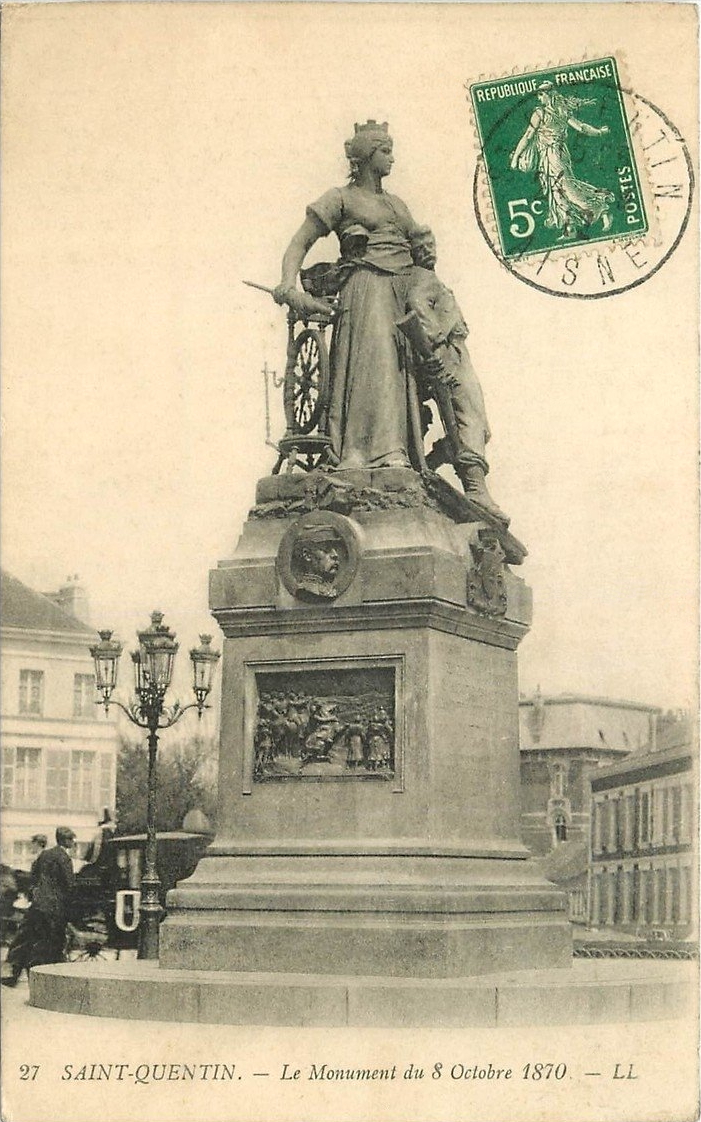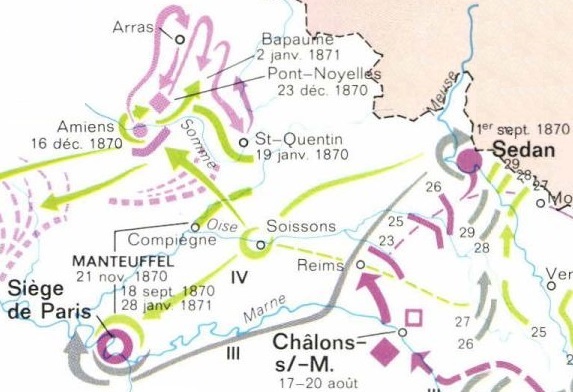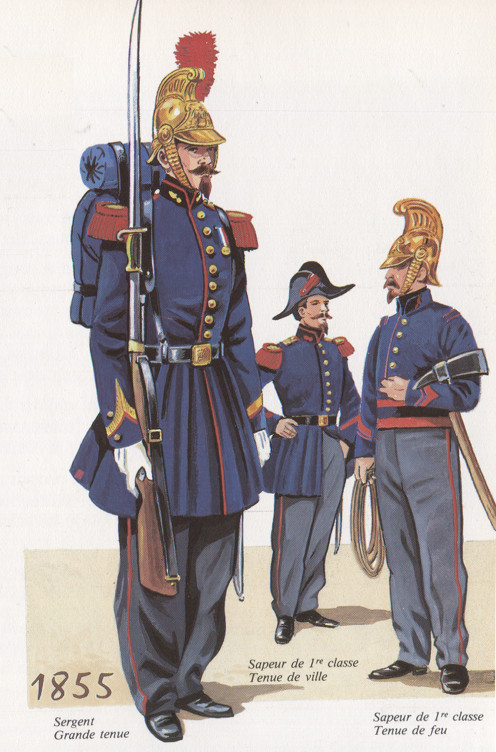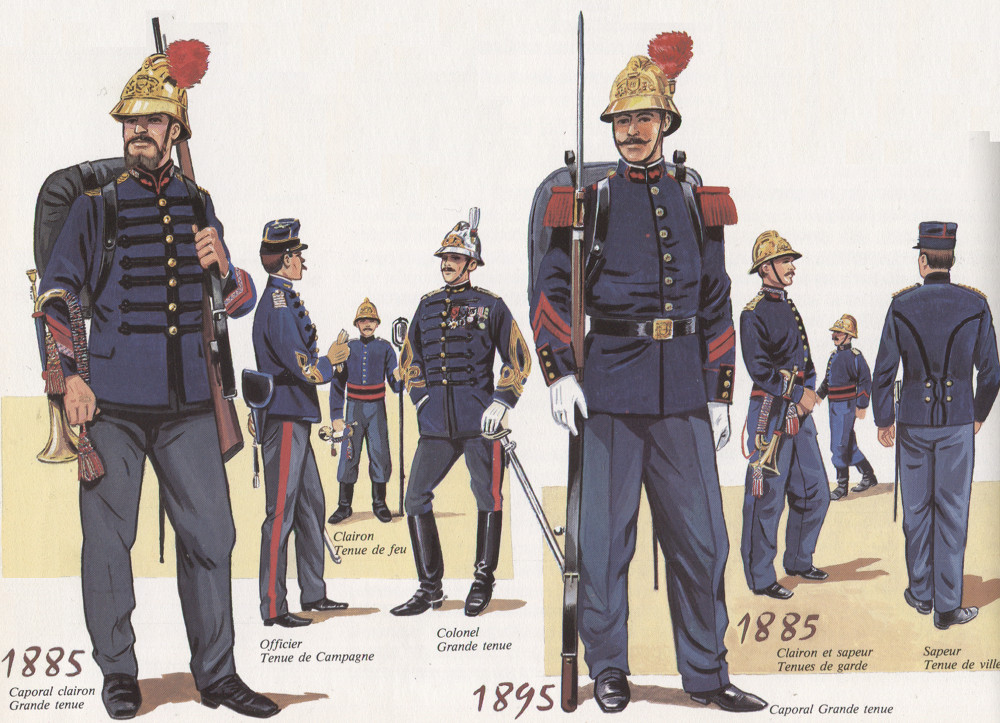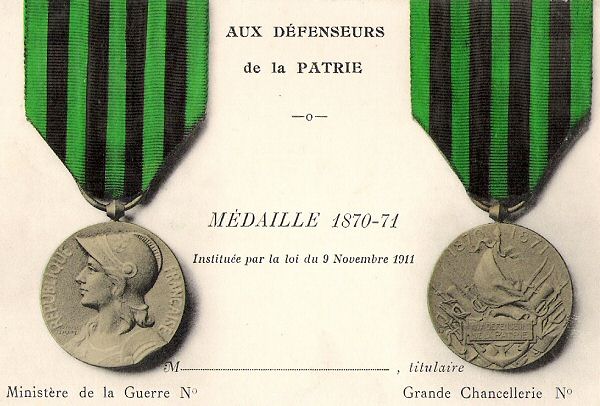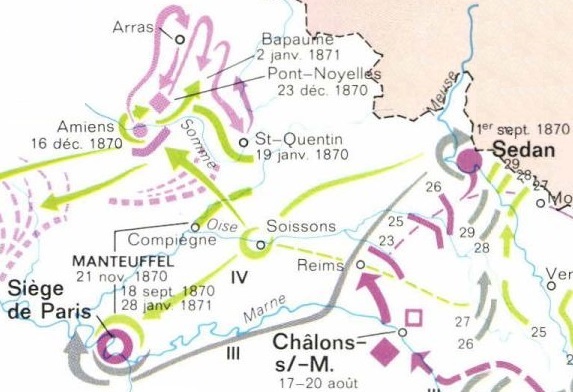
Carte des
opérations autour de Quierzy en 1870-1871
|
Chronologie
19 juillet 1870, déclaration de guerre
entre la France et la Prusse
2 septembre 1870,
défaite de Sedan
4 septembre 1870, constitution du Gouvernement de la Défense
Nationale
9 septembre 1870, explosion de la poudrière de Laon lors de
l’arivée des prussiens
11 septembre au 16 octobre 1870, siège de Soissons
8 octobre 1870, la population de Saint-Quentin repousse les prussiens
21 octobre 1870, prise de Saint-Quentin
28 octobre 1870, fin du siège de Metz
5 au 27 novembre 1870, siège de La Fère
18 novembre 1870, formation de l’armée du Nord
Novembre 1870, regroupement sur l’Oise des prussiens
pour la bataille d’Amiens
27 novembre 1870, bataille de Villers-Bretonneux pour Amiens
1er décembre 1870, capitulation de la citadelle d'Amiens
19 janvier 1871, bataille de Saint-Quentin
26 janvier 1871, capitulation de Paris
28 janvier 1871, signature de l’armistice
10 mai 1871, signature du traité de Francfort
Fin juillet 1871, fin de l’occupation du
département de l’Oise
21 octobre 1871, fin de l’occupation du
département de
l’Aisne
Juillet 1873, fin de l’occupation des départements
des Ardennes et de la Marne |
|
Considérée par le premier ministre prussien
Bismarck comme une conséquence de la défaite
prussienne lors de la bataille d'Iéna de 1806 contre
l'Empire français, la guerre entre l’Empire
français et le royaume de Prusse est
déclarée le 19 juillet 1870. Mal
préparées et mal commandées, les
armées françaises sont défaites
à plusieurs reprises début août sur le
front de l'Est. Napoléon III, qui dirige l'armée
cède le commandement au général Mac
Mahon le 7 août puis, encerclé à Sedan,
capitule le 2 septembre 1870. Cette capitulation entraîne la
chute du régime et
la proclamation de la République. Le
gouvernement provisoire continue la guerre.
Dimanche 4
septembre 1870,
tandis qu'à Paris la République est
proclamée, les troupes du
général
d'Exéa, chargées de défendre Reims,
battant en retraite, arrivent à Soissons avant de rejoindre
la capitale. Car les prussiens progressent rapidement. Deux villes
fortifiées seulement se trouvent sur leur route entre Sedan
et Paris : Laon et Soissons, route sur laquelle ils ne rencontreront
aucun soldat français.
Laon aux mains des
prussiens
Le 9 septembre, la place de Laon, commandée par le
général Thémérin, n'ayant
pour toute garnison qu'un bataillon et une batterie d'artillerie de la
Garde Mobile, fait sauter la poudrière de la citadelle
à l'arrivée des prussiens dans la ville. On
entend la détonation dans toute la région.
Le même jour, la présence de cuirassiers ennemis
est signalée dans l'arrondissement de Soissons,
où le pont de Vailly non détruit, permet aux
prussiens de faire passer leurs troupes. Une garnison
improvisée, sous le commandement du
lieutenant-colonel de Noue, composée en grande partie
d'engagés volontaires du département à
qui tout manque
(encadrement, armement, équipement, instruction, discipline)
est chargée de défendre Soissons.
Située à la jonction d'axes routiers importants
et du chemin de fer de Paris à Reims, ainsi que celui de
Paris à Laon par Villers-Cotterêts, la situation
stratégique de Soissons est alors
considérée comme importante, mais rien n'a
été fait avant la guerre pour mettre dans
l'état qui conviendrait cette place forte,
considérée comme la clef de Paris.
Soissons
résiste jusqu'au 16 octobre
Le 10 septembre, un officier de dragons allemand se présente
à la porte Saint-Martin pour demander la reddition de la
place. Le colonel de Noue refuse. Ignorant la ville,
les colonnes allemandes continuent leur marche autour de
Soissons en
direction de Paris, laissant de côté cet obstacle
dont elle s'emparera plus tard afin de ne pas ralentir leur marche. Le
11 septembre, une semaine avant Paris, Soissons est
encerclée. Son siège durera jusqu'au 16 octobre
1870 avec d'importants engagements à partir du 24 septembre.
Au moment où l’ennemi entre dans Laon, tout le sud
du
département se trouve envahi. Son aile droite atteint
Crépy-en-Laonnois, au nord-est de Laon, en direction de La
Fère, l'autre grande place forte de l'Aisne avec Soissons,
et
trois colonnes de la IVe armée allemande descendent en
direction
du sud-ouest. La première, qui a traversé Laon,
va passer
l’Aisne à Cuise-la-Motte pour atteindre ensuite
Pierrefonds et Compiègne. La seconde passe par Braisne,
Villers-Cotterêts et pousse ses éclaireurs
jusqu’à Chantilly. La troisième suit la
vallée de la Marne et se dirige sur Meaux par
Château-Thierry.
Le 12 septembre, un détachement de cavaliers ennemis se
présente à Manicamp pour se aire remettre les
armes des Sapeurs-Pompiers.
8 octobre 1870, la
population en
armes de Saint-Quentin repousse
les prussiens
Au sud, les prussiens s'installent, terrorisent la population et
fusillent sans hésitation. Mais le nord n’est pas
encore
soumis. Le 8 octobre, la première expédition
prussienne
lancée depuis Laon sur Saint-Quentin, où
réside le
préfet de la République, est repoussée
par la
population en armes. L’envahisseur ne peut cependant rester
sur
une défaite : « Saint-Quentin venait de donner aux
villes
ouvertes un exemple en repoussant l’ennemi sans le secours
d’aucune force régulière ».
Le 20 octobre, le
commandant prussien de la place de Laon, divise ses forces en deux
colonnes : l'une va investir La Fère pendant que l'autre
marche
sur Saint-Quentin, non sans piller les villages sur leur passage, comme
à Danizy le 19 octobre. C’est en
menaçant de
représailles et d’amende la population, que la
reddition
de Saint-Quentin est obtenue sans gloire le 21 octobre.
Dix jours plus tard, le département connait une nouvelle
invasion lorsqu’une partie de la Ie armée
prussienne,
à qui Bazaine a livré Metz le 28 octobre, passe
à
Château-Thierry en direction de Paris, tandis
qu’une
« plus considérable, déroule pendant
près de
quinze jours ses colonnes et ses convois sur les routes de Reims
à Soissons et de Soissons à Laon ; de
là elle
prend par tous les chemins la direction d’Amiens »
pour
aller combattre notre armée du nord.
La Fère
assiégée
A la nouvelle de la capitulation de Metz, La Fère fait ses
derniers préparatifs pour soutenir un siège
désespéré, en raison de la
vétusté
de ses défenses. Le 5 novembre, 10 000 prussiens avec de
l'artillerie sont dirigés vers La Fère. Le 19
novembre,
la place qui a refusé de se rendre le 13, est
complètement investie. Le jour même, la garnison
française de Ham, formée du bataillon des Mobiles
du Gard
et de celui des volontaires de la Somme, fait une tentative sur
Tergnier pour soulager la garnison de La Fère. Elle est
repoussée à Vouël. Le 25 novembre, La
Fère
est écrasée par l’artillerie
prussienne,
incendiée en plusieurs endroits. Durant la nuit du 25
novembre 3
500 obus tombent sur la ville. Le 26 novembre au matin, aucun secours
n'étant possible, le conseil de Défense envoie un
parlementaire à l'ennemi, qui poursuit encore une heure le
bombardement. La capitulation est signée le 27 novembre
tandis
que s’engage la bataille de Villers-Bretonneux pour Amiens.
Les prussiens sur
l'Oise
Libéré de Metz, la Ire armée allemande
a poursuivi
sa marche par l'Oise et la Somme, entre Compiègne et
Saint-Quentin pour aller occuper Amiens puis de marcher vers Rouen.
Manteufel attaque l'armée du Nord le 27 au matin, sans
même attendre que ses troupes achèvent leur
formation sur
la ligne de l'Oise. La citadelle d'Amiens capitulera le 1er
décembre 1870.
L’ennemi a désormais la maîtrise des
principales
voies ferrées du département : vers le Nord,
depuis Reims
par Laon, Crépy, La Fère, Tergnier, vers
l’Est par
La Fère, Laon, Soissons et au sud vers Paris. Il peut
laisser
une partie de ses troupes surveiller nos places fortes du nord et
commencer avec le reste sa campagne de Normandie.
L'Armée
du Nord sème la panique chez les prussiens
Mais La Fère était à peine prise que
les troupes
d’occupation sont saisies de panique. La nouvelle
Armée du
Nord, voulue par Gambetta, se prépare autour du
général Bourbaki secondé par le
général Farre. 8 000 hommes venant de
Montmédy,
envoyés en renfort, passent à Saint-Quentin mais
après la bataille de Bapaume, on voit se replier les troupes
allemandes, qui s’étendant pour la
première fois
dans le nord du département occupant Guise et
menaçant
Vervins. Inquiet de l’audace croissante de Faidherbe, les
prussiens concentrent leurs forces à la fin de
décembre
pour lui tenir tête.
Commandée par le général Faidherbe,
l'Armée
du Nord, mène une stratégie de
harcèlement face
à la Ie Armée prussienne, afin de disperser les
forces
ennemies et desserrer l'étau prussien sur Paris.
Après la
bataille de l'Hallue des 23 et 24 décembre 1870, la Bataille
de
Bapaume du 3 janvier 1871 et le siège de Péronne
du 27
décembre 1870 au 10 janvier 187, Faidherbe allait tenter le
suprême effort que commande la prévision de la
chute
prochaine de Paris.
La bataille de
Saint-Quentin, dernière
tentative pour mettre fin au siège de Paris
L’Armée du Nord quitte ses cantonnements
près
d’Arras, le 10 janvier. Faidherbe, qui savait que la garnison
de
Paris allait tenter une sortie (Buzenval), va marcher sur
Saint-Quentin, afin de menacer les communications ennemies à
Tergnier, entre Reims et Compiègne d’une part,
entre Reims
et Amiens de l’autre.
Le 18 janvier, le colonel Isnard entre dans Saint-Quentin que
l’ennemi a abandonné dans le plus grand
désordre,
laissant des prisonniers, des vivres, des chevaux et des fourrages.
FaIdherbe s’exprime devant la municipalité de
Saint-Quentin dans la soirée du 18 janvier :
« Demain je donnerai, ou plutôt
j’accepterai la
bataille. Gambetta l’ordonne. Il veut faire une
diversion,
car Paris tentera une sortie. Mon armée est faible, je serai
battu, mais battu glorieusement. Les Prussiens pourraient nous
repousser en deux heures, je les arrêterai toute la
journée. »
Faidherbe établit ses troupes à l’ouest
et au sud
de Saint-Quentin : « La bataille commença du
côté du 22e corps. La 2e brigade de la 1e division
(Derroja), était à peine rendue à
Gauchy, et la 2e
division (Du Bessol) à Grugies, que de profondes colonnes
d’infanterie prussiennes,
précédées de
cavaliers, arrivèrent de Paris vers Castres.
C’étaient les trois divisions Von Barnekow, prince
Albert
de Prusse et comte de Lippe. Une brigade de la cavalerie
était
commandée par le prince de Hesse.
L’action s’engagea immédiatement entre
les deux
armées, et la batterie Collignon
s’établit sur une
excellente position près du moulin de Tout-Vent. On se
disputa
les hauteurs en avant de Gauchy, et l’ennemi mit
aussitôt
en ligne de nombreuses batteries.
La 1ère brigade (Aynès), de la 1ère
division, qui
avait couché à Saint-Quentin, arriva alors au pas
de
course et vint se placer à gauche des troupes
engagées,
étendant ainsi notre ligne de bataille
jusqu’à le
route de La Fère. Le général Du Bessol
venait
d’être grièvement blessé.
De nouvelles batteries vinrent renforcer la batterie Collignon et
arrêtèrent pendant toute la bataille les efforts
de
l’ennemi en lui faisant subir des pertes
énormes.
Pour la première fois depuis le commencement de guerre,
notre
artillerie se montrait d’une
supériorité
incontestable.
Pour s’opposer à l’attaque de colonnes
considérables arrivant d’Itancourt et
d’Urvillers,
le colonel Aynès s’avança sur la route
de
Saint-Quentin et de La Fère, où il tomba
mortellement
blessé. Il était trois heures environ :
l’ennemi
nous débordant en ce moment vers Neuville-Saint-Amand, nos
troupes se replièrent presque jusqu’au faubourg
d’lsle.
Le commandant Tramond arrêta ce mouvement
rétrograde en se
mettant à la tête de ses bataillons du 68e de
marche et,
chargeant l’ennemi à la baïonnette, on
regagna le
terrain perdu jusqu’à la hauteur des batteries qui
n’avaient pas cessé leur feu.
Cependant la lutte continuait avec acharnement à la droite
de la
division. Les hauteurs avancées de Gauchy furent assaillies
six fois par des troupes fraîches qui se
renouvelaient sans
cesse. Six fois nos soldats animés par le courage et
l’intrépidité du colonel
Pittié
repoussèrent ces assauts. Dans ses attaques nos soldats se
rapprochèrent plusieurs jusqu’à vingt
pas de
l’ennemi jonchant le terrain de ses morts.
La cavalerie prussienne ne fut pas plus heureuse devant
l’élan et la solidité
de nos troupes.
Une charge faite par un régiment de hussards fut en peu de
temps
arrêtée et brisée par des feux
d’ensemble
dirigés par le colonel Cottin. Dans cette lutte,
les
mobiles du 91e et du 46e, malgré
l’infériorité de leur armement,
rivalisèrent
de courage avec les troupes de ligne.
Malheureusement des renforts ne cessaient d’arriver aux
Allemands. A la chute du jour, il en arrivait par chemin de
fer
de Rouen, d’Amiens, de Beauvais et même de Paris.
Le 23e corps à l’ouest de Saint-Quentin repoussa
brillamment les attaques de l’ennemi qui essayait un
mouvement
tournant. Paulze d’Ivoy arrêta toute la
journée
l’ennemi du côté de la route de Ham. Il
se vit
cependant obligé de se replier devant des forces
considérables.
Pour ne pas laisser prendre son armée, le
général
Faidherbe dut ordonner la retraite qui se fit pour le 22e corps par la
route du Cateau et pour le 23e par la route de Cambrai.
Les barricades du faubourg Saint-Martin, courageusement
défendues, arrêtèrent assez longtemps
l’ennemi pour que la retraite du gros de
l’armée ne
fut pas inquiétée. Jusqu’à 7
heures du soir
nos vaillants soldats disputèrent pied à pied aux
hordes
prussiennes un terrain qu’on leur fit cruellement
payer.
Enfin la déroute s’installa parmi nos jeunes
soldats qui,
mourant de froid et de faim, avaient combattu dans un terrain
détrempé par un dégel de trois jours.
L’ennemi avait présenté
76.000 hommes sur le
champ de bataille, et à la fin de la journée il
disposait
d’une réserve de près de 40.000 hommes.
Dans les
journées des 18 et 19 janvier, 6.000 ennemis avaient
été mis hors de combat tandis que
l’armée
française ne comptait guère que 2.000
à 2.500
victimes. Aucun prisonnier ne fut fait sur le champ de bataille. Mais
le lendemain les Prussiens ramassèrent 4 à 5.000
malheureux, traînards, mobiles et mobilisés dont
une
grande partie parvint à s’échapper au
bout de
quelques jours.
La plupart de nos établissements publics et nombre
d’ateliers manufacturiers furent transformés en
ambulances
et reçurent plus de 1.500 blessés dans cette
fatale
journée. La ville avait été
bombardée
pendant l h. 1/2 ce qui causa de grands dégâts
matériels.
« Soldats, dit le général Faidherbe
dans une
proclamation à son armée, je dois vous rendre
justice et
vous pouvez être fiers de vous-mêmes, car vous avez
bien
mérité de la patrie. Ce que vous avez souffert,
ceux qui
ne l’ont point vu ne pourront se l’imaginer. En
moins
d’un mois vous avez livré trois
batailles à
un ennemi dont l’Europe entière à peur.
Vous lui
avez tenu tête, vous l’avez maintes fois vu reculer
devant-vous….. »
« Les Prussiens ont trouvé dans de jeunes soldats,
des
gardes nationaux, des adversaires capables de les vaincre.
Qu’ils
ramassent nos traînards, qu’ils s’en
vantent dans
leurs bulletins, peu importe, ces fameux preneurs de canons
n’ont
point touché à une de vos batteries. Honneur donc
à vous tous ! …
La bataille de Saint-Quentin met fin aux opérations de
l’armée du Nord. La ville est occupée
jusqu’au 21 octobre 1871, un an après la
première
entrée de l’ennemi dans ses murs.
__________
Bibliographie
D Vincent, Souvenir d'un soldat de 1870. Siège de Soissons
René Fossé d'Arcosse, Le siège de
Soissons en 1870
Émile Collet, Le siège de Soissons et
l'occupation allemande dans le Soissonnais 1870-1871
Ernest Lavisse, L’Invasion
allemande dans les
départements du nord de la France Revue
des Deux Mondes, 2e période, tome 95, 1871 (p. 46-79).
Lla
Campagne du Nord, Faidherbe
__________
Le 1er septembre, le préfet de l’Aisne avait
tracé, dans une communication adressée
à la presse, un tableau des
dispositions du département : partout des
compagnies de francs-tireurs s’organisaient ; la population
demandait des armes, elle annonçait l’intention de
résister, même sans fusils et sans
équipement, et le préfet rappelait
qu’en vertu de la loi du 29 août 1870, «
un des signes distinctifs de la garde nationale » suffisait
à couvrir « de la garantie reconnue aux corps
constitués les citoyens qui se portent
spontanément à la défense du pays avec
l’arme dont ils peuvent disposer. » Il semblait
qu’on fût à la veille d’une
guerre comme en Espagne et au Mexique. « C’est la
guerre de guérillas, disait
précisément le préfet, mais une guerre
loyale et sacrée, qui s’organise activement.
»
__________
Les sabres des
Sapeurs-Pompiers
de Quierzy qui n'ont pas été remis à
l'occupant en septembre 1870
deviennent un symbole de le résistance à l'ennemi
...
|
|
|
Les sapeurs-pompiers
(anciens
garde-pompes) sont rattachés depuis 1831 à la
Garde Nationale, créée à la Révolution, et
reçoivent l’armement affecté
à cette garde, successivement dotée d'une
variante
du sabre-briquet (du fait de sa petite taille, la lame mesure
59,5
cm) d’infanterie 1767/1814, puis du
glaive modèle
1855, version légèrement réduite du
modèle 1831 des troupes à pied, dit
coupe-chou, l’utilité première
étant celle d'un outil tranchant de
campagne : hache de campement, serpe pour couper le fourrage des
chevaux, etc.
Les
officiers se voient affecter l’épée du
modèle
1817/1872, dite à ciselures et, moins répandu, le
poignard de feu, puis
à partir des années 1850, les officiers
s’équipent progressivement du
sabre d’officier d’infanterie 1845
(arrêté du 14
juin
1852). Cette arme sera quasi-officielle pendant tout le Second Empire
côtoyant, à parts à peu près
égales, les adeptes du port de
l’épée.
Source : https://www.ensosp.fr |
Glaive modèle
1855
Utilisé
principalement par la Garde Nationale et les sapeurs-pompiers.
Caractéristiques :
-
longueur de la lame : 45 à 48 cm (47,5 à 48,7 cm pour
le 1851)
-
lame droite à double tranchants, avec deux longues gorges (langue de carpe pour le 1851)
-
largeur au talon : de 2.7 à 4 cm (±4
cm)
-
monture en laiton moulé :
- poignée
à 26 cannelures de ± 12.5 cm (±14.8 cm)
- croisière droite de ± 9 cm ± (10.5 cm)
-
fourreau : en cuir à couture dorsale |
 |
|
__________
Une institution communale
Les maires se voient confier à partir de
1804 la tâche d’organiser un corps
destiné à
la lutte contre les
incendies. Les communes ont déjà sous leur
autorité, depuis 1790,
la Garde Nationale, corps armé constitué
des
citoyens âgés
de 20 à 60 ans. En 1831, les deux corps sont
regroupés au
sein de la Garde Nationale et les sapeurs-pompiers sont dès
lors
armés.

Fin novembre 1858, lors de
la visite de l'empereur à Chauny et
Saint-Gobain; les Sapeurs-Pompiers de Quierzy
reçoivent le haut de la hampe de
leur Drapeau.
Hampe de drapeau
à l'aigle Second
Empire en laiton,
aigle tournant la
tête à droite
(pour la Garde Nationale et les pompiers ?)
surmontant un socle au
chiffre de Napoléon III
Lorsque la Garde Nationale est dissoute en 1871, on prévoit
le maintien
des corps de sapeurs-pompiers « jusqu'à ce qu'un
règlement
d'administration publique ait pourvu à l'organisation
générale de ces
corps ». Cette organisation des corps de sapeurs-pompiers
interviendra
en 1875. Les communes disposant des moyens suffisants pouvaient
constituer un corps communal en recrutant des sapeurs-pompiers sous
statut militaire. Ces corps pouvaient être
constitués en subdivision,
compagnie ou bataillon en fonction de leurs effectifs. Dans chaque
département, le conseil général
pouvait décider de confier le contrôle
du fonctionnement du service des sapeurs-pompiers à un
inspecteur nommé
par le préfet.
En 1925, les sapeurs-pompiers sont désormais des agents
civils sous
l'autorité du ministère de l'intérieur
(à l'exception des militaires du
régiment des sapeurs-pompiers de Paris). On distingue
désormais les
sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires.
A partir de 1938, les services de secours et de défense
contre
l'incendie peuvent s’organiser au niveau intercommunal ou
départemental
sans remettre en cause le rôle
prépondérant de la commune dans la
gestion des sapeurs-pompiers. |
|
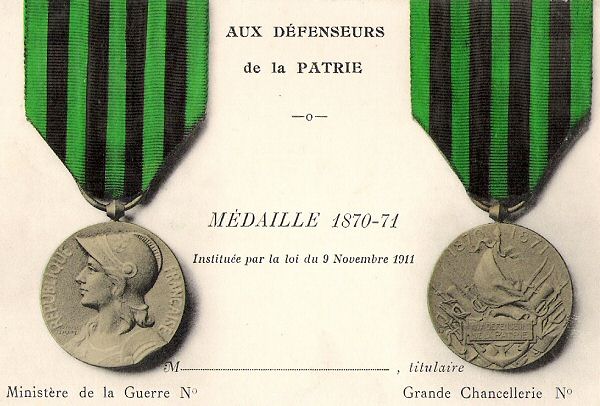
|