|
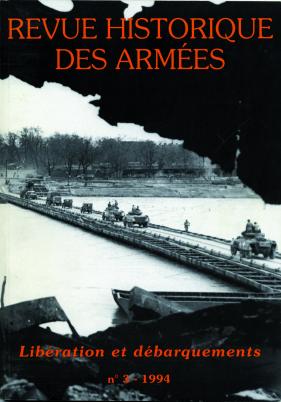
«
Vive les
Américains ! » Souvenirs d'un
libéré, Alain HUYON, Revue Historique
des
Armées, n°196, septembre 1994, Dossier Seconde
Guerre mondiale, p 120-127
Tous les numéros de la Revue historique des Armées
Ce
témoignage
concerne la libération par les troupes
américaines de Charmes, village jouxtant La Fère.
L’auteur avait 7 ans à
l’époque. Trois annexes permettent de replacer ces
souvenirs dans leur contexte historique.
ler septembre 1944
Les grandes vacances s’écoulent sous un soleil
encore brûlant. Elles ont commencé tôt
cette année : fin mai ; en raison de la densité
des actions aériennes en tout genre,
l’école primaire a été
fermée. Pendant un mois, j’y suis
retourné une fois par semaine pour restituer et reprendre
les devoirs à exécuter à la maison. Il
y a déjà deux mois que cette école
quasi buissonnière a pris fin.
C’est en début d’après-midi,
vers 14 h 30 (heure de Berlin !) que la rumeur
s’établit. Pas ce qu’il est convenu
d’appeler la rumeur publique, laquelle est
singulièrement discrète en ces temps incertains,
mais un bourdonnement d’abord indéfinissable qui
va s’amplifier jusqu’à la nuit. Au
début, ce bruit mécanique fait penser
à une vague de bombardiers lourds en approche, comme nous en
entendons depuis un an et demi, plus souvent la nuit que le jour
jusqu’au printemps dernier. Depuis le début de
l’année, les vols diurnes se sont
multipliés. C’est ainsi que j’au pu
compter facilement, il y a quelque temps, par grand soleil, les 99
vagues (c’est facile à retenir) de six
quadrimoteurs d’un raid se dirigeant vers le sud-est1. Et il
y a seulement une semaine, en plein midi, j’ai vu passer
au-dessus de ma tête plus de 260 bimoteurs qui attaquaient le
dépôt d’essence de Saint-Gobain,
à 7 km de là 2. La réussite de cette
mission s’est manifestée aussitôt par un
champignon qui n’avait rien à envier, pour
l’amplitude, aux cryptogames atomiques des années
à venir, mais tout noir et qui obscurcit le ciel des heures
durant.
Aujourd’hui, la persistance de ce bourdonnement sans
apparition d’avions ne manque pas de surprendre,
d’inquiéter même. Les Allemands
n’annoncent-ils pas l’apparition d’armes
nouvelles qui doivent retourner la situation en leur faveur et reporter
sine die le jour tant attendu de leur départ ?
Deux heures plus tard, un crissement de plus en plus strident, irritant
pour les oreilles et les nerfs, se superpose au bourdonnement : ce
n’est pas pour réduire
l’éventail des conjectures et apaiser les craintes.
Cependant, sans doute par le fait des rares hommes ayant
déjà connu une situation semblable, on commence
à chuchoter qu’il s’agit de «
tanks » : ronflement des moteurs, crissement des chenilles
… Nous n’y croyons qu’à demi
car nous n’imaginons pas qu’une force
blindée en déplacement puisse produire autant de
décibels.
Et surtout, personne ne pense vraiment qu’il s’agit
des Américains car, n’en déplaise
à leurs alliés, il n’est question que
des Américains. Sans ignorer la libération de
Paris, nous ne savons presque rien de l’évolution
de la situation.
En particulier, nous ignorons3 que Soissons a été
libéré le 29 août, que les
Américains sont entrés dans Laon le 30 vers midi
et que leurs avant-gardes ont atteint Montcornet et Rethel hier. En ce
moment-même, La Capelle et Aubenton, à 50 et 65 km
au nord-est de La Fère, acclament leurs
libérateurs.
Depuis le 6 juin, nous suivons discrètement la progression
des Alliés sur une carte du calendrier des P.T.T., par le
biais des messages de la B.B.C. que nous rapportent nos voisins (nous
n’avons pas la T.S.F.). J’ai ainsi appris
l’existence du Cotentin, qui a occupé
l’avant-scène pendant un mois, puis celle de
Falaise et Rambouillet (je connaissais déjà
Laval, Le Mans et Tours qui avaient jalonné, en sens
inverse, l’itinéraire de notre
évacuation en 1940). Et nous n’avons pas encore
reporté notre attention sur la seconde vague de
liberté qui, deux semaines plus tôt, a atteint la
Provence. Pour nous le salut ne doit venir que des
Américains de Normandie, si proches maintenant. Mais dans
quel délai ?
Bref, ce charivari mécanique nous inquiète plus
qu’il ne nous réjouit : est-ce qu’il ne
s’agit pas d’une contre-attaque allemande,
annonciatrice de nouvelles épreuves, car nous savons bien
(et ma mère en particulier qui a vécu, trois fois
déjà, un événement
semblable) qu’il ne fait pas bon se trouver sur la ligne de
contact. D’ailleurs cette hypothèse se trouve
confirmée par l’origine géographique du
« bruit » : d’un ronronnement indistinct
dans sa nature et sa localisation, le roulement des blindés
se précise maintenant comme venant de l’est, du
sud-est et du sud, ces mêmes directions par lesquelles les
Allemands ont abordé La Fère le 18 mai 19404.
Depuis hier, preuve que le front se rapproche,
l’électricité est coupée et
nous n’avons pas perçu notre ration de ce pain
à l’allure de conglomérat de sciure qui
constitue la base de notre alimentation. Et les ponts de
l’Oise et du canal de la Sambre à l’Oise
ont sauté, isolant le centre de La Fère du reste
du continent.
Nous ne sommes qu’à demi rassurés par
le spectacle que nous offre l’armée allemande
depuis un mois. Des véhicules de toute nature, hippo et
automobiles, certains revêtus de ce camouflage particulier
à la Wehrmacht, d’autres seulement
balafrés de peinture grise, les derniers dans
l’état où ils ont
été réquisitionnés,
affichant les raisons sociales d’artisans normands ou
parisiens ; des camions qui roulent sur trois roues ; des hommes et des
chevaux visiblement harassés, par petits groupes, en
désordre, s’allégeant parfois dans les
fossés d’impedimenta superflus : meubles, caisses,
ustensiles , et aussi de grenades et de bandes de cartouches intactes,
voire de femme et enfant comme j’en ai
été le témoin. C’est triste
une armée en déroute, même si elle est
ennemie.
Quelque temps avant le début de ce reflux, un
état-major5 s’est implanté au
château Brincard, tout proche de notre domicile,
occupé par une école religieuse (après
avoir, détail surprenant étant donné
les circonstances, aidé les bonnes sœurs
à transporter leur mobilier en ville). Depuis, il y a
seulement deux ou trois jours, un poste de combat a
été organisé dans la maison de nos
voisins, priés d’installer leurs
pénates ailleurs : sentinelles aux volets entrouverts,
mitrailleuse pointant du toit partiellement dégarni de ses
tuiles. A présent, des lignes
téléphoniques de campagne courant au sol le long
des rues, relient cet état-major à
d’autres organismes à La Fère et au
château d’Andelain. Le commandant d’armes
n’a pas manqué de faire diffuser par la
municipalité, par l’intermédiaire du
garde-champêtre, un avis menaçant de prise et
exécution d’otages dans le cas où ces
fils seraient victimes de coups de sécateurs
malencontreux…
A peu près à la même époque
est apparue dans la ville, une troupe composée de Mongols6.
Ces hommes nous terrorisaient par leur allure de robots farouches, une
tenue et une discipline apparente qui tranchaient
singulièrement sur celles des troupes
dépenaillées qui commençaient
à s’écouler en direction de Laon. Mais
les « Mongols » ne sont pas restés bien
longtemps.
Donc les Fridolins – le plus amène des termes sous
lesquels on désigne les soldats allemands en imposent moins
mais tout un chacun craint le sursaut du fauve blessé, les
réactions individuelles d’hommes
épuisés, vexés, apeurés.
Aussi ma mère m’interdit-elle, avec un
succès modéré, de rester
planté sur le bord de la nationale à observer
cette lamentable cohorte.
Dans le ciel aussi les Allemands en imposent moins. Outre les passages
fréquents de bombardiers déjà
signalés, les incursions d’appareils
d’attaque en piqué se sont multipliées
dès le printemps. Depuis le débarquement, il ne
se passe pas de jour sans que nous assistions à une
opération7 contre l’une ou l’autre des
gares des environs : Tergnier, La Fère, Versigny
… contre toutes les voies de communications, les convois
routiers et ferroviaires et même les péniches. Le
2 août, le pont ferroviaire enjambant le canal à
Beautor a été durement touché mais
rétabli en 24 heures. Chaque fois des habitations sont
détruites, surtout dans –
l’agglomération Tergnier
/Quessy/Vouél/Condren et à Beautor, et il faut
déplorer des victimes. Tergnier a finalement
été évacué.
Bien entendu, la chasse allemande basée alentour
(à Clastres, Couvron, Athies-sous-Laon et au terrain de
fortune aménagé en juin à Achery) ne
reste pas inactive et les combats aériens sont courants,
toujours dominés par les Alliés. Un avion
allemand s’est écrasé à 100
m de la maison, à l’angle du parc du
château Brincard ; un autre s’est posé
sur le ventre dans les pâtures, 200 m plus loin. Et je ne
compte plus ceux que j’ai vu tomber en flammes, en vrille ou
en vol rasant, trop loin pour que je puisse observer l’impact
au sol. Pourtant, la semaine dernière, j’ai pu
assister à une gigantesque empoignade entre chasseurs
allemands et « double-queues »
américains j’ai vu s’abattre ainsi 13
appareils à croix noire et six à
étoile blanche. Dès le lendemain, je suis
allé voir l’un de ceux-ci, posé sur le
ventre dans les marais près de la déviation : il
était presque intact à l’exception
d’une aile proprement découpée et
tombée sur le collège féminin de La
Fère.8
Mais revenons au 1er septembre. A mesure que les heures
s’acheminent vers la nuit, les renseignements se confirment,
colportés par on ne sait qui. D’abord ce sont bien
des blindés. Puis : « Les Américains,
c’est les Américains … », cri
vingt fois répété au mépris
des oreilles qui nous écoutent encore. Les habitants se
rassemblent en petits groupes vite défaits, joyeux, rieurs,
jusque sous les fenêtres du poste allemand, qui
d’ailleurs ne semblait attendre que cette confirmation pour
quitter les lieux.
La nuit vient en même temps que les premiers
éléments alliés` abordent les hauteurs
de Charmes, venant de Saint-Gobain. Je décide ma
mère à aller les voir de tout près
tandis qu’ils traversent le village par la rue Paul Doumer,
à quelques centaines de mètres. A peine
sommes-nous dans la rue que nous rencontrons une section de F.F.I.
progressant au centre de la chaussée en rangs par trois. Le
chef demande à ma mère des renseignements sur le
poste allemand voisin qui, heureusement, s’est
déjà replié. Les F.F.I. font
demi-tour, nous sur leurs talons,
C’est à ce moment que le premier obus tombe sur la
rue Paul Doumer où passent les blindés
américains. Ma mère rebrousse chemin à
mon grand dépit et nous entraîne à la
cave. C’est la première fois que nous y trouvons
refuge depuis le bombardement du polygone d’artillerie le 15
mai 1940, dont notre habitation n’est
séparée que par le château Brincard.
Les attaques aériennes ultérieures
n’ont pas déclenché le même
réflexe, ma mère disant qu’elle
préférait mourir à l’air
libre plutôt qu’écrasée sous
la maison (de même nous n’avons jamais
utilisé l’abri de fortune creusé par
mon frère dans le jardin, conformément aux
consignes de la municipalité).
Nous nous installons tant bien que mal pour la nuit. Les obus passent
avec un sifflement chuinté, au-dessus de nos têtes
nous semble-t-il, assez espacés. A chaque obus, ma
mère, fille de poilu et femme d’artilleur,
commente « Puisqu’on l’entend,
c’est qu’il n’est pas pour nous
». Je m’endors.
Au matin, je me précipite au passage à niveau
où la rue Paul Doumer rejoint la nationale. Là
s’étire un convoi à
l’arrêt de véhicules divers
submergés par la population, surprenants par leurs formes,
leur couleur, leurs marquages et ces interminables antennes-fouets
absentes des véhicules allemands. Je fais
l’inventaire avec des camarades retrouvés. Je suis
déçu de ne pas trouver de « tanks
» mais il en passera cet après-midi, en petit
nombre. Tout nous ébahit les tenues de combat, les casques,
l’allure décontractée de ces soldats
pas vraiment moins débraillés que les Allemands
essoufflés qui passaient il y a deux jours encore. Plusieurs
sont visiblement éméchés.
Enlaçant des filles émoustillées ; si
le champagne ne coule pas à flots, il est manifeste que les
riverains ont débouché quelques bouteilles
soigneusement conservées10. D’autres se
disputent des tomates et des oignons crus qu’on leur lance et
qu’ils croquent tels quels, comme nous mangeons des pommes,
à notre grande surprise. En échange les G.I.
envoient le contenu de leurs rations K. En quelques heures nous
découvrons les biscuits salés, le fromage au
bacon, le Nescafé en poudre, le beurre de
cacahuètes et surtout le « chouing gomme
», impossible à prononcer et dont nous ne
comprenons même pas l’usage au premier abord. Tout
le monde rit, chante. Braille, s’embrasse. Le tricolore
dégouline des balcons, des filles portent des robes
bleu-blanc-rouge. La rue est tout entière comme une
fête foraine, half-tracks et camions remplaçant
les manèges. L’apparition d’un avion
jette un moment l’effroi dans cette foule en liesse ; en deux
secondes tous les habitants se précipitent dans les caves et
l’abri du château Labbe, sous
l’œil sidéré des
Américains. Fausse alerte, c’est un des leurs,
mais comment savoir ?
Au hasard des conversations que je saisis au vol, je peux reconstituer
les événements de la nuit les
éléments de tête des unités
américaines ont à peine marqué
l’arrêt hier soir, poursuivant par Danizy et la
rive gauche de l’Oise en direction de Guise ; les obus
tombés sur la rue Paul Doumer et ses abords, dont deux sur
l’école communale, ont causé quelques
dégâts niais un seul blessé
léger parmi la population ; au petit jour un
détachement américain a pu traverser
l’Oise pour atteindre le centre de La Fère, mais
les résistants locaux avaient déjà
capturé les quelques Allemands restés
à l’arsenal et aux casernes.
Le convoi se remet en route assez brusquement, un autre lui
succède et la fête reprend ; il en sera ainsi
pendant deux jours, chaque mouvement, chaque passage
déclenchant des vivats : « Vive les
Américains, vive les Américains »
Dans le milieu de la matinée, j’apprends que mon
frère est sur la place de Charmes. Je l’y trouve
en culotte courte, chemisette, un brassard tricolore à croix
de Lorraine au bras gauche, portant à la bretelle un fusil
presque aussi grand que lui11 et des bandes de cartouches en sautoir,
Ma mère et moi ne l’avons pas vu depuis deux mois
et demi : peu après son 16e anniversaire, le jour
où il a reçu une convocation pour aller
exécuter des travaux de terrassement pour les Allemands, il
a pris une petite valise et sa bicyclette et il est parti. Ma
mère n’a appris que plusieurs semaines plus tard
qu’il avait rejoint le maquis de Saint-Gobain
En fin d’après-midi du 2 septembre, des crieurs de
journaux se répandent en ville, apportant de Laon les
premières feuilles libres.
Dans les jours qui suivent, le génie américain
rétablit l’un des ponts de la déviation
de la N.44, qui n’a été que
partiellement détruit. J’assiste au passage du
« tank » testant sa solidité. Les
sapeurs aménagent aussi une rampe qui descend du remblai de
la déviation dans les bas-prés,
derrière le stade, permettant de rejoindre le centre de La
Fère. Dans le même temps une passerelle en bois
pour les piétons est construite pour suppléer le
pont principal sur l’Oise, lequel sera bientôt
reconstruit, en bois également. A l’autre
extrémité de la ville, côté
ouest, le pont sur le canal, partiellement détruit lui
aussi, est rapidement rétabli.
A la fin de cette première semaine, un
défilé parcourt
l’agglomération, étirant son
cortège d’autorités nouvelles, de
F.F.I., de familles de victimes …
L’après-midi, une manifestation à
laquelle je n’ai pas le droit d’assister se
déroule sur la place de Charmes : j’en vois
revenir une jeune femme au crâne rasé et aux yeux
rougis.
Des formations américaines s’installent
à La Fère même, près du
stade et le long du canal, et dans les environs, en particulier au
château Maguin d’Andelain et dans la
forêt de Saint-Gobain, tandis qu’un groupe de
bombardement équipé de forteresses volantes fait
de Couvron, pour un temps, la base américaine la plus
importante d’Europe continentale12.
D’interminables colonnes succèdent à
d’interminables colonnes, constituant un courant quasi
continu qui s’écoule en direction de Laon : la
logistique américaine déploie ses fastes sous nos
yeux admiratifs. Et il en sera ainsi jusqu’à la
fin de la guerre, la noria étant à peine ralentie
par un hiver rigoureux. Pour régenter ces
déplacements, la Military Police établit un poste
de contrôle dans l’ancien octroi.
L’électricité est revenue
dès le 3 septembre, le pain aussi, blanc d’abord
— nous l’avions oublié —mais
cela ne dure que quelques jours avant que réapparaisse le
même pain bis, voire bistre, de la période
précédente. Curieusement, les
Américains en raffolent et ce mauvais pain made in France
nous sert de monnaie d’échange pour le corned beef
et le chocolat aux amandes ; certains le leur vendent quatre ou cinq
fois le prix d’achat
Car le souci de la subsistance prend vite le pas sur la fête
qui s’effiloche. Malgré le marasme
économique, les destructions de toute nature, la rupture des
communications, l’angoisse de ceux qui ont un proche
impliqué dans cette guerre qui
s’éloigne mais n’est pas
terminée, la vie reprend.
Les activités se rétablissent peu à
peu. Les trafics perdurent, les petits et les grands ; la Military
Police veille : gare aux automobilistes qui ne peuvent justifier la
provenance de leurs pneus américains et de
l’essence rose de leurs réservoirs !
Le ler octobre est déjà là. Il faut
reprendre le chemin de l’école et mon cartable ne
me servira plus à porter des légumes et du pain
aux soldats. J’étrenne un ensemble de coupe
très militaire et de plus vert-de-gris, car tiré
d’un coupon de tissu «
récupéré » sur la Wehrmacht
; pour la première fois, j’abandonne la culotte
courte : j’ai atteint l’âge de raison.
Quant à mon frère, on pourrait le prendre pour un
G.I., au casque près.
Les vacances sont finies : les plus longues et, je le confesse, les
plus exaltantes que j’aie vécues.
__
(1) Voir l’annexe 1 : Note sur les opérations
aériennes. § 11.
(2) Cette action a engagé près de 300 bombardiers
moyens Glenn Martin B-26 « Marauder’ du
IX–‘ Bomber Command de la 9’ US Air
Force, le 26 août.
(3) Mais certains le savaient sans doute,
(4) En fait, ce que nous entendions alors comme venant de
l’est et du sud-est était probablement le
VII’ Corps US qui « défilait »
de Laon à Vervins, sans opposition, relayé
ensuite par les unités venant de Soissons, au sud.
(5) Que les habitants qualifièrent de S.S. mais ceci reste
à confirmer.
(6) Il s’agissait en fait d’originaires du
Turkestan Russe appartenant aux Osttruppen recrutées par les
Allemands en R.S.S. et repliés de Normandie.
(7) Voir l’annexe 1 : Note sur les opérations
aériennes, § 12.
(8) Voir l’annexe 1 : Note sur les opérations
aériennes, § 13.
(9) Voir l’annexe 2 : Note sur les opérations
terrestres dans l’Aisne.
(10) « Les biffins accrochés aux chars des
unités de tête appréciaient beaucoup
cette mission de renforcement des blindés car elle faisait
d’eux les premiers à
pénétrer clans les villes, les premiers
à bénéficier des vivats, du cognac et
des baisers » (extrait de « Through Combat,
historique du 314 Régiment d’infanterie US).
(11) C’était un Lebel.
(12) C’est ce qui s’est dit mais reste incertain.
Sources
1_ Kit C. Carter et Robert Mueller, The US Arm Air Forces in World War
Il, Historical Research Center, US Goverrnment Printing Office, 1973.
2_ Wilfried J. Paul et Albert F The Ninth Air Force in World War II, US
Air Force Historical Division, University of Chicago Press, 1951.
3_ Office of the Chief Military History (Department of the Armv), The
US Army in World War 11. US Government Printing Office. 1960.
4_ The First US Armv Report of Operations, 1945. US Government Printing
Office.
5_ Welirmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Les
archives de cet organisme allemand rapportent, à la date du
25 août, tes combats aériens de La Fère
et du secteur Laon/Saint-Quentin mais sans détail quant aux
pertes.
Annexe 1
Note sur les opérations aériennes.
11 Le
bombardement lourd
Des nombreuses opérations de bombardement de jour qui ont
rassemblé plus de 500 quadrimoteurs, voire beaucoup plus,
jusqu’au millier, plusieurs ont survolé le secteur
de La Fère, en particulier celles menées par la
8th US Air Force sur des objectifs situés en Allemagne du
sud et en France de l’est et du sud-est. En effet, dans ces
trois cas, les équipages venant de Grande-Bretagne
« s’accrochaient » au cours de la Seine
depuis son embouchure puis au cours de l’Oise
jusqu’à La Fère, point où la
rivière bifurque du sud vers le sud-ouest, de plus
souligné par le triage ferroviaire de Tergnier et les deux
canaux de Saint-Quentin et de la Sambre à l’Oise
qui s’y rejoignent. Ce point est donc facilement identifiable
du ciel (même de nuit par temps clair) et de là
les bombardiers prenaient la direction générale
de l’est-sud-est ou du sud-est.
Pour le printemps de 1944, les documents de Army Air Force- font
état des raids suivants :
—16 mars : 679 bombardiers lourds à7 destination
d’Augsburg, Friedrichshafen et Ulm ;
18 mars : de nouveau 679 appareils sur
Operpfaffenhoffen, Friedrichshafen, Lechfeld, Munich, Landsberg,
Memmingen …
24 avril : 716 appareils ayant
sensiblement les mêmes objectifs que le 18 mars, sauf
Lechfeld, Munich et Memmingen, plus Erding, Manzell, Lowenthal,
Gablingen, Leipheim, Neckarsulm ;
25 mai : 859 bombardiers sur Mulhouse,
Troyes, Tonnerre, Belfort, Sarreguemines, Thionville, Metz …
—27 mai : 923 quadrimoteurs sur l’Allemagne du sud
et Strasbourg, Metz-Woippy ;
— 28 juin : 672 appareils, probablement
étalés en plusieurs vols au cours de la
journée, sur différents terrains
d’aviation dans l’Aisne et en Champagne, dont
notamment Laon-Athies et Laon-Couvron.
Il s’agissait dans tous les cas de raids mixtes rassemblant
des appareils quadrimoteurs Lockeed B-17 « Flying Fortress
» (les célèbres forteresses volantes)
et Consolidated 13-24 « Liberator ».
Compte tenu des détails connus sur l’heure de
passage approximative à la verticale de La Fère,
les conditions météorologiques et
l’altitude des vols, c’est certainement celui du 25
mai (de plus un jeudi, jour du congé scolaire hebdomadaire)
que j’ai vu passer, en partie, au-dessus de ma tête.
12. Les attaques à basse altitude
Dès la fin du mois de mai, chaque jour sauf interdit
météorologique, les 8e et 9e US Air Forces, pour
se limiter aux Américains, ont mis en œuvre pour
l’attaque d’objectifs terrestres sur
l’ensemble du nord-ouest de la France, jusqu’a 400
chasseurs P-47 « Thunderbolt » et P-51 «
Mustang », 400 chasseurs-bombardiers P-38 «
Lightning » et 800 bombardiers moyens B-26 «
Marauder ». Les chasseurs et chasseurs-bombardiers
s’en prenaient essentiellement à des objectifs
d’opportunité (transports de toute nature,
formations militaires …) et accessoirement à des
objectifs désignés (voies de communication,
aérodromes …). Pour les bombardiers moyens
c’était l’inverse.
13. Le jour de deuil de la chasse allemande
Le 25 août 1944 de 12 h 30 à 13 h 00, à
la verticale de La Fère et à moins de 900 m
d’altitude, 34 chasseurs-bombardiers Lockeed P-38 «
Lightning » du 367e Groupe de chasse de la 9e US Air Force se
sont affrontés à 40 chasseurs Focke Wulf 190 de
la 6e Escadre de chasse de la Luftwaffe. Huit des premiers et, selon
les sources, de 16 à 19 des seconds ont
été abattus. Ce combat aérien
véritablement historique serait le plus meurtrier que les
Allemands aient connu de toute la guerre : 16 pilotes tués
en 30 minutes. Aucun Américain n’a connu le
même sort, tous ayant pu se poser en parachute.
Pour la petite histoire ajoutons que sept des Focke Wulf
n’ont jamais été retrouvés :
ils se sont engloutis dans les marais entourant La Fère. Un
huitième a été extrait en 1970 de la
ballastière de Travecy.
D’autre part, le même jour dans
l’après-midi et à quelques
kilomètres au nord-est de La Fère, le 474e Groupe
américain, équipé de chasseurs
Republic P-47 « Thunderbolt » s’est
heurté à une quarantaine de chasseurs allemands
Messerschmitt 109 des 11e et 26e Escadres de chasse. Ce combat
entraîna d’importantes pertes de
matériel de part et d’autre.
Au total, pour la journée du 25 août, dans la
seule région de Laon/Saint-Quentin, la 9e US Air Force a
perdu 18 appareils en combat aérien et la Luftwaffe 41
(renseignement d’origine américaine, source
n’ 2).
Annexe 2
Note sur les opérations terrestres dans
l’Aisne
21- Les forces en présence
Côté allemand. Il s’agit essentiellement
de la 5e Armée blindée qui, après son
retrait de Normandie, ne comportait plus que des restes de divisions
engerbant des restes de régiments :
Ier et IIe Corps blindés S.S., coiffant les 1re,2, 9e,10e et
12` Divisions S.S., les 2e, 9e et 116e Divisions blindées,
les 47e,48e, 338e et 348e Divisions d’infanterie, la 6e
Division parachutiste et la 18e Division de campagne de la Luftwaffe.
« Ces corps et divisions ne constituaient plus une force
cohérente mais une quantité de groupements de
combat fugaces, désorganisés et
démoralisés, manquant cruellement
d’armes et d’équipements …
L’ennemi avait été
dépassé sur le plan du commandement comme au
combat et n’était plus en mesure
d’opposer une résistance sérieuse
à nos forces sur aucune position en
deçà de la ligne Siegfried » (extrait
du rapport d’opérations de la 1re Armée
US, source n0 4).
Côté américain
1re Armée
(général Hodges)
|
Ve
corps d’armée (général
Gerow)
• 5e division blindée
• 4e division d’infanterie
• 28e division d’infanterie
• 102e groupe de cavalerie légère
blindée
(axe général : Compiègne, Le Cateau) |
VIIe
corps d’armée (général
Collins)
• 3e division blindée
• 1e division d’infanterie
• 9e division d’infanterie
• 4e groupe de cavalerie légère
blindée
(axe général : Château-Thierry,
Aubenton) |
La 1″ Armée
comprenait un autre corps
d’armée, le XIXe, lequel n’est pas
intervenu dans l’Aisne mais plus à
l’ouest.
Outre les trois divisions blindées incluses dans les corps
d’armée, la 1re Armée US comprenait des
unités de chars autonomes : deux bataillons de chars
légers (M3 Stuart) sept bataillons de chars moyens (M4
Sherman) et douze bataillons de chasseurs de chars (TD : tank
destroyers M10 et M36). Au total, la 1re Armée comptait
environ 256 000 hommes et 2 300 blindés
chenillés. Du 28 août au 2 septembre, elle a perdu
150 tués au combat.
Elle était appuyée par le IXe Commandement
aérien tactique de la 9e Armée
aérienne qui, dans cette période, a mis
à sa disposition une
moyenne journalière de six groupes de chasse, soit 450
chasseurs et chasseurs-bombardiers.
22- Qui a libéré Charmes ? (Voir
ci-après le plan et le tableau de progression des
unités américaines dans la moitié nord
de l’Aisne le tableau doit être lu du bas vers le
haut).
Logiquement, ce devrait être le Ve Corps qui progressait au
centre de la 1re Armée, le cours de l’Oise de
Noyon à Guise se trouvant largement à
l’intérieur de sa zone de
responsabilité.
Pourtant la presse locale a fait état
d’unités du VIIe Corps, lequel tenait
l’aile droite sur la direction générale
Château-Thierry, Aubenton.
Les rapports d’opérations sont muets sur ce point
et, à les lire, on pourrait croire qu’aucune
unité américaine n’a
opéré dans le triangle Soissons, Landrecies, La
Capelle.
En revanche ils précisent que, le ler septembre, le VIIe
Corps a infléchi son axe de progression du nord-est vers le
nord, empiétant alors profondément sur la zone
initialement dévolue au Ve Corps. Le rapport de
l’US Army (source n° 3) utilise même le
terme : « s’est écarté
… », ce qui laisse supposer que ce
n’était pas sur ordre. Il s’agit
là de la 3e D.B., en tête, et le point de
bifurcation se situe à 50 km de La Fère ; mais il
est vraisemblable que, si les éléments de
tête ont modifié leur axe de progression, les
éléments de second échelon ont aussi
« appuyé » sur leur gauche à
partir du franchissement de l’Aisne,
c’est-à-dire à Soissons.
En tout cas, il n’existe aucune mention du passage
d’unités du Ve Corps à l’est
de l’Oise dans cette période*, le cours de la
rivière jusqu’à Guise puis le canal de
la Sambre à l’Oise semblant constituer la limite
de fait entre les deux Corps d’armée. Ceci montre
à l’évidence que, à
défaut d’ordre supérieur, le VIIe Corps
ne s’est déporté sur sa gauche
qu’en accord avec le Ve (lequel n’avait alors que
deux divisions en 1re ligne, la 28e D.I. étant maintenue en
retrait à l’ouest de Compiègne).
(*) A partir du 4 septembre_ le Ve Corps a été
chargé de combler une brèche qui allait
s’élargissant entre l’aile droite de la
1″ Armée US et l’aile gauche de la 3e
Armée US, en Champagne. Ses unités ont alors
traversé l’Oise et la zone d’action du
VIIe Corps pour rejoindre leur nouvelle zone
Ve Corps
d’Armée US
2 septembre
– Progresse rapidement en direction du nord-est,
dépassant Noyon, Chauny et Saint-Quentin.
– La 5`B. atteint Cambrai, Le Cateau.
1er septembre
– Progresse rapidement en direction de Saint-
– La 4e I., initialement en second échelon,
renforcée par le groupement blindé « A
» de la 5e D.B., dépasse cette
dernière, occupant les approches de Chauny vers midi et
Autreville en soirée.
– Le groupement blindé « B »
est à Compiègne et dans la forêt de
Laigue.
31 août
– Occupe à la nuit la lisière nord de
la forêt de Compiègne.
– Sur l’aile droite, le groupement « A
» de la 5eB. atteint l’Aisne à
l’ouest de Soissons et tient Pommiers (4 km W de Soissons).
30 août
– [De la région de Gonesse, Le Plessis-Belleville
qu’il a occupée la veille] poursuit rapidement en
direction de Compiègne et de l’Aisne, avec la 5e
D.B. en tête.
VIle Corps
(l’Armée US
2 septembre
– Poursuit l’ennemi en Belgique après
avoir franchi la frontière près de Maubeuge.
– La 3e D.B. traverse la Sambre et atteint
VieuxMesnil à midi et Mons (Belgique) à
la nuit tombante.
1″ septembre
– Infléchit son axe de progression du nord-est
vers le nord jusqu’à toucher la forêt de
Mormal.
– Le groupement blindé « B »
de la 3eB. traverse rapidement Vervins, atteint vers midi, en direction
de La Capelle, atteint dans l’après-midi.
A droite, le groupement blindé « A », en
liaison avec la 9e D.I., atteint Aubenton.
– La 9e DI, chargée de la
sûreté sur le flanc droit, maintient une grande
partie de ses moyens en arrière pour assurer cette mission.
Sur le flanc gauche, la 1re D.I. tient un front de 18 km à
l’ouest de la ligne Sissonne, La Capelle, occupant Voyenne et
Chivres.
31 août
– La 3e B. occupe Montcornet, couverte sur sa gauche sur la
ligne Marle, Lambercy.
– La 9eI. occupe Rumigny et Remaucourt (Ardennes).
– La 1reI., en couverture sur le flanc gauche
exposé de Soissons à Laon, via Allemant et
Chaillevois, renforce son dispositif.
30 août
– Laon est occupé en force tandis que des
reconnaissances sont poussées à 5 km au nord et
au nord-est de la ville.
Source
«
Vive les
Américains ! » Souvenirs d'un
libéré, Alain HUYON, Revue Historique
des
Armées, n°196, septembre 1994, Dossier Seconde
Guerre mondiale, p 120-127
Tous les numéros de la Revue historique des Armées
Voir également www.persee.fr

La "drôle de guerre" | L'exode | Combats sur l'Ailette
| L'occupation
| La
Résistance | La Libération | Carte
|