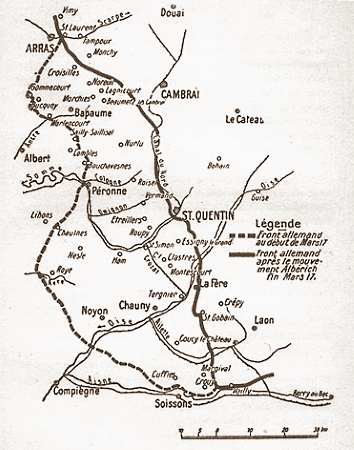 |
La Grande Guerre 1917, la première libération Le
repli allemand
de mars 1917 - La deuxième bataille de l'Aisne L'invasion allemande | La première libération | Les combats de 1918 | Les tranchées à Quierzy | La reconstruction L'aide du 1er Corps de Cavalerie | Des Américaines à Quierzy 1917-1924
|
|
A la mi-février 1917, les habitants de la zone comprise entre le front et la ligne de repli sont évacués ; une seule valise par personne autorisée. Les hommes valides et les femmes sans enfant partent en train vers Hirson dans le nord du département afin d'y travailler pour l'ennemi, les autres vers le front ... Les allemands redoutant une attaque du saillant que forme le front devant Roye se replient méthodiquement ; Avant cette manoeuvre, ils entreprennent le pillage puis la destruction systématique de la région ; Dynamitage des édifices et des maisons, destruction des arbres, des puits, ... Rien ne doit pouvoir être utilisé par les alliés. Tout ce qui ne peut être emporté est détruit ou saccagé. A Autreville : "Le 16
février dernier,
tout ce qu'il y
avait de valide dans la population a été
envoyé dans
le nord, c'est-à-dire environ deux cent trente habitants :
hommes, femmes, jeunes filles et
enfants, de quatorze à soixante ans. Une quarantaine encore
sont partis le 22 février. Tout
le reste a été évacué
à Quierzy les 27 et 28 février". La destruction de Chauny commence le 5 mars. C'est ensuite le tour des villages alentours tandis que le gros des troupes est retiré du front (c'est le XXIIIe Corps de Réserve de la VIIe Armée allemande Schubert qui opère sur la rive sud de l'Oise). Les éléments restés en lignes se retirent en combattant à partir du 15 mars (15e DLW et 44e DR au nord de l'Oise et 213e D et 46e DR au sud). Dans la nuit du 15 au 16, les patrouilles françaises pénètrent dans les tranchées allemandes qu'elles trouvent vides et le 16 au matin toute la première ligne ennemie est occupée. Le Groupe d'Armées du Centre décide alors de porter en avant la Ière Armée en direction de Noyon et Chauny. La traversée de la zone qui constituait le front est difficile. Les quelques passages rapidement créés à travers les réseaux et les tranchées, qui dépassent parfois huit à dix kilomètres, sont encombrées et les voitures s'y embourbent. Au-delà, les routes sont coupées. La question du ravitaillement devient rapidement critique. La progression de l'infanterie, rapide au début, est vite difficile. Sur la rive droite de l'Oise Noyon surpeuplé et affamé est libéré le 18 mars 1917 après 30 mois d'occupation, Chauny en ruine le 19 par la 3e Division de Cavalerie qui, débouchant de Noyon à 12h30, dépasse la 61e DI pour aller tenir les ponts de l'Oise entre Noyon et Chauny et pénètre dans la ville évacuée par les allemands. L'infanterie (61e DI) rejoint à la nuit et occupe la ville. Ce sont notamment les 26e et 61e DI (13e et 35e CA)
qui opèrent à la mi-mars 1917 sur la rive nord de
l’Oise dans la poursuite des troupes allemandes lors de leur
retrait stratégique (opération
Alberich). La 53e DI (205e, 236e RI et 319e) en ligne le long de l'Oise rive nord est engagée le 19 mars. Elle passe le 22 mars à la disposition du 33e CA au sud de l'Oise dans la zone de la 81e DT : 236e RI à Quierzy - Brétigny et 205e RI à Bourguignon - Besmé. La division prend part au combat de Quierzy puis avance jusqu'à Chauny. "Le Récit", la célèbre peinture de François Flameng parue dans L'Illustration en mars 1917 après la libération de Noyon, présente à droite un homme du 125 RI (9e CA, 4e Armée), régiment qui se trouve à cette date à l'instruction au camp de Mailly dans l'Aube, avant d'être engagé en avril dans Bataille du Chemin des Dames.
Le repli allemand de mars
1917 Quierzy est mentionné dans le journal d'un combattant du 269e RI (70e DI) qui arrive le 22 mars vers Trosly jusqu'au canal Oise-Aisne, où les allemands semblent s'être arrêté. Après plusieurs tentatives infructueuses pour franchir le canal, les hommes se reposent à Quierzy le 3 avril. On retrouve dans l'Historique du 269e RI que début avril, après 6 jours d'avant-postes, le 269e est relevé ; Le 5e Bataillon gagne Quierzy, "village respecté où s'entassent les réfugiés de plusieurs communes". Le 6e Bataillon n'a pas cette chance et campe sur les ruines de Marizelles. 5 jours d'avant-poste, 10 jours en réserve dans les ruines etc. Plus les libérateurs avancent dans le "no mans land" plus les defénses deviennent organisées et sur la rive gauche de l'Oise, où se trouve Quierzy, les allemands sont retranchés derrière l'Ailette. Le cours d'eau qui se jette dans l'Oise entre Quierzy et Manicamp et son canal situé à 4 km à l'est du village, constituent de sérieux obstacles avant la ligne Hindenburg. L'attaque de l'Ailette Le 236e RI (53e DI) arrive en première ligne sur l'Oise le 23 mars ; EM et 4e Bataillon à Quierzy, 5e à Manicamp et 6e dans le bois de Manicamp. Il relève dans la nuit du 23 au 24 mars la 81e DT et doit aller franchir l'Ailette vers Arblaincourt le 24. Le franchissement est rendu difficile par les inondations provoquées par les allemands. L'attaque est lancée le 24 mars à 10h30 du matin et le canal rapidement franchi. A midi, le 236 atteint le Bac d'Arblaincourt puis Bichancourt et Marizelle. Dans la nuit des patrouilles du 205e RI sont envoyées à Autreville, Sinceny, Pierremande et Chauny pour se mettre en liaison avec 61e DI. Le 25, le 205 est face à Pierremande, le 236 au Bac d'Arblaincourt, Bichancourt, face à Autreville, Marizelle. Le 319 en arrière à Bourguignon, Rue Millon poursuit vers la lisière est de la Basse Foret de Coucy. Autreville, Pierremande et la cote 102 sont occupés. Nous pénétrons dans Sinceny et la Basse Foret de Coucy. Le 26 après une préparation d'artillerie, le 236 encore prend Amigny, le 205 dépasse l'objectif du Rond-point d'Orléans dans la Basse Foret de Coucy. Dans la nuit du 27 au 28, le 236 est relevé par le 319 qui le 28 mars a deux bataillons en première ligne et un à Quierzy, tandis que le 236 occupe les faubourgs sud de Chauny. Le 319 prend Servais pendant la nuit du 28 au 29. On organise les positions le 29 et pendant la nuit du 29 au 30 mars, la 53e DI est relevée par la 70e. Le 236 passe sur la rive droite et va cantonner à Chauny le 30. Le 319 reste à Quierzy. Le 31, il part à son tour sur Chauny par le pont de Quierzy pour aller prendre Le Moy. L'Ailette est franchie sur près de 20 kilomètres jusqu'au sud de Coucy vers Courson, la forêt de Coucy reprise ainsi que Servais, mais Deuillet, Barisis et la forêt de Saint-Gobain restent aux allemands. Les alliés sont devant la ligne Hindenburg. Devant Barisis la ligne se trouve à une dizaine de kilomètres à peine à l'est de Quierzy et en amont de l'Oise, plus au nord entre Tergnier et La Fère à une quinzaine de kilomètres. (carte) Le 264e R.A.C. est à Marizelle, Sinceny, forêt de Coucy en avril-mai 1917, v. l'herbier de Stanislas Boireau. La 70e DI reste dans le secteur. En mai, le 269e RI va organiser la Basse-Forêt de Coucy. "Le réseau de fil de fer est renforcé en avant de la lisière et poussé jusqu'à l'Oise à travers les marécages d'où les eaux d'inondation se retirent peu à peu .... Après les fatigues d'une poursuite sans trêve, après des semaines vécues dans la fièvre du travail et de l'insomnie parmi des marécages infectés de moustiques, et parmi des ruines dont la vue finit par être un spectacle déprimant, le 269e a besoin de repos" et est relevé. Cette perte de terrain consentie par l'ennemi est ressentie comme une réelle victoire, mais aussi comme un choc par las Français de l'arrière car outre les marques de la germanisation, ils peuvent voir les désastres de la guerre en France, chose jusque-là impossible en raison d'un front stabilisé et d'un secret militaire respecté. La presse multiplie les reportages photographiques sur " les villages martyrs ", montrant les " témoignages de la destruction systématique pratiquée par les Allemands en retraite ". Aussitôt, un élan de solidarité vient au secours des réfugiés et des déportés. Les personnalités politiques viennent visiter le territoire reconquis. Autre conséquence du repli de mars, qui laisse une région dévastée d'où aucune offensive ne peut être lancée, le Gal Nivelle est contraint de modifier en toute hâte son plan d'attaque en tenaille du Chemin des Dames : il doit renoncer à son action sur l'Oise et étendre son attaque à l'est de Reims. L'offensive qui démarre le 16 avril est un désastre (Deuxième bataille de l'Aisne). L'Ailette ne sera totalement
franchie qu'après la prise du Fort de la Malmaison sur le
Chemin des Dames fin octobre 1917.
L'aide
du 1er Corps de Cavalerie à la
population, mai 1917 - janvier 1918 Début mai 1917,
le 33e Corps d’Armée de la IIIe Armée
tient le front entre Quincy-Basse et l'Oise devant la ligne Hindenbourg
avec la 70e DI dans le secteur nord de Villette, front entre l'Oise et
Barisis-aux-Bois et la 77e DI dans le secteur sud de Coucy. Le 33e CA a
son QG à Blérancourt et la 70e DI son
général à Quierzy. A partir du 3 mai, la 3e Division de Cavalerie du
général de Boissieu,
qui
après Noyon, a libéré Chauny en ruine
le 19 mars 1917 et devait exploiter le 16 avril la percée
avec
la 10e Armée sur le Chemin des Dames, forme une division
provisoire de cavalerie
à pied qui relève pour quinze jours la 70e DI
dans le secteur nord de Villette. La 1ère Division de
Cavalerie procède de même le 18 mai dans le
secteur sud de Coucy tenu par la 77e DI. La 3e Division de Cavalerie,
stationnée à Compiègne en 1914,
appartient au 1er Corps de Cavalerie du Général
Féraud, rattaché à la IIIe
Armée. Le 1er CC est composé des 1ère
et 3e Division de Cavalerie, engagées en mars 1917 au nord
de l’Oise dans la poursuite de l'armée allemande
lors de son repli. L'effectif d'une
division de cavalerie sur le pied de guerre est
théoriquement en
1914 de 5 250 hommes, ce qui est relativement peu en comparaison des 18
000 hommes d'une division d'infanterie. En mars 1917, le
régiment de cavalerie compte 33
officiers pour 678
hommes tandis que «
le régiment à pied, dépôt
divisionnaire
compris, a un effectif de 77 officiers - 3 140 hommes ». L'effectif
minmum du 1er CC (3
divisions à 7 régiments de 711 hommes*) serait
donc de l'ordre de 15 000 / 20 000 hommes. (* «
Projet de réorganisation de la cavalerie, mars 1917
», SHD, 7N404).
Les volontaires américaines seront au total 350 entre 1917
et 1924 et sans doute moins de 50 en 1917 ? La zone de
Blérancourt est divisée en trois secteurs : Coucy
(1e DC), Folembray (5e DC) et Vilette (3e DC). La 3e Division de
Cavalerie du général de Boissieu a son QG
à
Quierzy et son PC avec
le général de
brigade commandant l’infanterie PC à Vilette. Ordre de bataille de la 3e
Division de Cavalerie au 15 avril 1917 : JMO
3e DC Cote 26 N 483/1 SHD Vincennes Chaque
secteur a trois
bataillons en première ligne (deux bataillons de cavaliers
démontés et un bataillon de cuirassiers
à pied) et deux en réserve (cuirassiers
à pied). Il reste dans chaque division une brigade
à cheval complète disponible. Les deux autres
brigades ont fourni chacune un bataillon
démontés. Les bataillons restent vingt jours en
ligne et chaque brigade à cheval est reconstituée
pendant dix jours. En
mai 1917, trois brigades de Dragons du 1er Corps de Cavalerie sont
envoyés tour à tour à Paris et dans
les grands centres industriels, des postes sont établis dans
les gares de permissionnaires, dépots de munitions. __________ Le
1er Corps de Cavalerie est constitué des
1ère et 3ème divisions de cavalerie puis
renforcé avec la 5e division de cavalerie
à compter du 23 juillet
1917 : 1ère division de
cavalerie - Paris __________
Le
Corps de Cavalerie en secteur L’Historique
du
1er Corps de Cavalerie, mars 1917- décembre 1918 (Ch VII Le
Corps de Cavalerie en secteur, Industrialisation du front, p.73 et s.)
évoque la tâche immense entreprise par les
cavaliers de mai 1917 à janvier 1918 dans la zone de
Blérancourt, après les destructions
opérées par les allemands, non seulement pour en
organiser la défense mais aussi la reconstitution
économique au profit des populations. L’ampleur de
la tâche amène à la création
par le corps de cavalerie de véritables organisations
industrielles. Amélioration
des
communications Le
ravitaillement des
troupes, leurs déplacements et leur relève
exigent tout d’abord la remise en état des
communications : routes et ponts plus ou moins détruits par
les allemands, et la création d’un
réseau ferré à voie étroite
entre les vallées de l’Oise et de
l’Ailette. De cette époque (hiver 1917-1918)
datent les travaux de construction de la voie ferrée
d'Appilly à Coucy par Quierzy. La
voie ferrée
d'Appilly à Coucy par Quierzy Perfectionnement
des
organisations défensives L’organisation
défensive du secteur est ensuite perfectionnée :
voies de communications à l’abri entre les
éléments de défense, abris
à l’épreuve en première et
deuxième ligne et abris destinés aux
réserves, ces derniers avec cuisines, couchettes et
éclairage électrique pour la plupart. Le nombre
de places sous abris dépasse 20.000 fin 1917. Cette
organisation défensive perfectionnée,
complétée par différents
réseaux téléphoniques, permet de
consacrer à la défense du secteur des effectifs
réduits en vue du quatrième hiver de
campagne. Les
ateliers
mécaniques La
fourniture du
matériel nécessaire aux travaux est
assurée par l’organisation d’ateliers
mécaniques à grands rendements : chantiers
d’abatage dans les bois de la région et scieries
avec une scierie centrale à grand rendement près
de Blérancourt (deux moteurs à vapeur de 30 CV
chacun, éclairage électrique permettant un
travail de jour et de nuit de 60 à 70 ouvriers). Cette
organisation permet de fournir notamment huit baraques de 25 hommes
chacune et une baraque d’officier par semaine. Les
dynamos de la scierie
assurent également l’éclairage
électrique de Blérancourt, du QG et services du
Corps de Cavalerie, du centre d’instruction, de
l’hôpital et le fonctionnement des moteurs
d’une cidrerie et des ateliers de réparation de
l’artillerie. Dès
le mois de
juillet 1917, les ateliers de réparation de
l’artillerie de St-Aubin et Blérancourt
réparent les voitures, le matériel et les armes
tandis que l’entretien et la réparation des
voitures automobiles (environ quatre cent pour le corps) sont
assurés par les ateliers du Service Automobile
installés près de Blérancourt avec
camions-ateliers, forge, atelier de menuiserie. Les
ravitaillements Outre
le ravitaillement en
vivres apporté de l’arrière vers les
centres de ravitaillement, un centre d’abat
installé près de Caisne et alimenté
par le bétail logé dans une vaste ferme au milieu
des pâturages, fournit au corps de la viande
fraîche avec utilisation complète des issues :
fabrique de saucisson, récupération du sang,
salage des peaux, … Le
vétérinaire qui examine le bétail
réserve les vaches pleines et les bœufs de travail
pour les mettre à la disposition des agriculteurs pour les
aider à reconstituer leur troupeau. Une centaine de
bête sont ainsi livrés durant
l’année 1917. Les
travaux
agricoles Le
secteur de
Blérancourt, qui appartient à une
région agricole particulièrement riche, offre en
mai 1917 malgré les dévastations
systématiques de l’ennemi, des ressources
importantes en fourrages et en céréales. Le Corps
de Cavalerie entreprend immédiatement
l’exploitation des ressources existantes et la mise en
culture des terres abandonnées pour
l’année suivante avec de l’outillage
emprunté aux ressources locales ou fourni par
l’atelier de réparation de
Blérancourt. Dès
la fin
août 1917, les
récoltes donnent les meilleurs
résultats. Le foin, la paille et l’avoine sont
employés à l’alimentation des chevaux,
les autres céréales sont envoyés vers
l’arrière. Des bons de réquisition sont
établis pour garantir les droits des habitants. La
mise
en culture
des terres est ensuite entreprise et dès la fin
août 1917, 700 hectares de terre sont fumés et
labourés et 500 passés à
l’expirateur. Une
centaine de charrue est
entretenue en travail mais ce nombre est insuffisant pour
l’étendue des terres à labourer et avec
l’appui du Comité Américain qui
s’installe à Blérancourt en juin 1917,
vingt tracteurs sont mis à la disposition du Corps de
Cavalerie et grâce à ces moyens, dès la
fin décembre, près de 2.500 hectares sont
labourés et ensemencés. 11 juillet 1917, le commandant
en chef des armées françaises passe en revue les
troupes du 1er corps de cavalerie à
Blérancourt, Les
allemands ayant
détruit systématiquement au moment de leur
départ le matériel existant, la récupération
du matériel détérioré
est organisée et un atelier de
réparation est constitué
à Blérancourt employant environ vingt-cinq
ouvriers. A la mi-novembre, 1.162 machines diverses ont
livrées (faucheuses, moissonneuses-lieuses, charrues,
semoirs, chariots ou tombereaux). L’atelier assure
également l’entretien et du matériel en
service et celui des habitants. Une
cidrerie
est également organisée à
Blérancourt, la région étant
particulièrement riche en pommiers. Les pommes
récoltées sont acheminées par camions
jusqu’à la cidrerie, qui produit en moyenne 80
à 100 hectolitres de cidre par vingt-quatre heures. Le cidre
est distribué aux troupes et le malt utilisé pour
l’alimentation des chevaux. La
reconstitution du pays
dévasté Le
Corps de Cavalerie
participe également à la remise en
état des maisons encore habitables et
à la construction
de baraquements en bois. Fin août 1917, 442
maisons sont réparées, 100 baraques construites
et 20.000 places de chevaux aménagées. 35.000
mètres carrés de jardin sont également
remis en état. Ces
travaux permettent le
retour des habitants, qui partout où ils se
présentent reçoivent l’aide la plus
complète afin de « ramener la vie dans ce pays
dévasté ». Dès juin 1917,
500 habitants sont réinstallés chez eux. Enfin,
les grandes fermes
(Coquerelle, Latour, Forest) sont remises en état et leur
propriétaires invités à les
réoccuper pour en prendre la direction. Du
bétail, de la
volaille, du grain, des effets de toutes sortes provenant de dons ou
fournis par le Comité Américain sont
distribués. Outre
l'aide
donnée à la population, les premières
associations agricoles sont encouragées dans
chaque commune pour représenter les
intérêts communs des présents et des
absents. Un officier de l'état-major du Corps de Cavalerie
est spécialement chargé de suivre cette question
et en décembre 1917, sept ou huit associations sont
constituées ou en cours de constitution. Par
ailleurs, un camp
d’instruction de la cavalerie est établi
à Blérancourt, PC du 1er Corps de Cavalerie,
relevé le 5 février 1918 par la 161e DI, VIe
Armée. Historique
du 1er corps de cavalerie (mars 1917- décembre 1918)
Des Américaines à Quierzy Malgré
la
proximité du front, en juin 1917, tandis que les
États-Unis sont entrés en guerre en avril, un
groupe d'américaines de
la Section Civile du Comité
Américain pour les Blessés Français,
qui deviendra en 1918 le Comité
Américain pour les Régions
Dévastées (C.A.R.D.) s'installe à Blérancourt autour d'Anne
Morgan pour secourir les populations des villages
dévastés. La remise en état des
habitations et des terres cultivables s'organise. En mars 1918, après 10 mois de travaux de reconstruction, le personnel du CARD doit se préparer à évacuer Blérancourt pour Vic-sur-Aisne. Des Américaines à Quierzy 1917-1924 >>> Le 39e RI (130e DI, IIIe Armée Humbert) opère en forêt de Coucy, Sinceny en oct.-nov. 1917, date de la dissolution de la Division. La 130e DI est arrivée le 19 septembre 1917 dans le secteur du 1er CC (QG à Blérancourt) qui tient le secteur de la Basse Forêt de Coucy et du sud de l'Oise. Le 39e RI relève le 137e RI (21e DI) dans le secteur de Vilette le 20 sept. Le 24, le 39e RI monte en ligne (centre de l'Epinois) l'EM du Régiment est à Quierzy. Le 27, le soldat Pinard du 39e RI reçoit la médaille militaire anglaise des mains du Prince Albert de Connaught à Noyon. Le 28, le Président de la République et le Roi d'Italie sont à Noyon. Les honneurs sont rendus par la Division. Le 11 octobre, le Président de la République du Portugal de passage à Compiègne, la Division rend les honneurs. ... Le 10 janvier 1918, le front
de l'Armée anglaise est étendue
jusqu'à Barisis. La IIIe Armée
française est relevée par les britanniques et le
18, elle passe le commandement des secteurs d'Ugny-le-Gay et
Blérancourt à la VIe Armée
française (5e, 35e, 11e CA). *** |
|
L'invasion allemande | La première libération | Les combats de 1918 | Les tranchées à Quierzy | La reconstruction |
||

|
||
|
Sources : Les armées françaises pendant la Grande Guerre, Service Historique de la Défense J.M.O.
des unités citées : |
||
|
| Quierzy, résidence royale | La Grande Guerre | La Guerre 1939-1945 | Liens | |
||